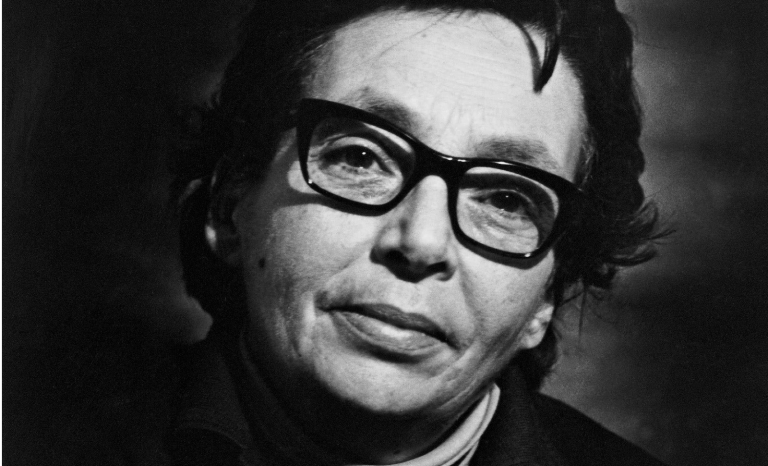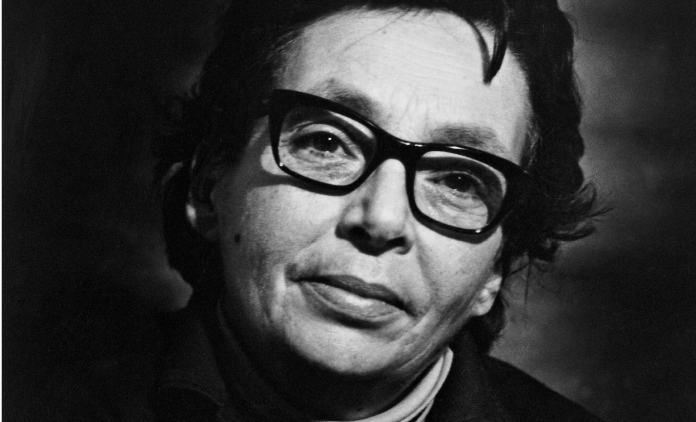De même que sept villes se sont disputé l’honneur d’être le lieu de naissance du poète Homère, plus d’un piano était proposé comme étant celui sur lequel Chopin aurait composé certains de ses Préludes lors de son séjour sur l’île de Majorque. Des deux présentés à la Chartreuse de Valldemosa, celui dans la cellule n° 2, devant lequel des touristes ayant payé le privilège s’émerveillent, n’est pas authentique mais le produit d’un subterfuge. Récit.
A la Chartreuse de Valldemosa, sur l’île de Majorque, et cela pendant près d’un siècle, des centaines de milliers de touristes se sont vu présenter un piano parfaitement quelconque comme étant celui où Chopin composa nombre de ses Préludes. Un piano exposé au sein d’une cellule qu’on prétendait être celle où avait vécu le musicien. Supercherie alors fort rémunératrice, naguère dénoncée par la Justice, mais que, dans la Serra de Tramuntana, le principal massif montagnard de Majorque, on persiste à noyer dans un flou artistique.
Durant des décennies, les visiteurs accourant à la Chartreuse de Valldemosa afin d’y verser une larme attendrie à la mémoire de Frédéric Chopin et de George Sand, auront été confrontés (pour le prix d’un seul billet d’entrée, mais dans une confusion savamment entretenue sur le site comme dans les pages des guides touristiques !) à deux cellules, la 2 et la 4, où auraient vécu le compositeur, la romancière et ses enfants, lors d’un séjour romantique à souhait, du 15 décembre 1838 au 11 février 1839. Au sein d’un monastère humide et glacial en hiver qui venait d’être désaffecté par le ministre libéral Juan Álvarez Mendizábal et vendu par lots aux bourgeois de Palma. Durant tout le XIXe siècle, on ne savait plus exactement dans quelle cellule avaient séjourné Chopin, Sand et ses deux enfants, avec leur domestique. Tout permettait cependant de penser que ce n’était en aucun cas la cellule n°2, ainsi que l’atteste le témoignage écrit et daté de 1896 d’un homme se souvenant, dans son enfance, avoir rendu visite aux illustres voyageurs dans la cellule n°4 ou la cellule n°5, à l’exclusion de toute autre.
Un subterfuge
Mieux encore ! la famille Ferra, qui depuis toujours dirige le Festival Chopin au sein de la Chartreuse, puis sa présidente, la señora Rosa Capllonch-Ferra, auront fait croire aux visiteurs, du touriste ordinaire à la reine d’Espagne et au président polonais, en passant par Manuel de Falla, Alfred Cortot ou José Luis Borges, que l’instrument disposé dans la cellule n°2 était le « pauvre piano majorquin » évoqué par George Sand et loué à Palma en attendant l’arrivée de l’autre, un pianino Pleyel envoyé à Chopin de Paris.[1] Ce pauvre piano majorquin sur lequel l’artiste aurait toutefois composé nombre de ses Préludes. Or le médiocre instrument de la cellule n°2, des experts l’ont prouvé, avait été fabriqué à Majorque dans les années 1850… bien après le séjour de Chopin à Majorque. Et même après sa mort, place Vendôme, à Paris, en 1849.
A lire aussi: A Séville, sur les traces de Carmen…
Cependant, à deux pas, dans la cellule n°4, celle où avaient effectivement vécu les deux grandes figures du Romantisme, le piano qui y était présenté, celui envoyé de Paris par Pleyel et arrivé peu avant le départ de Chopin malade pour la France, ce piano était même un temps interdit d’existence… par décision officielle venue de Madrid.
Début des hostilités
La guerre picrocholine qui débuta en 1932 et qui aura opposé durant huit décennies les propriétaires des cellules 2 et 4, mais surtout le faux et le vrai, la supercherie et la vérité historique, si modeste au fond qu’en soient les sujets (une cellule de moine et un simple piano droit, mais lourd d’une intense charge émotionnelle et sur lequel furent composées des pages célèbres), cette guerre aurait dû être stoppée net par le jugement courageux d’une magistrate de Palma à l’aube des années 2010. Un jugement circonstancié et sans appel, s’appuyant sur des expertises sérieuses, sur des éléments solidement documentés, parfaitement étayés, établis à la façon d’un travail universitaire. Et prouvant de façon définitive que la cellule n° 4 était bien celle où Chopin avait vécu, alors que la cellule n° 2 n’avait pas été la sienne et surtout que le piano de rencontre qu’on y avait déposé, constituait une supercherie.
Cette année 1932, sur les conseils du Français Edouard Ganche (1880-1945), alors l’un des plus éminents spécialiste de Chopin, venu en pèlerinage à Valldemosa, la cellule n°4 de la Chartreuse fut ouverte au public par son propriétaire, le señor Quetglas-Amengual, grand-père de son actuel possesseur, Gabriel Quetglas. En 1928, elle venait d’être enfin authentifiée comme étant celle qui avait abrité le musicien et ses compagnons. Et cela grâce à un dessin du fils de George Sand, le tout jeune baron Maurice Dudevant. Un dessin attestant, sans hésitation aucune, grâce à la position du campanile de la Chartreuse, qui y est représenté, que c’était bien depuis le jardin de cette cellule n°4 qu’il avait été tracé.[2] On y présenta dès lors, on y présente encore aux voyageurs, le pianino envoyé à Majorque par Pleyel à la demande de Chopin. Arrivé à grand peine sur l’île en décembre 1838, et plus difficilement encore du port de Palma à Valldemosa au début de janvier 1839, malgré les tentatives d’extorsions des douanes espagnoles, le pianino Pleyel[3] fut installé là où résidaient le Polonais et ses amis français, dans cet ensemble de trois pièces spacieuses qu’on appelle cellule, ouvrant sur un jardin clos de la même surface que celle de l’appartement, et d’où l’on découvre un paysage enchanteur bordé par la Méditerranée.
Le piano décoratif dans une cellule fantaisiste
Tout cela se fit parce qu’une dizaine d’années auparavant, les Ferra, une autre famille de Palma localement influente et propriétaire des cellules 2 et 3, avait décidé fort opportunément de les ouvrir au tourisme naissant en profitant de la confusion qui longtemps avait empêché de situer de façon sûre l’emplacement de la cellule occupée par Sand et Chopin. Pour orner la n°2 transformée en musée Chopin, cette famille fit l’acquisition d’un vieux piano qui n’était là que pour évoquer la présence du musicien. Le propriétaire de la cellule, Bartomeu Ferra, dans un opuscule consacré à Valldemosa, y précisait même brièvement que le pauvre piano majorquin évoqué par George Sand et sur lequel s’échina Chopin en attendant celui de Paris, devait être considéré comme définitivement perdu. Et qu’en aucun cas le piano exposé chez lui n’avait été celui sur lequel le compositeur polonais avait travaillé.
A lire aussi: L’esprit français au passé et au présent
Et pour cause ! Le clavier de cet instrument exhibé dans la cellule n°2 comporte 82 touches… quand ceux en usage du vivant de Chopin et sur lesquels il composa n’en comptaient encore que 78, puis 80 dès les années 1840. Ce piano à 82 touches offrede surcroît trois cordes par note alors que dans les années 1830 un marteau ne frappait que deux cordes, voire une seule s’agissant des basses. Enfin, son apparence dévoile qu’il est une copie de modèles qui n’apparurent à Paris qu’au mitan des années 1840. Il est donc aujourd’hui prouvé que ce piano de la cellule n° 2 ne fut construit par des facteurs de Majorque que dans le courant des années 1850… soit près de quinze ans ou plus après le départ de Chopin !
Des roses. Et sur les deux pianos
Toutefois, la famille fort avisée de Bartomeu Ferra fera vite disparaître le trop honnête opuscule de ce dernier afin d’en rééditer une nouvelle version amputée de la phrase importune. En outre, elle décida d’autorité que Chopin et Sand avaient occupé la cellule n°2 dont elle était justement – voyez l’heureux hasard ! – la propriétaire. Et elle décréta tout aussi impérieusement que c’est sur ce piano de rencontre que Chopin avait entrepris la composition des Préludes. Enfin, pour appuyer bien fort sur la pédale romantique, un peu comme dans les magazines pour dames ou sur les pochettes de disques de « musique de charme », on déposa artistiquement une rose sur le clavier. Une touche d’un sentimentalisme de pacotille censée attester sans doute que l’instrument était bel et bien celui joué par Chopin avant l’arrivée du Pleyel. Le pire, c’est que dans la cellule n°4, on fera de même sur le piano authentique. Mièvrerie et mauvais goût n’ont pas de camp ! De part et d’autre de surcroît la rose était accompagnée par un drapeau polonais frappé de l’aigle couronnée, ce qui fait aussi son effet sur les âmes sensibles.
La supercherie perdure
Comment cette supercherie a-t-elle pu perdurer aussi longtemps en dépit des preuves qui s’accumulaient pour la dénoncer ? Déjà, en 1965, la musicologue polonaise Krystina Kobylanska, conservatrice du Musée de la Société Chopin, à Varsovie, s’indignait que l’on fît passer le piano et la cellule n°2 pour ce qu’ils n’étaient pas.
C’est qu’en Espagne, on se moquait éperdument de l’authenticité d’un piano et d’une cellule monacale, de ce qui relève de la vérité historique. C’est aussi qu’il est plus commode de croire à la version que veulent asséner ceux qu’elle arrange, quand ils sont localement influents. C’est que la justice, dans un pays où longtemps a régné l’arbitraire le plus absolu, est une chose toute relative. Et qu’elle est plus aimable avec les gens en place. Et l’avènement de la démocratie avec le rétablissement de la monarchie n’a pas changé en un jour les vieilles mentalités.
De Chopin au football
La señora Capllonch-Ferra, forte de sa situation de présidente et de fille de directrice du Festival Chopin de Valldemosa (très modeste festival, mais sujet de fierté locale et financé officiellement par la Communauté des Baléares) ; forte aussi de ses relations anciennes avec les sociétés Chopin du monde entier, et de celles entretenues avec la myriade de pianistes invités dont on prit bien évidemment soin ; forte enfin de l’appui de son frère, ex-président des fans du Club royal de football de Mallorca… la dite señora avait tout pour faire pencher la balance de son côté.
Après moult procès perdus et vaines démarches depuis les années 1930 pour rétablir la vérité, il aura fallu que Gabriel Quetglas, excédé par la mauvaise foi de la partie adverse et l’impunité garantie au mensonge, trouvât un nouvel angle d’attaque : il porta cette fois plainte pour publicité mensongère en pointant du doigt le panneau qui présentait le piano de la cellule n°2 comme étant le pauvre piano majorquin. Et il aura ensuite fallu une juge lucide et courageuse pour confondre enfin les mystificateurs, avec à l’appui expertises, documents, témoignages et relevés topographiques. Voilà la partie adverse sommée par décision de justice de retirer l’inauthentique piano de la cellule n°2, et interdite de faire croire, de quelque façon que ce soit, que celle-ci abrita Chopin.
Aujourd’hui le faux piano est passé dans la clandestinité. Et il n’est plus claironné qu’il fut l’instrument majorquin sur lequel aurait composé Chopin. En revanche rien n’indique clairement que la cellule n° 2 n’est pas du tout celle où vécurent Frédéric Chopin, George Sand et ses enfants. Au visiteur interloqué de découvrir deux lieux où Chopin aurait séjourné, le personnel du musée évacue le problème en marmonnant avec une monumentale mauvaise foi que l’on n’a jamais clairement établi lequel était le vrai. Malgré des preuves irréfutables, malgré un jugement et sa publication, à la Chartreuse de Valldemosa, comme dans nombre de guides de tourisme, on cultive sciemment un flou artistique, pour ne pas en dire davantage.
A lire aussi: Mettre ses vacances à profit pour (re)lire Adolfo Bioy Casares
Comme rien n’est clairement indiqué à l’entrée de l’ancien monastère, bien des visiteurs ne découvrent qu’au sortir de la n° 2 la cellule n° 4, située plus loin de la porte principale. Sans rien affirmer de précis, on leur a laissé croire que le n° 2 était bien celle où avait vécu Chopin. Il leur faut alors acquérir un billet supplémentaire pour découvrir le vrai piano, le Pleyel, au cœur de la cellule où le musicien et la romancière ont réellement séjourné, ainsi que les collections qu’elle renferme, plus riches que celles qui trônent chez l’ennemi. Ce qui réduit bien évidemment le nombre de visites qui seront effectuées dans l’authentique séjour et laisse à penser que les tensions sont toujours aussi vives entre les clans, entre le vrai et la faux.
En extase devant une fraude
Qu’en est-il des parts confortables que touche le clan Ferra-Capllonch sur les billets d’entrée (entre 200 000 et 300 000 d’euros par an, semble-t-il) délivrés à la Chartreuse pour 12,50 euros, tarif ordinaire de visite, mais pouvant osciller entre 8,50 euros pour les étudiants et 18,50 euros pour les « privilégiés » ? Elles s’élèvent, ces parts, à 23,75% du prix de chaque billet car à la cellule où Chopin n’a jamais séjourné s’ajoutent l’ancienne pharmacie des religieux et une imprimerie que possède aussi le clan. Le propriétaire de l’authentique piano et de la cellule n° 4, lui, est censé en percevoir 11%.
Au sein de la Chartreuse, tout comme dans un piano-bar d’hôtel défraîchi, cinq fois par jour durant 15 minutes, un malheureux pianiste d’animation saccage sans conviction les partitions de Frédéric Chopin devant une poignée de touristes tout frémissants à l’idée de plonger au cœur du Romantisme. Et en août, les propriétaires de la cellule no 2 relancent leur très modeste Festival Chopin depuis longtemps fort surévalué. Il accueille cette année la pianiste bulgare Dina Nedeltcheva (les 8 et 10 août) et le Polonais Mateusz Dubiel (les 23 et 24 août). Honorable affiche certes, mais bien succincte pour une manifestation qui se pare du titre ronflant de « festival » et qui ne constitue rien d’autre qu’un événement d’intérêt local.
Dès le jugement rendu au tribunal de Palma à l’aube des années 2010, un journal majorquin, brisant enfin l’omerta, avait perfidement diverti ses lecteurs en publiant les photographies d’innombrables personnalités, depuis Franco jusqu’à la reine Sophie, toutes posant devant le faux piano. L’ensemble étant titré : « Extasiados frente a un fraude ». (En extase devant une fraude).
[1] Ce pauvre piano majorquin, comme le définira George Sand, avait été loué à une famille de Palma. D’abord installé dans la maison de So’n Vent d’où Chopin et George Sand furent méchamment expulsés quand on apprit que le Polonais était phtisique, il sera transporté à Valldemosa et déposé dans la pièce principale de la cellule n°4. Revenu à ses propriétaires de Palma, c’est ce piano qui semble avoir été vendu en 1913 à la grande claveciniste Wanda Landowska comme étant celui sur lequel avait un temps travaillé Chopin. Exposé en 1937 à la Bibliothèque polonaise, à Paris où résidait Wanda Landowska, il est aujourd’hui aux Etats-Unis où l’artiste polonaise, fuyant la France occupée par les nazis, trouva refuge et mourut.
[2] L’emplacement du clocher de la Chartreuse, tel qu’on le voit apparaître sur ce dessin de Maurice Dudevant, a permis de comprendre que ledit dessin ne pouvait avoir été exécuté que du jardin de la cellule n°4 ou, à la rigueur, de l’extrême angle de celui de la n°3. Le recueil de dessins qui était la propriété d’Aurore Sand, la petite-fille de Maurice, a été racheté par les propriétaires… de la cellule n°2. Lesquels détiennent ainsi la preuve irréfutable que ce n’est pas de leur cellule qu’a été effectué ce dessin et partant que celle-ci n’a jamais abrité Chopin et Sand. Chose dont on ne fait évidemment pas étalage devant les visiteurs.
[3] A leur départ de Majorque, Chopin et Sand vendirent le pianino Pleyel à une Française, Hélène Choussat, mariée au banquier de Palma Canut, banquier par qui transitait l’argent envoyé de Paris aux deux artistes. A la mort d’Hélène, le piano passa à son fils, à la femme de celui-ci, au neveu de cette dernière, puis au grand-oncle de son actuel propriétaire, Gabriel Quetglas. Il fut en 1932 réinstallé à la Chartreuse, quand la cellule n° 4 fut ouverte au public.