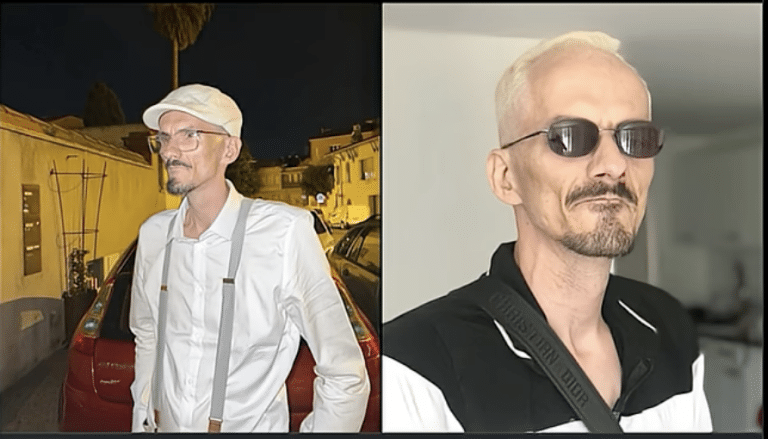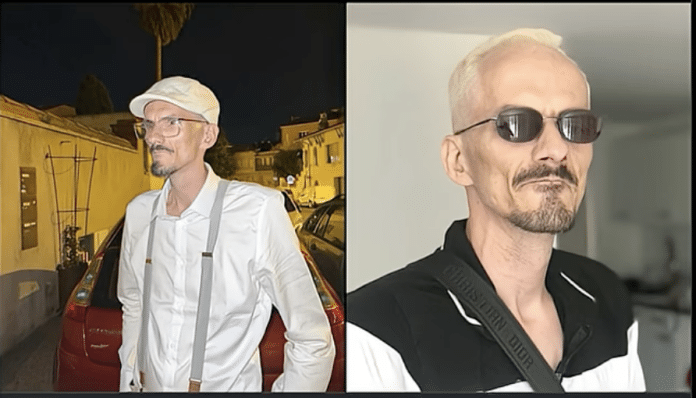Les relations entre la France et l’Algérie restent d’une brûlante actualité. Pour comprendre cette histoire commune, le livre de Colette Zytnicki, qui relate la conquête de l’Algérie par la France entre 1830 et 1848, constitue un excellent point de départ. Il vient d’être réédité.
Sujet toujours brûlant ! Spécialiste de l’histoire coloniale, auteur en outre d’une étude sur Les Juifs du Maghreb, l’historienne Colette Zytnicki s’attaque à la façon dont, entre 1830 et 1848, « les Français ont pris possession de l’Algérie » : les prémices de la colonisation, d’où naîtra cette Algérie « partagée en trois départements […], arrimée au socle français qui s’étend jusqu’aux rives sud de la Méditerranée ». Essai passionnant, paru il y a trois ans, à présent réédité par Tallandier, dans sa collection Texto. Son titre : La Conquête.
Une terre de colonisation
De la « régence d’Alger » comme on nommait alors ce vaste territoire mal connu, à l’éclosion de « l’Algérie française », donc. Ou « Comment les Français ont pris possession de l’Algérie, 1830-1848 » ( c’est le sous-titre). De fait, si l’épisode colonial a, comme l’on sait, duré 132 années, la conquête de cette « province de l’empire ottoman […] progressivement émancipée de cette tutelle » s’est faite en près de vingt ans. Mais « Il faut inscrire l’expédition de juillet [1830] dans une histoire plus large […] pour saisir ce qui s’est joué ensuite : l’expédition s’est transformée en occupation (1830) puis en prise de possession (1831-1834) et finalement en appropriation (1835-1848) », observe Colette Zytnicki. L’historienne s’attache donc, pour commencer, à restituer le contexte dans lequel interviennent les bouleversements culturels induits par ce qu’elle ne craint pas d’appeler « la Tempête » : celle provoquée par l’invasion française, à l’aurore de la Monarchie de Juillet, renversant un monde essentiellement rural, où le pouvoir se transmettait parmi les membres d’une caste ottomane. Un monde dans lequel coexistent, à Alger – à peine 30 à 35000 âmes en 1830 ! – janissaires, Juifs (venus d’Espagne pour l’essentiel), mais aussi… esclaves chrétiens ! Et à la campagne, Bédouins des plaines, Berbères ou Kabyles dans les montagnes… C’est bien « ce monde qui va être, progressivement, du Nord au Sud, bouleversé par la guerre et la présence française dans ses structures les plus profondes ».
Pourtant, Colette Zyrnicki ne manque pas de le souligner : depuis longtemps déjà « l’idée que conquérir le pays barbaresque peut être une œuvre civilisationnelle se fraie peu à peu son chemin parmi les esprits les plus éclairés ». Aussi bien l’Algérie deviendra « pour des courants socialistes, un lieu d’expérimentation, une terre où ils diffusent leur message civilisateur et émancipateur. Ce qui fait d’eux, paradoxalement, de zélés propagandistes de la colonisation ».
À lire aussi : Awassir: la cinquième colonne d’Alger
L’idée flottait depuis longtemps dans l’air : Napoléon, en 1808, envisage déjà d’envahir le pays. Dans un climat de plus en plus tendu, au début du XIXème siècle, survient la symptomatique affaire Bacri-Busnach, du nom des marchands juifs livournais en délicatesse avec les autorités du royaume, pour une dette jamais soldée, au cœur de la guerre commerciale franco-britannique : « le négoce du blé a pu jouer le rôle d’une mèche lente menant à la détonation que fut l’expédition française de 1830 ». Effectivement, « les sources de conflits s’amoncellent après 1815 ». En 1816, la flotte britannique bombarde Alger. Les Etats européens rechignent à verser, en échange de la paix, leurs tributs aux deys d’Alger. Puis c’est la fameuse scène du coup d’éventail, en avril 1827 : le chasse-mouche exagérément agité du dey ayant outragé le consul Deval, la France instaure le blocus des côtes algéroises. Piano piano l’argumentaire se met en place, « alors défendu par ceux-là mêmes qui sont les plus ardents critiques du système colonial et de l’esclavage, les penseurs libéraux ». Parmi eux, l’économiste Jean-Baptiste Say. « Le gouvernement de Charles X […] met plus de trois ans avant de se lancer dans l’aventure ». Phase attentiste, qui se dénoue avec la canonnade de l’escadre française dans la rade d’Alger : « le gouvernement tient là le prétexte d’une expédition ». D’autant que, de l’autre côté de la Méditerranée, la Régence est en crise : entre 1808 et 1915, sur sept deys successifs, six meurent assassinés à Alger ! En 1830, Hussein dey, « homme cultivé et sage », préserve encore un fragile équilibre. Mais l’instabilité politique chronique de ce pouvoir « jugé tyrannique et barbare » justifie l’intervention militaire. On y embarque des artistes, tel Eugène Isabey. Hussein capitule le 5 juillet. La prise d’Alger – moins de trois semaines avant la chute de Charles X ! – met à bas tout « le système politique sur lequel reposait la Régence, avec le départ de ce qui en était la pierre de touche : le dey et la milice turque ».
Colonisation et occupation violente
La Conquête narre sans parti pris les premiers temps de l’occupation : pillages, confiscation du trésor beylicale, mais aussi hécatombe de nos troupes par les maladies. Tandis que le duc d’Orléans accède au trône, « une autre histoire commence ». En Algérie, « non seulement les Français ont détruit en quelques jours l’appareil administratif ottoman, mais ils se sont coupés des élites politiques et des outils de gestion qu’elles détenaient ». D’où bien des tâtonnements. La défunte Régence cède la place aux très officielles « Possessions françaises dans le nord de l’Afrique ». Sous l’autorité du général Clauzel, Alger est réorganisé selon nos conceptions architecturales, les rues sont renommées, les maisons numérotées. S’ouvrent boutiques, cafés, hôtels, « instaurant une sociabilité à la française bien éloignée des habitudes locales » ; et même établissements scolaires, où affluent surtout les enfants juifs, « au grand dam de l’administration française ». En quatre ans se met en place ce « vaste mouvement de spoliation dont les effets se sont fait sentir jusqu’au milieu du XXème siècle », la dépossession se jouant aussi dans les campagnes : « la pratique du terrain [amène] à bafouer sans arrêt les intentions civilisatrices proclamées », reconnaît l’auteur. Entre « accommodement et résistances », pour reprendre l’intitulé d’un des chapitres, émerge la figure mythique d’Abd el Kader, au moment même où se met en place, non seulement « l’Algérie française » mais, il faut le dire, l’Algérie tout court : « il faut attendre le 14 octobre 1839 pour que cette dénomination [ Algérie] devienne la règle dans les actes officiels » ! L’Algérie est bel est bien une création française.
Oscillant entre deux modèles, le cadre administratif ne s’organise pas d’un seul bloc : Constantine, conquise en 1837, fait appel à la responsabilité des féodaux alliés à la France, ce au prix de nombreuse révoltes ; à Bône (l’actuelle Annaba) prévaut au contraire l’administration directe, par l’armée et les fonctionnaires. L’« extension du domaine de la guerre » instaure parfois « un régime de terreur », tel celui qu’impose le mamelouk Yusuf, cet esclave affranchi qui, «devenu une figure populaire en France […] épouse une chrétienne, Pauline Weyer, se convertit et est nommé général » ! En 1840, nos troupes comptent 59000 soldats dans un pays « dans un état d’insécurité permanant » où les colons ne cessent d’affluer. Au bout d’une dizaine d’années d’occupation, les Européens n’en restent pas moins une infime minorité « dans une Algérie encore bien mal connue d’eux, rassemblés dans les villes et dans quelques rares villages ». L’auteur rappelle à bon escient que « les Français y sont minoritaires et nombreux sont les Espagnols, venus surtout des Baléares, des Maltais, des Italiens et des Allemands ». « Les conquêtes sont une affaire d’hommes, de militaires, de fonctionnaires et de marchands, voire de gens d’Eglise ». Peu de femmes, donc – et pas de mariages, ou presque, entre européennes et autochtones, musulmans ou juifs. « Plus nombreuses sont les liaisons extraconjugales ». S’impose pour les colons la nécessité de scolariser leurs enfants. Si le projet d’assimilation à travers une école « franco-maure » s’avère un échec, les Juifs rompent avec « la tradition pluriséculaire qui réserve la scolarisation aux garçons » et scolarisent les filles, marquant une assimilation précoce au modèle français (bien avant le décret Crémieux de 1870 conférant la citoyenneté à tous les Juifs d’Algérie), dans un contexte où « malgré le mépris qu’ils leur vouent », note Colette Zytnicki, « Français et élites autochtones se sentent dans l’obligation d’utiliser les Juifs […], minorité religieuse appliquée à trouver sa place dans une société bouleversée ». Nonobstant, un courant arabophile se développe dans l’armée, en particulier chez ces officiers « pétris de saint-simonisme ou de fouriérisme », rêvant « de faire de l’ancienne Régence le lieu idéal d’expérimentations sociales audacieuses ». Un Prosper Enfantin en appelle même à la fusion des « races » (sic) « entre colons et autochtones » ! « L’impact du socialisme sur l’invention de l’Algérie française est déterminant », observe l’historienne, au rebours de l’idée reçue sur une supposée connivence ontologique de l’extrême-droite avec l’entreprise coloniale.
À lire aussi : Sétif, 8 mai 1945 : l’Amérique subversive
Reste que l’« appropriation » de l’Algérie par la France s’est faite dans la plus extrême violence. L’Armée d’Afrique, comme on l’appelait alors, (100 000 hommes en 1846, dont ceux de la Légion étrangère, créée comme l’on sait en 1831) affronte des tribus déterminées à opposer une résistance farouche à l’envahisseur. S’ensuivent razzias, « enfumades », massacres, exactions (d’ailleurs dénoncées en France par l’opposition) dans « une guerre de plus en plus ensauvagée ». Si l’ordonnance du 15 avril 1845 divise administrativement le pays en trois provinces – Alger, Constantine et Oran – le Sud et la Kabylie demeurent durablement des zones insoumises. Interné à Toulon puis à Pau, libéré en 1853, Abd El Kader finira par s’exiler à Damas. Assigné à résidence à Alger, Ahmed, le bey de Constantine, y mourra en 1850… Le « vieux monde algérien » est clos, mais « l’assimilation aux normes françaises », dont la colonisation agricole est un des aspects, s’opère de façon progressive : on dénombre 109 000 colons en 1847.
Apprendre à cohabiter
Les derniers chapitres de l’ouvrage décrivent cette « cohabitation » avec les « indigènes » dans les cités algériennes en mutation accélérée. A Oran, ville de garnison, la rue Napoléon devient « le lieu de flânerie préféré des habitants européens […] faisant ce qu’ils appellent « la noria » ». A Alger, dans un décor de plus en plus européanisé, « il faut imaginer cette population se côtoyer dans les rues, le paletot noir du colon frôlant les haillons des portefaix algérois, les voiles des femmes de la casbah ou la crinoline de l’épouse d’un fonctionnaire ou d’un militaire, le tout dans un mélange de langues, arabes, kabyle, catalan des Baléares, allemand ». Cet « Orient à deux jours de la France » devient un lieu de fantasme exotique : Gautier, Dumas font le voyage. « Un topos de la littérature se met à fleurir très tôt, celui d’un Orient gâté par l’Occident », tandis qu’une administration civile remplace le « régime de sabre », dans une ambiguïté « qui sera la marque même de l’Algérie, à la fois territoire français […] et colonie dotée de lois particulières »… Ainsi Tocqueville lui-même n’est-il « pas favorable à une assimilation totale de l’Algérie à la France »…
De l’allégeance à la Sublime Porte à l’élaboration de cette nouvelle société coloniale, dix-huit ans à peine ! Utilement illustré de cartes, agrémenté d’un glossaire qui vous apprendra ce qu’est un « goum », un « khammès » ou un « khodja », pourvu d’un index alphabétique des « acteurs » du drame – d’Eugène Cavaignac au duc de Dalmatie, en passant par Clauzel ou Danrémont – ce volume ranime la mémoire d’une guerre que le traumatisme de la Guerre d’Algérie a contribué à effacer : celle, précisément, de cette « Conquête » à laquelle ce pays doit son existence, et jusqu’à son nom !
À lire aussi : Mieux vaut tard…
Achevée la lecture de ces quelques 300 pages, votre serviteur retombe par hasard sur Jusqu’au bout du monde, volume courageusement édité en 1963 par La Table Ronde. Le célèbre avocat Jacques Isorni, ardent défenseur de l’Algérie française, y règle ses comptes avec De Gaulle. Il invoque « la nécessité de défendre militairement et jusqu’au bout une parcelle de territoire. […] Car, assure-t-il, on ne se battait pas pour la forme d’un régime mais pour les frontières d’une nation. Cette mauvaise guerre finit par créer à la longue la nation algérienne alors que ceux qui l’entreprirent ne l’avaient déclarée que parce qu’ils croyaient posséder déjà cette nation ». Pas loin d’un siècle et demi a passé ; la boucle se referme sur cette Algérie perdue – à tous les sens du terme. En 2025, à quel obscur « empire » appartient l’Algérie dite « indépendante » ?
Dans un chapitre de son passionnant essai paru en 2024, Je souffre donc je suis, Pascal Bruckner évoque « la névrose française de l’Algérie », le régime algérien n’en finissant pas de s’octroyer « vis-à-vis de l’Hexagone une créance illimitée, [escamotant] les atrocités commises par les Algériens eux-mêmes durant leur lutte de libération, [ évacuant] l’usage du terrorisme au nom d’Allah », ou encore « le massacre abominable des harkis coupables de trahison et l’expulsion brutale des pieds-noirs au nom du principe « la valise ou le cercueil’’. Oubliées également, poursuit Bruckner, la corruption et la dictature de l’Etat FLN à partir de 1962, la répression du mouvement kabyle et plus récemment du Hirak entre 2019 et 2021, sans négliger la guerre civile atroce (1991-2002) qui fit au moins 150 000 morts, même si cette guerre, risque-t-il, nous a évité l’instauration d’une république islamique à une heure d’avion de Marseille ».
Ce « doigt vengeur » durablement pointé sur la France « ne sert qu’à raviver la dette inextinguible que Paris aurait contractée à l’égard de son ancien département ». De fait, « Alger ne semble pouvoir exister sans diaboliser la France, l’adversaire éternel autant qu’indispensable », alors même que « c’est en France que les dissidents algériens se réfugient, c’est vers la France, la marâtre autant honnie que désirée, que la jeunesse algérienne se tourne, gourmande de visas ».
Pour paraphraser qui vous savez, la « rente mémorielle’’ n’est rien d’autre que la poursuite de la guerre par d’autres moyens. La Guerre d’Algérie aura-t-elle jamais une fin ?
La Conquête. Comment les Français ont pris possession de l’Algérie. 1830-1848. Essai de Colette Zytnicki. Coll. Texto. 333p., Editions Tallandier, 2022/2025. En librairie à partir du 28 août.
Je souffre donc je suis. Essai de Pascal Bruckner. Grasset, éd., 2024, 320p.