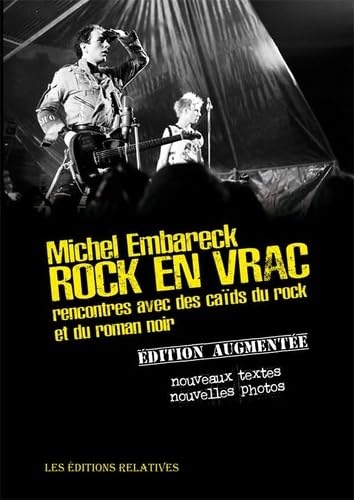Dans Vagabondages et Conversations, le célèbre paysagiste et jardinier français Gilles Clément est mis en scène par et avec l’artiste autrichien Christian Ubl.
Longtemps les chaisières des jardins publics et les gardiens de square à l’œil torve ont vu en Gilles Clément bien pire que l’Antéchrist. Car il a a bouleversé sans pitié leur univers propret et désespérant de pelouses sages et de plates-bandes immuables, figées dès la funeste naissance de la Troisième République pour l’agrément des sénateurs-maires radicaux et des sous-préfets boulangistes.
Fantaisie et joie de vivre
On doit à Gilles Clément d’avoir conjuré la terrible malédiction qui frappait depuis des décennies les jardins publics, leur parterre central immanquablement circulaire, leurs régiments de glaïeuls raides comme des Prussiens montant la garde autour d’un buste de notable à la barbe fleurie et obligatoirement entourés de bordures de bégonias roses comme de grasses Bavaroises en mal de mari.
On lui doit d’avoir condamné la bête monotonie des pelouses uniformes, aussi pathétiques que la moquette d’un salon de petits bourgeois étriqués. D’avoir honni les insecticides et autres pesticides dangereux. D’avoir rendu aux fleurs des parterres leur fantaisie et leur joie de vivre en les lançant dans de joyeuses sarabandes. D’avoir remplacé la dignité ennuyeuse d’immuables ornementations végétales par la nonchalance poétique et la créativité inépuisable de la nature. D’avoir exorcisé enfin l’esprit mesquin du fonctionnaire qui, aussi sûrement que le puceron ou la cochenille, ravage les espaces verts ainsi lamentablement nommés dans le jargon des municipaux sous l’effet de ce souffle épique propre aux administrations.
L’éloge des vagabondes
Gilles Clément a ouvert les grilles des jardins à la folie aimable des graminées, à la fantaisie de végétaux improbables, à la cohabitation d’espèces à qui on interdisait de se côtoyer, comme jadis lorsqu’on rappelait sèchement à l’ordre les enfants de milieux sociaux trop disparates dès qu’ils faisaient mine de vouloir jouer ensemble.
Foin des interdits, des prérogatives de la naissance, de la noblesse des origines, de la sagesse bourgeoise : les jardins en mouvement de Gilles Clément sont des mondes ouverts à tous les végétaux, du moment qu’ils cohabitent pacifiquement. Ils chantent « l’éloge des vagabondes », c’est à dire qu’ils accueillent, plutôt que de les arracher, ces plantes qu’emportent les vents lointains et qui s’installent par surprise, mais avec bonheur là où l’on ne les avait jamais vues. Et bien évidemment, cet hymne de liberté et de métissage que susurrent les réalisations de Gilles Clément, au domaine du Rayol, dans le parc André Citroën, dans les jardins du musée du quai Branly, à Saint Nazaire ou ailleurs dans ses livres, cet hymne prend immanquablement un ton politique. Ses jardins se font les chantres de la mixité heureuse, de l’égalité des origines. Sans pour autant cautionner les invasions périlleuses et massives, sans renoncer à l’harmonie d’une cohabitation apaisée et harmonieuse.
Dans un monde inattendu
Et voilà que lui aussi, à l’image de ces vagabondes qu’il a défendues toute sa vie, voilà que Gilles Clément se retrouve implanté dans un monde où personne à priori ne l’aurait attendu. Et lui moins que tout autre. Au cœur d’un spectacle chorégraphique imaginé par un Autrichien installé en France, Christian Ubl, lequel a lu ses ouvrages et s’est reconnu sans doute comme l’un de ces végétaux aventureux qui comptent parmi les héros du jardinier-paysagiste.
Par ses réalisations autant que par ses nombreux écrits, Gilles Clément s’est fait d’innombrables disciples. On le voit partout aujourd’hui, dans les villes particulièrement, et singulièrement à Paris où les végétaux se multiplient sous une apparence informelle et bohême qu’on ne leur avait jamais connue dans l’univers urbain.
Ensemble, maître et disciples, ont partiellement vaincu les résistances les plus acharnées à leur discours écologique et libertaire. Ils ont transformé les cités, mais aussi le regard et la sensibilité de ceux qui y vivent.
Le jardin en mouvement
Tout est né sans doute avec la révolution du « jardin planétaire », tel qu’il a été imaginé par Gilles Clément dans le parc André Citroën, en collaboration avec Alain Provost.
« A l’époque de la création de ce premier jardin en mouvement, souligne Gilles Clément, les commanditaires de la Ville de Paris n’y croyaient pas trop. On tentait une expérience avec l’idée qu’on reviendrait vite aux anciennes pratiques en vigueur dans les jardins publics. Or la réaction des riverains comme des promeneurs a joué à plein en faveur du jardin. Nostalgiques d’un monde qu’ils avaient connu naguère, ils ont dit avoir retrouvé là quelque chose d’un univers encore naturel, sinon sauvage, rendant la ville plus aimable. On ne s’attendait pas à une telle adhésion. Et le jardin a ainsi conservé l’essentiel de son nouveau caractère ».
Même chose avec les révolutions écologiques du jardin du Musée des Arts premiers, au quai Branly, ou des Jardins du Rayol sur la côte varoise. Un changement radical dans la conception des jardins était en marche. Et il était irréversible.
Moi, je ne suis pas danseur !
« C’est lui, Christian Ubl, qui un jour m’a demandé de considérer son travail en compagnie d’une danseuse australienne dans une pièce qu’ils avaient baptisée AU-AU pour Autriche et Australie. Ils désiraient qu’un regard extérieur se porte sur l’évolution du spectacle. Des liens d’amitié se sont ainsi créés et qui ont perduré. Il y a un peu plus d’un an, Christian Ubl a proposé qu’ensemble, lui et moi, nous participions à un nouveau pectacle, « Vagabondages et Conversations ». Drôle d’idée, non ? Moi, je ne suis pas danseur. Cà m’a fait rire. Mais le projet a fini par me séduire quand j’ai réalisé que tout cela avait un sens et que la production basée sur les conceptions que je défends nous permettait de toucher et de convaincre peut-être un public tout autre que celui que je connaissais. Gestuellement, j’interviens très peu. En revanche, je demeure tout le temps sur le plateau, soit pour lire des textes que j’avais rédigé, soit pour en dire d’autres, de mémoire, soit pour les écouter en voix off, comme celui qui évoque l’importance de l’eau dans le cycle de la vie. La chorégraphie, à laquelle je prends part parfois, suit mes propos. Moi qui n’avais jamais imaginé cette possibilité de toucher un public nouveau ».
La végétation à Pompéi
Gilles Clément prend aussi conscience de l’extrême exigence et de la rudesse de la vie d’artiste. «Cette activité artistique prend beaucoup de temps. Pour honorer chacune des représentations, un soir ici, un soir là, données à des dates éparpillées dans le temps, il faut être mobilisé trois jours pour chacune d’entre elles. Un jour consacré au voyage pour se rendre sur le lieu du spectacle. Un autre pour assurer les répétitions, l’adaptation à un nouveau plateau et pour le spectacle lui-même. Et un troisième pour retourner là où j’ai à travailler. C’est lourd. Et difficilement conciliable avec mes autres activités ».
S’il se multiplie désormais dans ses fonctions de professeur et de conférencier qui lui font sillonner le monde à l’instar de ces plantes dont il s’est fait l’avocat, Gilles Clément ne crée plus guère de nouveaux jardins, excepté le sien, niché en pleine campagne, dans un département sans ville, la Creuse, qui fut jadis le comté de la Marche. Mais bientôt peut-être, il sera à Pompéi, dans le cadre d’un projet porté par des spécialistes italiens et concernant la végétation qui s’épanouissait dans les cités de l’Antiquité romaine.
Vagabondages et Conversations
Avec Gilles Clément et Christian Ubl.
Le 7 juin 2025, Festival June Events. Atelier de Paris-Carolyn Carlson, Cartoucherie de Vincennes.
Le 3 juillet, Festival Mimos, Théâtre de l’Odysée, Périgueux.
Le 18 novembre, Théâtre Au Fil de l’eau, Pantin.
Le 23 novembre, Théâtre de Suresnes.
Les 27 et 28 novembre, Théâtre du Briançonnais, Briançon
Les 2 et 3 décembre, Théâtre Durance, Château-Arnoux.
Le 30 janvier 2026, Théâtre de Fontenay-le-Fleury.
Le 7 février, Théâtre de l’Arc, Le Creusot.
Le 7 mai, Théâtre de l’Etoile du Nord, Paris.
Le 21 mai, Zef, Marseille.
En mai 2026 encore au Théâtre Molière, à Sète.