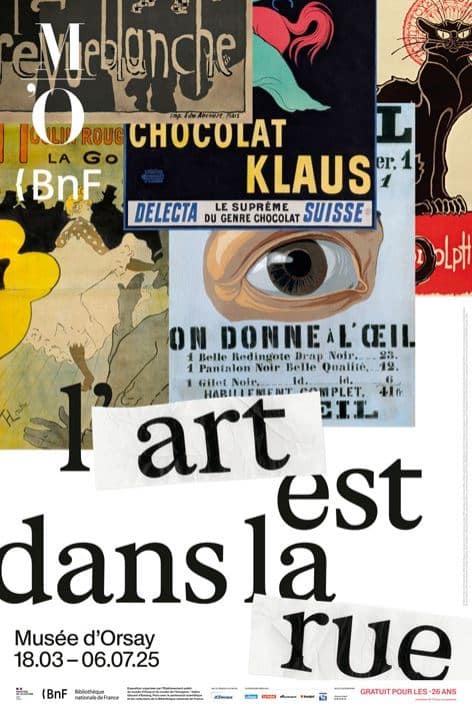Frère méconnu de Napoléon Ier, père du futur Napoléon III, Louis Bonaparte est longtemps resté une figure pâle de l’épopée impériale. François de Coustin redonne chair à ce « roi rebelle et mélancolique », tiraillé entre sa loyauté familiale, ses aspirations contrariées et une santé déclinante.
Le père de Napoléon III est un oublié de l’histoire. À Luigi, ce petit frère d’abord tant chéri puis si mal-aimé de l’ Empereur, né en 1778 de Carlo Maria et de Letizia Buonaparte, François de Coustin consacre une biographie magistrale. Louis Bonaparte voit le jour derrière Giuseppe (Joseph, 1868), l’aîné des enfants, puis Napoleone (1769, mort en bas âge), Luciano (Lucien, 1775), et Maria-Anna (Elisa, 1777). Après lui naîtront Paolina (Pauline, 1780), Maria-Anunziata (Caroline, 1782) et enfin Girolamo (Jérôme,1784), le petit dernier.
Un homme mal dans sa peau
Celui qui, de son union mal assortie avec la reine Hortense, donnera le jour au souverain du Second Empire, a traversé l’épopée du Premier Empire et les années consécutives à sa chute en personnage d’arrière-plan, balloté par des événements sur lesquels il n’est jamais parvenu à imposer sa marque. Au-delà du récit passionnant de cette existence en somme assez pathétique, le livre restitue – et c’est ce par quoi il dépasse de très haut la simple visée anecdotique – le contexte géopolitique dans lequel l’incroyable saga familiale, sous la férule de Napoléon, se cristallise.
François de Coustin le souligne, les enfants Buonaparte sont nés de parents très jeunes : en 1764, date de leur mariage, Charles a dix-huit ans, Letizia quatorze ! L’ascendant porté par le génie de Napoléon sur ses frères et sœurs se manifeste très tôt. Car Charles meurt en 1785. Et Marbeuf, l’ancien amant de Letizia, qui est aussi le parrain de Louis, décède à son tour en 1786. Parti faire ses études sur le continent, Napoléon, dès 1791, « dans un pays en pleins troubles révolutionnaires » prend en charge l’éducation de son cadet alors âgé de douze ans-et-demi, l’emmenant avec lui, supervisant ses fréquentations, intriguant pour pousser ses études, et bientôt sa carrière d’officier. Propulsé à la tête de l’armée d’Italie, le général Bonaparte en fait son aide de camp. Mais « les infirmités physiques de Louis commencent à se manifester » de bonne heure. « Personne ne pense aux conséquences d’une chute de cheval oubliée de tous ». C’est pourtant là, semble-t-il, l’origine de sa santé défaillante ; elle ne cessera de se délabrer au fil des années. Louis usera et abusera des cures pour tenter, en vain, d’éradiquer la paralysie qui envahit son corps. En proie à des affections rhumatismales et autres douleurs articulaires toujours plus incommodantes, Louis se verra privé progressivement de l’usage de sa main jusqu’à ne plus pouvoir écrire, puis seront atteints ses membres inférieurs. « Ce malade qui se voyait en danger de mort en permanence » sera pourtant, avec son cadet Jérôme, le dernier survivant des Bonaparte de sa génération (Elisa meurt en 1820, Pauline en 1825, Madame mère en 1836, Caroline en 1839, Lucien en 1840, Joseph en 1844). Dès 1839, Louis, grabataire, « se servait difficilement de ses bras et ne marchait […] que soutenu sous chaque bras par un domestique ». On lui suppute aujourd’hui une sclérose en plaques. Sous le nom de comte de Saint-Leu, âgé de 67 ans, Louis Bonaparte rend son dernier soupir le 25 mai 1846. En 1837, la reine Hortense l’avait précédé dans l’au-delà.
À lire aussi : Les Bourbons dans leurs ultimes fastes: le sacre de Charles X
Conté par François de Coustin dans un luxe de détails fascinant, ce récit palpitant scande les étapes de la vie du « roi rebelle et mélancolique », pour reprendre le sous-titre de cette ambitieuse biographie de plus de 600 pages, la première, à ma connaissance, exclusivement consacrée au seul Louis Bonaparte. Mais aussi bien la prose érudite, limpide et acérée de l’émérite historien recolore pour nous, au fil des pages, le paysage géopolitique, sociologique, mondain du temps, avec une extraordinaire puissance d’évocation.
Un pion dans les ambitions de Napoléon
Rembobinons : l’emprise de Napoléon sur sa fratrie grandit à la mesure de sa gloire naissante – Arcole, Rivoli, campagne d’Egypte… Longue réticence de Louis à épouser Hortense de Beauharnais ; fréquentation des salons (Germaine de Staël) par un garçon qui à l’instar de ses frères, « taquine la plume » et qui, vite « mal à l’aise d’y être traité comme le frère du Premier consul et non pour lui-même, fuit la société »… Décrit par un ami comme « fort brun, fort velu » avec « beaucoup d’embonpoint », Louis, à 22 ans, en paraît 27 ! Ce « cœur incertain » – pour reprendre le titre d’un des chapitres du livre – est surtout celui qui, sa vie durant, ne sera jamais qu’un pion dans les ambitions sans limites de Napoléon, capable de lui écrire, tout de même : « vous ne sauriez être indépendant, je ne le souffrirai pas ».
Dans leurs tardifs Mémoires « écrits bien après leur acrimonieuse séparation », Louis, comme Hortense, décrivent leur vie conjugale comme un enfer de tous les instants. Ils parviendront pourtant à faire trois enfants. Mari irascible, ombrageux, maladroit, jaloux, Louis souffre qu’Hortense soit systématiquement soutenue contre lui par Napoléon, à l’autorité duquel il se soumet à son corps défendant, plus impérieuse à mesure que s’accroît sa puissance : « je hais la grandeur, le faste, les distinctions, les décorations, etc. […] Je tiens tout de mon frère […] La nation doit fournir à ses chefs, mais non à ceux qui n’ont de commun avec eux qu’un nom donné par le hasard », confesse Louis à Mésangère, son ami de cœur.
Nommé général de brigade à son corps défendant en 1801 par son frère consul, il démissionne – avant de se raviser. Devenu empereur, obsédé par la continuité dynastique, seule capable à ses yeux de de sédimenter son pouvoir, Napoléon a retiré la succession du trône à ses frères, et Joseph ne pouvant avoir d’enfant, il la remet entre les mains du premier fils de Louis et d’Hortense, le petit Napoléon-Charles, la stérilité de Joséphine aidant à faire de ce dernier le « centre de toutes les attentions ». Piétinant les droits légitimes de ses frères, Napoléon, pragmatique, a réglé la question par le sénatus – consulte instaurant l’Empire héréditaire, un article prévoyant que « Napoléon peut adopter les enfants ou petits-enfants de ses frères » si lui-même n’a pas d’enfants. Face à la rébellion des sœurs, Napoléon répond, narquois : « à voir vos prétentions, mesdames, on croirait que nous tenons notre couronne du feu roi notre père ».
À lire aussi : Louis XVIII et les femmes
En attendant, Louis, nommé conseiller d’État, se voit promu… connétable, dignité purement honorifique, contraignante mais lucrative – qui l’accable. Napoléon impose en outre que les prénoms de tous les enfants de la famille soient précédés de « Napoléon » : d’où « Napoléon-Louis », dont la naissance, au demeurant, est éclipsée par le sacre de l’Empereur. Sans ce qu’il appelle son « système », Louis ne « compte pour rien ». Bientôt nommé « gouverneur de Paris », « le militaire qu’il est censé être mène surtout campagne contre son corps », note plaisamment François de Coustin. À 27 ans, le voilà « écrasé sous des honneurs et des responsabilités dont il se passerait volontiers ». Quand, en juin 1806, son frère le propulse roi de Hollande sous le nom de « Lodewijk Napoléon », Louis n’y voit « qu’un exutoire aux difficultés de son ménage ». Roi vassal, rudoyé sans trêve par son frère dominant (Louis ne l’appelle jamais autrement, dans ses lettres, que « sire », ou « Votre Majesté » !) ce souverain malgré lui va, contre toute attente, s’éprendre de son royaume, et chercher à « s’imposer aux yeux de son peuple, mais aussi aux yeux de l’Empereur, comme un roi de plein exercice ». Au point de vouloir se faire couronner… jusqu’à ce qu’il n’en soit plus question !
Des relations familiales compliquées
François de Coustin n’a pas son pareil pour rendre passionnant le récit de ces rapports acrimonieux entre les deux frères, sur la base de leur correspondance. Celle-ci révèle un Napoléon colérique, acide, d’une brutalité inouïe. Quand meurt Napoléon-Charles, l’aîné des fils de Louis, Napoléon se contente d’écrire à Fouché : « j’avais espéré une destinée plus brillante pour ce pauvre enfant ». En 1808, la naissance de Charles-Louis-Napoléon [sic !], troisième fils d’Hortense, enflamme « la machine à ragots » […], « la médisance [quant à la paternité de Louis étant] surtout le fait du clan Bonaparte, ravi de pouvoir nuire au clan Beauharnais, et Caroline est à la manœuvre ». Séparés, Louis et Hortense se disputeront âprement la garde de l’enfant, dans le même temps où le roi de Hollande « rêve d’asseoir sa légitimité » : « Louis se voit en souverain et Napoléon en suzerain ». En 1811, l’Empereur annexe la Hollande, « petit territoire dans un empire napoléonien en perpétuelle expansion ». Napoléon réclame à son frère la conscription, qu’il n’obtiendra jamais ; Louis impose l’uniforme blanc à l’infanterie hollandaise ; « s’ancre chez ses sujets l’image du goed Lodewijk, ‘’le bon Louis’’ »… Lorsque le Blocus continental en vient à assécher les finances du royaume, « Louis finasse », contre les instructions de son frère, pour protéger le commerce : « empêchez donc la peau de transpirer ! », écrit-il en réponse aux « aboiements » [sic] d’un Napoléon mû par sa volonté implacable. Lassitude, détresse, abattement de Louis. Napoléon : « le climat de Hollande ne vous convient pas […] Je pense à vous pour le royaume d’Espagne […] Répondez-moi catégoriquement. Si je vous nomme roi d’Espagne, l’agréez-vous ? Puis-je compter sur vous ? ». Refus de l’intéressé. De guerre lasse, « Napoléon n’insiste pas et prépare Joseph à son nouveau poste ».
À lire aussi : Bonaparte raconté par Bainville
D’épidermique, le conflit entre les deux hommes s’envenime, pour devenir frontal en 1809 : « l’économie d’un roi n’est pas celle d’un prieur de couvent », lui écrit l’Empereur, dans une de ses lettres courroucées, insultantes, voire menaçantes : « c’est avec de la raison et de la politique que l’on gouverne les Etats, non avec une lymphe âcre et viciée », lui mande encore son frère. « Estomaqué », pour reprendre l’expression du biographe, Louis vit « la fin des illusions » dans l’angoisse, perpétuellement dupe du jeu de Napoléon, et ne comprenant pas ce qui lui arrive. Avec, en toile de fond, sa lutte infatigable pour récupérer, non plus même sa femme qu’il jalouse maladivement, et qui ne cesse de le fuir, mais au moins l’aîné de ses fils ! « Sciemment et cyniquement, écrit Coustin, Napoléon met en place des conditions d’une rupture avec Louis », dont on suit ici pas à pas le calvaire, jusqu’à l’abdication pathétique : quatre ans et un mois de règne à peine ! « S’ajoute à l’attitude de Napoléon l’écrasante dignité impériale, celle qui a mis fin au tutoiement entre les frères et sur le respect de laquelle il est aussi vétilleux que sur celui de la livrée du cocher de son ambassadeur », observe l’auteur.
Une fin de vie isolée et mélancolique
Louis, dès lors, va vivre sa « solitude en commençant par orchestrer sa propre disparition ». Tour de force dans un pays aussi contrôlé que celui de Napoléon, qui redoute (et empêche) qu’il ne s’embarque pour l’Amérique. « Dites-moi, je vous prie, s’il me permettra de vivre tranquille et obscur », supplie Louis dans une lettre à Madame Mère. Sombrant en dépression, se prenant à rêver d’un chimérique retour dans sa Corse natale, « c’est par son propre choix qu’il s’émancipe de ce passé pour devenir désormais le comte de Saint-Leu ». Exilé à Töplitz dans l’actuelle République tchèque, puis à Gratz, en Autriche, la Hollande autoritairement transformée en dix départements français lui reste une plaie ouverte, un mirage fantasmé. Il refuse l’offre d’un apanage royal doté de deux millions annuels – Hortense n’aura pas de tels scrupules, et s’en empara. Se voulant désormais un simple particulier, Louis tentera pourtant une dernière fois de récupérer son trône de Hollande dans l’agonie du Premier empire, ultime velléité d’action. Trop tard : la maison d’Orange reprend possession du pays. Le 1er janvier 1814, Louis rentre à Paris et s’installe à l’hôtel de Brienne… chez maman ! À Joseph, Napoléon écrira de lui : « je lui ai toujours connu le jugement faux. C’est un enfant qui fait le docteur ». Netflix pourrait faire une série à suspense des minutes du procès à épisodes intenté par Louis, en 1815, pour récupérer la garde de ses enfants ! Le verdict rendra Napoléon-Louis, l’aîné, à Louis ; et Louis-Napoléon, le cadet, à Hortense.
Graphomane, exilé à Rome puis à Florence après la chute de l’Empire, le comte de Saint–Leu, bientôt « M. Louis » (à la Restauration, Louis XVIII érigera en duché les terres de Saint-Leu) reviendra continument sur les épisodes de sa vie dans de multiples tentatives avortées d’écrire ses Mémoires. Coutumier des amours juvéniles, Louis tentera de demander sa main à la princesse Vittoria Odeschalchi – dix-sept ans ! « Je désire comme à seize ans », écrit-il dans un poème publié en 1831 sous le titre Les Regrets. Ce romantique mal conformé, « transi de beautés à peine nubiles », croira trouver chaussure à son pied (si l’on ose dire) en la personne d’une autre promise également âgée de dix-sept ans, une certaine Julia-Livia Stiozzi Ridolfi – tentative d’escroquerie au mariage, mais « Arnolphe s’est méfié à temps d’Agnès », pour reprendre la fine formule de François de Coustin. La dame lui survivra jusqu’en 1862. Louis épanchera ses amertumes en alignant des vers : « Sous votre empire tyrannique/ Ô femmes j’ai passé trente ans/ Dans une attente chimérique/ Ou dans les regrets déchirants »…
À lire aussi : Napoléon, notre contemporain?
Quid de la progéniture ? Joseph, l’aîné, exilé aux États-Unis, est de loin le plus riche de la fratrie. L’aînée de ses filles, Zénaïde, convole avec Charles-Julien, fils de Lucien. Charlotte, sa fille cadette, rentrée en Europe, « haute comme une naine et excessivement laide », se voit promise au fils aîné de Louis, le seul dynaste ; ils ne procréeront pas. La rougeole foudroie Napoléon-Louis en 1831. Quant à l’Aiglon, il meurt à Vienne un an plus tard. La destinée fulgurante de Louis-Napoléon est en route… Que son géniteur paralytique ait pu vivre six ans de plus, et il assistait à la naissance du Second Empire ! Comme quoi !
On pense à Guillaume Apollinaire, dans La Chanson du Mal-Aimé : « Destins, destins impénétrables/Rois secoués par la folie… »
A lire : Louis Bonaparte, roi rebelle et mélancolique, par François de Coustin. 624p, Perrin, 2025. En librairies à partir du 22 mai.