Tant du côté du monde religieux juif que du catholicisme, on avait fait les gorges chaudes autour des « pas-de-deux » que Gad Elmaleh avait esquissés entre les deux pôles. Quoiqu’il dise son attrait envers l’univers du catholicisme limité au « culturel » et non au cultuel, le parcours intellectuel d’Éric Zemmour n’est pas sans ressembler à celui de l’humoriste. Il ne faudrait toutefois pas qu’il se fasse plus royaliste que le roi…
« Un journaliste dans le texte, un journaliste dans le siècle » (et, même, en l’occurrence, bien des siècles…), c’est ainsi que pourrait se sous-titrer cette biographie intellectuelle, mixte d’essai et de pure biographie1.
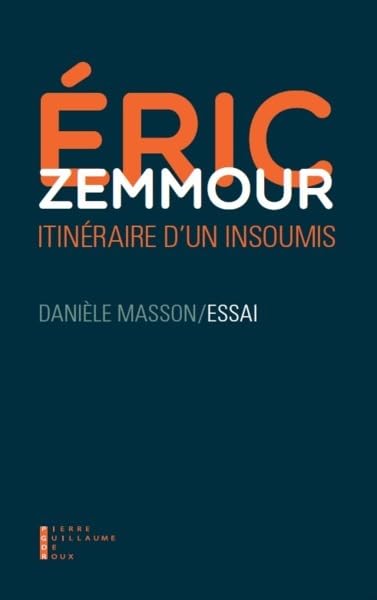
L’auteur n’est pas de celles qui, pour pondre leur prose enamourée, croit suffisant de donner rendez-vous à leur interlocuteur dans un bistrot à la mode d’où, autour d’une tasse de thé vert, et sans une once d’esprit critique, jaillira un portrait riche de tous les souverains poncifs du moment. Danièle Masson aime prendre ses sujets à bras-le-corps, éprouve un faible pour ce que nous appellerons les « intellectuels mystiques », navigue donc en permanence entre la philosophie et la religion tout en tenant ferme son gouvernail. Après Gustave Thibon, le philosophe de l’Ardèche (qui disait ne pas croire en Dieu mais ne croire qu’en Dieu et qui s’était si bien entendu avec Simone Weil avec un W), que cet essayiste puisse s’intéresser à celui qui, au fond, fut dès ses débuts, un éditorialiste (la politique n’étant que l’application de ses ardentes préconisations) coule de source, la source même qui avait alimenté l’interrogation qui avait donné son titre à un précédent recueil d’entretiens : Dieu est-il mort en Occident ?2
De cette bio, voici donc ce qui s’y lit et ce qui s’en déduit. Non pas « Zemmour entre les lignes » (car il ne s’agit pas ici de sous-entendus politiciens) mais « Zemmour derrière, au-delà des lignes » (pour tenter d’appréhender le substrat doctrinal présent en arrière-plan de sa démarche).
Un rapport tout particulier au temps
Pour comprendre pourquoi Zemmour est si attaché à la pensée du passé et donc à cette science humaine, mais pas si inexacte que cela, qui se nomme l’Histoire, il faut avoir à l’esprit sa nostalgie personnelle, celle de la banlieue des années soixante et soixante-dix, de ce qu’on appelait alors la Ceinture rouge. A Stains, à Montreuil, il régnait un ordre, qui, tout laïcard qu’il ait été, baignait dans une certaine morale pour ne pas dire une morale certaine qui eut abominé l’esprit du temps présent. Pour Zemmour, ce qui vient après n’a pas, de droit, préséance sur ce qui était avant : l’avenir ne doit jamais oublier le souvenir, et, même, ce dernier doit-il se rappeler à son bon souvenir. Au pire doivent-ils en permanence entretenir une dialectique où le prétendu passé joue le rôle de la Statue du Commandeur, toujours prêt, du haut de sa gravité, à proférer à nos cervelles écervelées nos quatre vérités.
Un rapport classique à la notion de vérité
L’idée que nous nous faisons du temps, la façon même dont viscéralement nous le ressentons (laquelle nous rend capable, à l’instar de Zemmour, de précisément prendre le pouls de son époque) entraîne et résulte à la fois d’une conception classique, c’est-à-dire fixiste et thomiste de la vérité. Celle-ci, bien évidemment s’inscrit en faux contre le présentisme, pis l’instantanéisme aujourd’hui dominant. Remarquons que nous évitons d’employer le terme de ‘‘relativisme’’, en ce sens que toute la question n’est pas de savoir si la vérité est relative, mais de détecter avec quoi, avec qui est-elle en relation ; non pas exactement : de quoi dépend-elle ?, mais : de qui émane-t-elle, quelle instance l’a-t-elle édictée ?
A relire, Sarah Knafo: «Et si on admettait tout simplement qu’on refuse l’islamisation de notre pays?»
Les idées de Zemmour sont ainsi en porte-à-faux avec celle de notre époque tout en continuant à imprégner l’inconscient collectif, un inconscient qui se révolte de plus en plus et aspire à devenir conscience reconnue.
Question pécuniaire, il est préférable de faire des ménages que d’être astreint au statut de jeune journaliste, d’ « intellectuel précaire ». Fin des années quatre-vingt, après J’informe (de Joseph Fontanet), le jeune Zemmour a accepté d’être mal (et parfois, pas) payé au Quotidien de Paris de Philippe Tesson dont le libéralisme avait au moins la vertu de laisser vaquer ceux qui ne savaient pas encore combien et comment ils allaient progressivement – si l’on n’ose dire – le tenir en piètre estime… le libéralisme disais-je. Passé au quotidien Le Figaro, des confrères, à l’exemple de Dominique Jamet, remarquaient la place encore à l’époque restreinte dévolue à ses papiers. On sentait que les thuriféraires de la monnaie nationale n’étaient pas en odeur de sainteté. Ils ne le sont certes toujours pas, mais, pourtant, entre-temps, la divine surprise advint, la greffe a opéré, entre le public (que d’aucuns diraient n’être qu’un certain public, peut-être la France moisie visée par Philippe Sollers) et lui.

Les raisons de la réussite de cette greffe demeurent une énigme si l’on sait que le courant dominant des grands médias demeure libéral-libertaire et que, contrairement au cliché, « la société » n’a pas viré à droite
Sans remonter aux Mérovingiens, ni même à la Convention de 1792, mais, seulement à l’Assemblée nationale de 1969 – lorsque ce que l’on ne nommait pas alors « la droite », mais la « majorité présidentielle » gaulliste (c’est quand La chose n’y est pas qu’on y met le mot faisait dire le théâtre de Montherlant à l’un de ses fameux personnages, et inversement) s’est élargie au centre-droit avec l’entrée au gouvernement du parti Démocratie et Progrès de Jacques Duhamel,- il est manifeste que, dans ses mœurs, dans son être, – plus précisément : dans l’acceptation officielle des mœurs, dans sa manière d’être -, la société française a, dans son ensemble, dérivé vers la gauche3. Par contre, l’étude de l’histoire du droit du travail et l’observation du comportement des grands syndicats depuis cette date montrent un net glissement vers le libéralisme individualiste de droite (dominante : Friedman/Hayek). L’observation clinique de la société confirme donc le diagnostic d’un Jean-Claude Michéa, qui, outre cette indissociabilité du gauchisme des mœurs et du gauchisme économique et financier,insiste sur la non neutralité de la technique, en ce sens que les NTIC, en tant que telles, favorisent cette dérive. Michéa est peut-être le meilleur théoricien, l’expression la plus articulée du sens commun zemmourien. (Laetitia Strauch-Bonart, qui se dit disciple de Michéa, ne nous démentira pas).
Si nous parlons de sens commun zemmourien, c’est, certes, que son diagnostic et son pronostic seraient le plus couramment répandus, mais, aussi et surtout, que la société, que toute société digne de ce nom (qui répond à la définition du mot société) est structurellement de droite
Autrement dit, et aussi paradoxal que cela apparaisse de prime abord : la politique de droite (toutes matières confondues) est naturelle, est conforme avec la structure inhérente à toute société. Elle suppose (et implique réciproquement) une hiérarchie des décideurs, c’est-à-dire une structure nécessairement pyramidale des normes… droite/gauche… composition de la Convention… droit de veto (relatif ou en dernier ressort) du roi… Mais cet ordonnancement n’est pas seulement vertical ; il est aussi horizontal si l’on s’en rapporte à l’organisation tri-fonctionnelle de la société telle que révélée par Georges Dumézil et que les trois ordres de l’Ancien Régime n’ont fait que décalquer. Autrement dit, il existe des invariants qui, par définition, plus ou moins enfouis, plus ou moins tabous selon les époques, ne peuvent que demeurer. Au sens de manant (le membre de la petite noblesse qui, sous l’Ancien Régime, veut se maintenir sur ses terres et maintenir ses traditions), Éric Zemmour est donc un demeuré. Il veut étirer le temps, éterniser (tant faire se peut, et toute la question est de savoir si l’on peut prétendre que cela soit possible) l’instant d’avant. Et c’est en partie ce que l’on appelle la Tradition.
Les conceptions zemmouriennes ne sont peut-être pas sans lien avec la religion hébraïque biblique
Boris Cyrulnik faisait observer qu’historiquement, les Juifs avaient été des « agitateurs culturels ». Et, de fait, de Jésus-Christ à Judith Butler en passant par Daniel Bensaïd et Marx, en a-t-on souvent intellectuellement cette vision. Mais, cet anti-essentialisme exacerbé, cette aversion envers toutes prédéterminations et déterminations radicales en l’homme (qu’on pourrait résume par cette formule : il est de l’essence de l’homme de n’avoir aucune essence) ne correspondent toutefois qu’à une portion du monde juif4. Le judaïsme, pris ici à l’instar de ce que Claude Tresmontant désignait du nom de ‘‘religion hébraïque biblique’’, effectue un geste opposé (cf. par exemple la pensée d’un Léo Strauss ou d’un Bergson). On agite le verre de vin, puis on laisse reposer. Et on s’intéresse, on isole, on préserve et conserve ce qui se sera déposé ; c’est le ‘‘dépôt de la foi’’. Pour l’essentiel s’assimile-t-il au Décalogue, à la Loi naturelle, lesquels, tout au long de l’histoire des hommes, agissent à la lettre comme un garde-fou, le mettant en garde contre ce qui est la tentation permanente du genre humain, et qu’on appelle la Tentation de Prométhée. Aussi n’est-il pas exagéré d’écrire qu’Éric Zemmour s’inscrit en faux contre, en l’homme, la perpétuelle recherche de l’autonomie, la volonté de soi-même se donner à soi-même sa propre loi au risque, bien sûr, par finir par ne plus ne s’en donner aucune : l’autonomie absolue mène à l’anomie universelle.
Solide, bien pensée (et, on l’a compris, dans les deux sens du terme), la biographie intellectuelle de Danièle Masson, en drainant toutes ces notions, contribuera à l’édification de l’Histoire des idées. Elle donnera aussi à nos descendants une idée assez exacte de l’état intellectuel et mental de notre époque qui, se diront-ils, en était ainsi venu à considérer comme inconvenante voire réprouvable une appréhension du monde somme toute conforme à la nature des choses, si tant est que les adjectifs ‘‘banal’’ et ‘‘naturel’’ puissent se dire synonymes.
Certains se souviendront de ce journaliste catholique des années soixante-dix, qui fut d’abord au nombre de ces chrétiens de gauche avant de virer sa cuti. Il est l’auteur de cette formule, qui est au fond une formule de bon sens, en ce sens qu’elle résume bien ce qu’il y a lieu de comprendre et d’admettre. Ce Jean-Marie Paupert disait donc : « l’expression judéo-christianisme est à la fois un contresens et une redondance. ». D’une part, le christianisme s’inscrit en faux contre l’affirmation première du judaïsme qui est de nier la divinité du Christ ; d’autre part, il ne fait que l’accomplir, le Nouveau Testament n’étant (selon l’Eglise) que la réalisation des promesses contenues dans l’Ancien. Or, dans l’expression de sa pensée (et il n’est point obséquieux de notre part de soutenir que Zemmour détient une pensée digne de ce nom), Zemmour montre qu’il est en déséquilibre entre ces deux « marques de fabrique », et qu’il aurait, consciemment ou non, tendance à ne vouloir estimer qu’une Eglise ayant pris ses distances avec ce que la vulgate judaïque conserverait de « progressiste ». Or, le judaïsme, c’est d’abord la Loi et les Prophètes, le Décalogue, tout ce que le monde post-moderne déteste (puisque ceux-là seuls, aujourd’hui, sont les derniers à vouloir l’empêcher d’agir à sa guise). Et puis, Zemmour, dites-vous bien que cette très ancienne hérésie chrétienne, qui a nom marcionisme et qui voudrait que le christianisme n’ait plus rien à voir avec son illustre devancier, a été, suite à Harnack, recyclée par toute la mouvance chrétienne libérale (tant catholique que protestante) pleine, pour reprendre le mot de Chesterton, de ces vertus folles qui régentent notre monde.
Une journaliste du service Culture du Figaro, il y a peu, relevait en privé et en substance – mais pour le déplorer – que le vœu le plus cher de Zemmour était de devenir catholique. Antoine Beauquier, un des avocats du président de Reconquête, a, comme on dit, l’oreille de ce dernier et, à l’occasion, pratique ce que d’aucuns, de nos jours, appellerait endoctrinement (étymologiquement parlant, bien sûr), « coaching doctrinal » ou « bienveillant enseignement ».Nul doute que l’élève a encore des questions à lui poser, pour pouvoir, le cas échéant, prendre position.
- Danièle Masson, Zemmour, itinéraire d’un insoumis, éditions Pierre-Guillaume de Roux. ↩︎
- Danièle Masson, Dieu est-il mort en Occident ?, éditions Guy Trédaniel, 1998 ↩︎
- cf. Emmanuel et Mathias Roux, Michéa, l’Inactuel – Une critique de la civilisation libérale –, éd. Le Bord de l’Eau ↩︎
- Voir Ce soir ou jamais, France 2, 10 X 2014 : symptomatique de cette opposition, le débat Jacques Attali/Éric Zemmour. ↩︎































