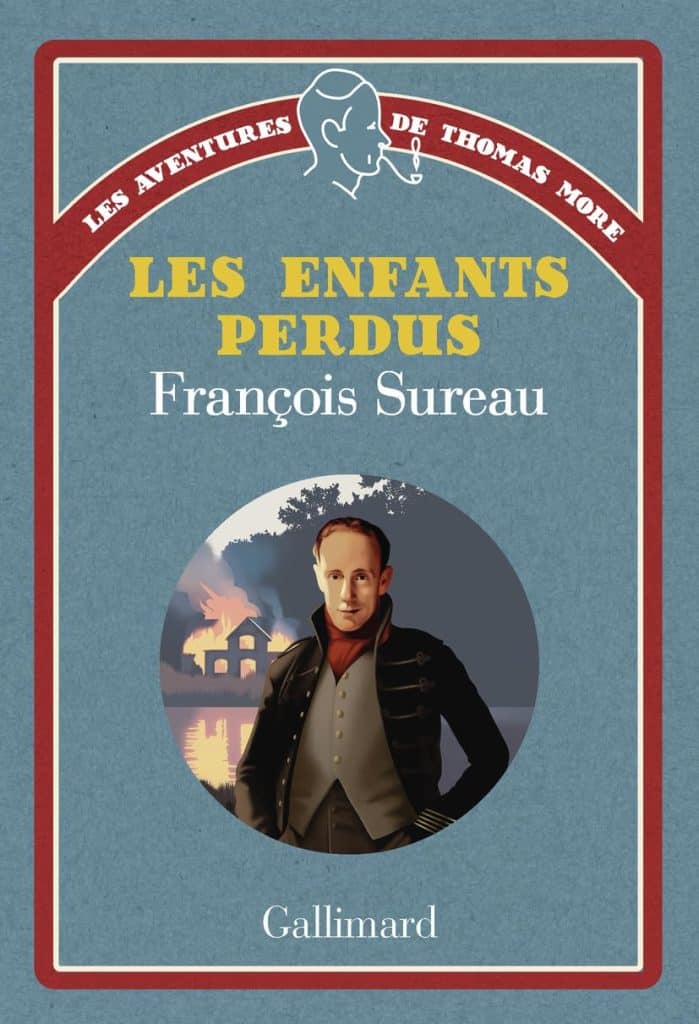Dans ce portrait sévère, la députée de Paris LFI Sophia Chikirou est dépeinte comme une jolie poupée russe politique. Mutine et opaque à l’extérieur, mais remplie à craquer d’un bolchévisme prêt à vous sauter à la figure! (Avec M. Mélenchon pour assurer la sécurité). Si la France révolutionnaire se décide demain à organiser un nouveau «feu de joie» citoyen, elle compte jouer les premiers rôles…
On raconte les pires horreurs sur Sophia Chikirou. Son rapport à l’argent. Son autoritarisme. Son goût pour l’empoisonnement de quiconque travaillerait pour elle. Les casseroles que l’on entend tintinnabuler sur son passage. Elle fait un peu peur. Et puis, le chien de garde Mélenchon veille sur elle, quoi qu’il lui arrive. Propriété bolchévique, défense d’approcher ! On aimerait en savoir davantage, tout de même…
Qui est cette très proche conseillère ? Jolie, mutine, aussi habile qu’opaque, et, finalement, nous l’allons voir, dangereuse.
Heureux hasard
La pensée communiste est de nature fractale, ou autosimilaire : prise séparément, chaque partie, même infinitésimale, a exactement la même forme que le tout. Un heureux hasard veut que le meilleur moyen de comprendre ce qu’est une fractale soit d’imaginer des poupées russes: la plus petite est la parfaite reproduction de la plus grande, dimensions mises à part. Seules les couleurs varient. L’utilité de comparer l’idéologie communiste aux fractales est que cela nous permet d’étudier sa structure générale en concentrant notre regard sur un de leurs détails. Le micro peut ainsi nous livrer la définition du macro : étudié avec soin, un simple dazibao placardé en 1968 sur le mur d’une université chinoise nous livre l’essentiel des très volumineuses et fastidieuses œuvres complètes de Mao.
Mais revenons-en à Sophia Chikirou. Car justement, lors d’une rapide interview effectuée par Quotidien, elle nous a récemment gratifiés de quelques phrases permettant de saisir d’un coup, comme en un flash décisif, à la fois la nature du régime communiste chinois et l’âme de la conseillère du camarade Jean-Luc. Soyons tout ouïe, car si une partie de la presse française a relevé ce propos, et s’en est même parfois indignée, personne n’a eu la prudence de le disséquer sous un microscope.
La Chine, pas une dictature ?
« Je ne considère pas que la Chine est une dictature. La Chine est un système politique à parti… (Ici, elle hésite une seconde et se reprend bien vite.) D’ailleurs, il y a huit partis, donc ce n’est même pas un parti unique, mais un parti dominant, qui est le Parti Communiste Chinois. Il y a un système politique où il n’y a pas un seul homme qui dirige la Chine. La critique du Parti Communiste Chinois est impossible, mais après, vous pouvez critiquer des mesures qui sont prises, des propositions politiques qui sont faites. La liberté d’expression en Chine est aussi menacée que celle qu’on a en France. »
Que dit Sophia Chikirou ? Que la Chine n’est pas une dictature. On pourrait s’en tenir là, fermer le ban, éclater de rire ou partir en courant, tant l’assertion relève de la contre-vérité sans vergogne. Mais nous sommes ici d’emblée confrontés à du communisme pur et dur, et comme nous l’a démontré le XXème siècle, la dernière chose à faire est de prendre ce genre de matériau à la légère. Continuons donc.
Sophia Chikirou nous assène donc également que le système politique chinois serait multipartite. Huit partis, rien que ça ! On rappellera, si besoin est, que le Parti communiste compte plus de 100 millions de membres encartés, qu’il dirige d’une main de fer toute la société chinoise du sol au plafond – entreprises prétendument libres incluses -, que le système concentrationnaire local, tentaculaire, esclavagise jusqu’à la dernière goutte de sueur et de sang ses innombrables bagnards – dont il lui arrive plus qu’à son tour de vendre les organes sans leur assentiment – et, pour mémoire, que le même Parti a été l’organisateur du plus grand holocauste jamais vu (le Grand Bond en Avant, 50 millions de morts) et se garde bien d’en éprouver la moindre culpabilité. Et les sept autres partis, donc ? Le journaliste qui interroge Chikirou oublie de lui en demander les noms et les positionnements politiques. Quel dommage. Ces sept plaisanteries sont des pseudo-partis dont la seule utilité est de faire croire aux imbéciles que le PCC n’est pas seul maître à bord. Le PCC est « dominant », dit-elle. Oui, admettons, si l’on considère que la SS est « autoritaire »…
Passons sur les deux sinistres galéjades selon lesquelles la Chine ne serait pas dirigée par un autocrate et, surtout, sur l’idée que, si l’on ne peut pas critiquer le Parti, on pourrait néanmoins critiquer ses décisions — au mieux, cela vaudra à la petite Sophia une fessée au tribunal de l’Histoire. Filons à l’essentiel : l’extraordinaire affirmation « La liberté d’expression en Chine est aussi menacée que celle que l’on a en France. » Relisez bien cette phrase et notez l’inversion complète de la logique. Il n’est même pas question d’affirmer que la liberté d’expression est aussi menacée en France, ce qui constituerait déjà un gigantesque mensonge, mais qu’elle l’est autant en Chine qu’en France, ce qui relève du crime contre l’évidence le plus féroce possible. On n’est plus confronté à une intox communiste basique, comparable au « bilan globalement positif » de feu Georges Marchais, mais à une monstruosité idéologique de toute première grandeur, qui déshonore définitivement quiconque la croit. Un gardien de camp nazi, qui avait pour coutume d’appeler chaque juif « chien », avait baptisé son chien « juif ». Là est l’aboutissement de toute idéologie : la signification du monde bascule cul-par-dessus tête et une nuit inexplicable tombe sur le langage.
A lire aussi, Martin Pimentel: Sophia Chikirou, le « martyr » du Hamas et la chute de la maison Mélenchon
Déraison
Alors, pourquoi ? Pourquoi Chikirou outrepasse-t-elle toutes les limites du verbe politique pour s’aventurer ainsi dans le cloaque de l’absurde assumé ? Pourquoi nous dit-elle que la Chine du PCC est presque aussi antidémocratique que la France ? Par provocation ? Par cynisme tactique ? Par immoralisme décadent ? Non. Son cas nous semble plus grave que cela. Il ne relève pas des catégories partisanes traditionnelles. Il tient en un mot : possession.
Le communiste – ou ses cousins en totalitarisme, le nazi et l’islamiste – lorsqu’il se livre totalement au mal idéologique, est comparable aux esprits étudiés par la démonologie chrétienne, et rendus génialement romanesques par Dostoïevski dans son chef-d’œuvre, le bien-nommé Les Possédés. Symptômes de leur dérangement : la raison est complètement déréglée, toute empathie disparaît, une rage d’un genre nouveau surgit.
Sergueï Netchaïev, adolescent terroriste proche de Bakounine, décrit fièrement sa mentalité : « Le révolutionnaire est un homme condamné d’avance : il n’a ni intérêts personnels, ni affaires, ni sentiments ni attachements, ni propriété, ni même de nom. Au fond de lui-même, non seulement en paroles mais en pratique, il a rompu tout lien avec l’ordre public et avec le monde civilisé, avec toute loi, toute convention et condition acceptée, ainsi qu’avec toute moralité. En ce qui concerne ce monde civilisé, il en est un ennemi implacable, et s’il continue à y vivre, ce n’est qu’afin de le détruire plus complètement. »
Voici notre Sophia. Une révolutionnaire, une vraie, exacte et profonde, complète. Une fractale du bolchévisme le plus aveugle, capable de vanter les charmes de la tyrannie chinoise, et de la préférer à notre médiocrité, et de le déclarer face caméra, et de ricaner si l’on s’interroge. « Vous êtes des morts », nous lance-t-elle en substance, comme le milicien de 1984. On a toujours tendance à croire que la nouvelle génération de communistes français, les Insoumis, est une cohorte d’imbéciles et de truqueurs. Loin s’en faut. Il y a parmi eux des hommes nouveaux bien plus désordonnés que de simples punks à chiens, et bien plus contagieux que les bobos lecteurs de Piketty. Structurés comme seuls les leaders révolutionnaires savent l’être. Ils sont les patients zéro de la pandémie à venir. L’islamimo-gauchisme en écharpe tels des maires de la guerre civile, le léninisme pour catéchisme, disposés à toutes les émeutes parce que l’incendie est leur rituel, ils ne te feront, cher lecteur, aucun cadeau, car leurs cerveaux ne fonctionnent pas comme le tien. Ils ne s’embarrassent pas de la crédibilité, pensent vraiment que Xi Jinping vaut mieux que Bruno Retailleau. Admets-le, au lieu de croire que le pire s’écrit au passé. Sophia Chikirou a quelque chose de parfait, la crise porte sa horde.
Un premier mai, à Paris, par curiosité, je me suis glissé dans un cortège de Lutte Ouvrière. J’ai discuté avec une porte-pancarte en me faisant passer pour un des leurs. Je lui ai demandé : « Et serais-tu prête à tuer des riches pour réussir la révolution ? » Elle m’a répondu : « Ils ne nous laisseront pas le choix. Ce sera eux ou nous. »
Cette brave fille inquiète était une fractale de la colère rouge qui monte dans le pays. Elle était la base dont Sophia Chikirou voudrait peut-être être le sommet. Trotskistes, staliniens, maoïstes, anarchistes, black-blocs, anticapitalistes antisémites, et tous leurs casseurs free-lance, néo-sans-culotte de toutes obédiences, attendent leur heure. Et si cette heure ne vient jamais, si Sophia Chikirou n’accède jamais aux commandes de notre pays en ruine, eh bien, l’on pourra dire qu’on l’a échappé belle.
« Je ne baisserai pas les yeux. Pour me les faire baisser, il faudra les crever. » Sophia Chikirou.