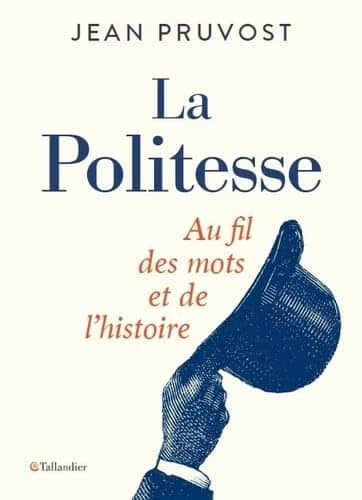… lisez l’enquête de François Bousquet sur le racisme antiblanc
Non seulement il fait partie de cette caste rassemblant les êtres les plus étriqués et les plus sectaires de la prétendue élite intellectuelle de gauche – un mélange hétéroclite de sociologues sous-bourdieusiens, de philosophes sous-foucaldiens, d’universitaires wokes et d’écrivains égocentrés – mais François Bégaudeau en est même une sorte de synthèse. Il se revendique en effet tout à la fois de la sociologie politico-indigente de Geoffroy de Lagasnerie et de Didier Éribon, de la littérature sociologico-nombriliste d’Annie Ernaux et d’Édouard Louis, des réflexions politico-totalitaires de Sartre et d’Alain Badiou. Depuis le succès du film démagogique Entre les murs (Palme d’Or à Cannes en 2008 – logique !) tiré de son roman (Prix France Culture-Télérama en 2006 – normal !), M. Bégaudeau passe son temps dans les médias à palabrer sur la bourgeoisie, qu’il exècre, et le prolétariat, dont il a entendu parler. Car un regret mine depuis toujours ce fils d’enseignants : il n’est pas issu et n’a jamais fait partie de la classe ouvrière. Pire, avouait-il dans un livre intitulé Histoire de ta bêtise, il a acquis un bien tout ce qu’il y a de plus bourgeois, selon lui, un appartement dans le 11ème arrondissement de Paris. M. Bégaudeau tente d’effacer cette tache indélébile en battant sa coulpe et en donnant moult détails sur l’origine des sommes d’argent qui lui ont permis d’accéder à la propriété – un héritage, un emprunt, des droits d’auteur. Il tient à préciser que son statut privilégié ne l’empêche pas d’avoir des envies révolutionnaires : « Mon compte en banque et mon patrimoine dessinent un cadre bourgeois qui devraient m’assimiler à un cadre de pensée bourgeois. Ce n’est pas le cas. J’appartiens à une classe supérieure dont je persiste à envisager, sinon souhaiter, la destitution. Je suis propriétaire et je délégitime la propriété. Les jours de grande morgue, il ne faut pas me servir trop de pintes pour que je préconise son abolition ». On suppose que c’est après une virée bien arrosée entre amis qu’il a, selon son propre aveu, voté pour Besancenot en 2002. En 2007, dessoûlé, il votera pour Ségolène Royal. Sa connaissance des classes laborieuses étant essentiellement livresque et politique, il s’est fait du prolétaire, de l’ouvrier, une image assez particulière, à partir de laquelle il a aménagé et entretient son appartement : un « carton Franprix » lui sert de « table de nuit » ; il semble tout heureux d’avoir des « murs écaillés par un dégât des eaux » ; il évite de faire le ménage : « ici, la règle est le sale ». Aveu inconscient d’un gauchiste imprégné d’une iconographie surannée et imaginant l’ouvrier vivant dans la crasse tandis que le bourgeois se vautre dans une propreté tapageuse, fruit de l’exploitation du prolétariat. Le mépris et la condescendance à l’endroit des Français les plus modestes peuvent prendre différents visages. François Hollande se moquait des « sans-dents », Benjamin Griveaux brocardait les « gars qui fument des clopes et roulent au diesel », Agnès Pannier-Runacher se passe de l’avis des « moins riches » à propos des ZFE parce que, selon elle, « ils n’ont pas de voiture » – François Bégaudeau, lui, est persuadé que les prolétaires sont sales et, pour montrer sa solidarité, n’époussette pas ses meubles en carton.
Le wokisme n’existe pas, les prolos en rajoutent sur l’insécurité…
M. Bégaudeau assure qu’il est un « intellectuel anarchiste » proche du peuple et non un « bourgeois ». La preuve : « Je ne remplacerai pas les quatre lattes défoncées de mon parquet, mais je me sentirais personnellement blessé par un texte qui défonce Deleuze. » Les pages d’Histoire de ta bêtise, fastidieuses, rébarbatives, adoptent un style tantôt trivial et supposément populaire, tantôt lourdement didactique et censément politico-révolutionnaire. Il s’y glisse quelques séances de molle auto-flagellation immédiatement recouvertes par des justifications ridicules censées dédouaner le bourgeois qu’il est devenu mais qu’il abhorre presque autant que cette gauche embourgeoisée, social-démocrate, socialiste ou convertie au macronisme, qu’il qualifie de « bête » et à laquelle il réserve ses diatribes les plus mordantes. En parlant de bêtise…
À propos du wokisme, M. Bégaudeau affirme, dans l’émission Les Incorrectibles animée par le journaliste Éric Morillot, que « c’est un truc assez improbable à définir » mais que « c’est un mot qui – attention ! tenez-vous les côtes, ça va secouer ! – a très bien circulé parce que c’est un cadeau à la droite. C’est la meilleure façon qu’a trouvé la droite de ne surtout pas discuter ou avoir à répondre avec ce qui est son vrai ennemi et ce qu’elle a toujours identifié comme le camp véritablement dangereux pour elle, à savoir le camp communiste, au sens le plus littoral du terme, celui qui veut exproprier ceux qui possèdent. C’est ça que les bourgeois craignent depuis toujours. Comme ils n’ont rien à dire à l’hypothèse communiste – parce qu’ils sont pris la main dans le sac par le communisme, quand même – alors ils préfèrent détourner un peu l’attention et ils vont un peu recolorer la gauche à leur manière, ils vont un peu la ridiculiser, ils vont aller chercher des éléments ridicules dans ce qui se présente comme étant de gauche, et ils vont appeler ça le wokisme[1]. » Bravo à Éric Morillot qui a pu écouter cette marmelade sans éclater de rire. Et merci à lui de nous avoir offert la preuve ultime que M. Bégaudeau est bien ce qu’il paraît être et que la décence m’interdit d’écrire ici.
Récemment, sur la chaîne YouTube Crépuscule[2], entre de courtes considérations philosophiques et littéraires d’une pauvreté analytique consternante, M. Bégaudeau a livré cette fois le fond de sa pensée sur les Français qui subissent les effets délétères de la submersion migratoire et qui ne veulent plus se taire. Pour lui, la crainte de l’insécurité liée à l’immigration ne peut être qu’un « stress », une « fébrilité » sans réel fondement ; les prolos et les ploucs ont tendance à en rajouter, surtout s’ils écoutent certains médias : « Il n’y a qu’à écouter les gens quand on s’attarde dans un PMU, dans un rade, ça va très vite. Et puis moi, j’en ai dans ma famille donc je vois à peu près à quoi ça ressemble. » Ce ça, proféré avec une moue de dégoût, révèle le principal sentiment qui anime le bourgeois gauchiste : la haine des « petits Blancs ». D’après lui, les seuls qui parlent sérieusement de l’immigration, « ce sont les gens de gauche. Les gens de droite ne parlent pas de la question de l’immigration. Ils parlent d’une seule chose qui est : dans quelle mesure est-ce que les Noirs et les Arabes vont me compliquer ma vie à moi, petit Blanc de France. » Adepte des thèses décolonialistes d’Houria Bouteldja, M. Bégaudeau reprend à son compte l’idée d’un racisme systémique dans la société française et considère que la peur de l’immigration n’est qu’une « petite panique pseudo-identitaire et raciste de petits Blancs paniqués ». Ces derniers, dit-il, n’ont aucune raison de s’alarmer : « Vous qui vous inquiétez de savoir si vraiment la submersion migratoire va liquéfier la culture française, liquéfier nos vies, violer nos femmes, multiplier la délinquance… calmez-vous un peu ! »
A lire aussi, du même auteur: La Grande Librairie ou Le Grand Déballage?
Voici venu le moment de donner un conseil de lecture à M. Bégaudeau. Le racisme antiblanc, de François Bousquet, est sorti en avril 2025 et jouit d’un succès mérité – Gilles-William Goldnadel, qui connaît ce sujet à fond et a été un des premiers à le traiter sérieusement[3], en a fait l’éloge dans ces colonnes.
Dans le chapitre intitulé Théorie du grand Blanc et construction sociale du petit Blanc, François Bousquet explique, et cela devrait fortement intéresser M. Bégaudeau, qu’il y a effectivement deux types de Blancs, que tout oppose : le grand Blanc et le petit Blanc. Il rappelle que « petit blanc » est une expression méprisante née dans les colonies et désignant un individu blanc « au bas de l’échelle du pouvoir, coincé entre les indigènes qu’il encadrait et les élites coloniales qui le toisaient ». Les colonies ayant disparu, l’ancienne élite coloniale « s’est muée en élite universitaire dont le grand Blanc est l’aboutissement. Son mépris pour le petit Blanc est intact et son ascendant culturel sur lui absolu. » Bégaudeau fait naturellement partie des grands Blancs qui considèrent que le petit Blanc est un « concentré de ringardise franchouillarde » ; comme ses congénères, il analyse « les préjugés d’appartenance tribale du petit Blanc avec la morgue d’un ethnologue colonial devant une peuplade attardée ». Le grand Blanc, écrit François Bousquet, est une « belle âme » qui s’émeut du sort des « racisés » – dont en réalité il n’a rien à faire – pour se donner une bonne conscience dont il attend « des gratifications symboliques et des rentes statutaires ». Les grands Blancs se retrouvent entre eux, dans les médias, dans les universités, dans les salons littéraires, dans les clubs politiques, et s’octroient mutuellement des billets d’honneur moraux tout en méprisantles petits Blancs qu’ils sermonnent.
Le racisme antiblanc, pas son affaire
Du haut de leur position sociale avantageuse, tout en faisant semblant de se préoccuper encore un peu de son sort, les grands Blancs accusent le petit Blanc de toutes les tares réactionnaires et racistes, surtout depuis qu’il ne vote plus à gauche. Ils haïssent cet être leucoderme, trop français, trop conservateur, trop provincial, trop attaché à ce qu’ils considèrent être les restes d’une société arriérée : des racines chrétiennes, une identité régionale, une histoire nationale, une langue, une culture – ils lui préfèrent maintenant un être qu’ils parent de toutes les vertus et qui leur permet de montrer leur supériorité morale sur le petit Blanc et de briller dans les milieux progressistes : le migrant. Mais pas n’importe lequel. Le migrant « racisé » et musulman a leur préférence. Les vertus dont ils le parent sont paradoxalement celles qu’ils refusent au petit Blanc : la fierté identitaire, la solidarité communautaire, des principes familiaux et religieux solides, une culture ancestrale. Bien entendu, rappelle François Bousquet, ces grands Blancs politiques, médiatiques ou universitaires ne vivent pas, à l’inverse des petits Blancs, avec ces nouveaux venus dont les plus jeunes et les plus violents ont compris une chose : le petit Blanc, cette « face de craie », ce « gwer », ce « babtou », est une proie facile. On peut l’insulter, le voler, le frapper, le violer, sans craindre grand-chose – les grands Blancs de gauche veillent : la culpabilité ne se partage pas et incombe entièrement aux petits Blancs accusés d’être racistes et islamophobes, incapables de concevoir ce fameux vivre-ensemble que les grands Blancs promeuvent tout en restant à distance des lieux, de plus en plus nombreux, où il apparait que cette expression est en réalité un oxymore. M. Bégaudeau, comme tous les grands Blancs de gauche, nie l’existence du racisme anti-blanc qui se répand à l’école, dans les salles de sport, sur les terrains de foot, dans les quartiers où la population d’origine immigrée devient trop importante pour endiguer les phénomènes d’islamisation et de délinquance qui accompagnent ceux du racisme anti-blanc et anti-français. M. Bégaudeau se fiche de tout cela. Marxiste, il ne fait pas de différence, dit-il, entre les « prolétaires migrants » et les « prolétaires pas migrants ». Jamais, ajoute-t-il, il ne reconnaîtra que les petits Blancs sont les principales victimes de l’immigration, jamais il n’incriminera des immigrés : « Je ne veux pas m’attirer la sympathie du prolétaire blanc à ce prix-là. » Tout est dit. La réalité quotidienne des Français et les dizaines de terrifiants témoignages recueillis par François Bousquet ne le feront pas changer d’avis. Les violences, les insultes, les rackets, les vols, les viols, les agressions au couteau et à la machette dans les nombreux territoires perdus de la République ? Bégaudeau n’en a rien à faire – ça ne colle pas avec son idéologie. Quant aux femmes musulmanes tyrannisées par des hommes appliquant strictement la charia, qu’elles ne comptent pas non plus sur M. Bégaudeau pour les défendre. Sur le média en ligne QG[4], M. Bégaudeau, tout à son envie d’accabler la France plutôt que certaines mœurs rétrogrades importées, justifie ainsi cet état de fait : « L’oppression qui est imposée aux femmes dans certaines configurations musulmanes ou certaines de ces acceptions peut être un contrecoup d’une pression coloniale ou d’une domination que subissent ces populations-là en France ou en Occident ». D’ailleurs, ajoute-t-il pour expliquer les excès des mâles musulmans, « le sur-virilisme dans certains quartiers populaires à forte densité migratoire et où on trouve beaucoup de racisés, donc beaucoup de musulmans, vient de la fragilisation de ces hommes par le pouvoir policier qui les harcèle depuis un certain nombre de décennies. »
Décidément, cet intellectuel de gauche ose tout – c’est même à ça qu’on le reconnaît… Comme disait Orwell, « il faut être un intellectuel pour croire une chose pareille : quelqu’un d’ordinaire ne pourrait jamais atteindre une telle jobardise. »
[1] https://www.youtube.com/watch?v=eelrJ0CmcSg
[2] https://www.youtube.com/watch?v=0–oXQWEmN4
[3] Gilles-William Goldnadel, Réflexions sur la question blanche : du racisme blanc au racisme anti-blanc, 2011, Éditions Jean-Claude Gawsewitch.
[4] https://x.com/LibreQg/status/1912838458910953597