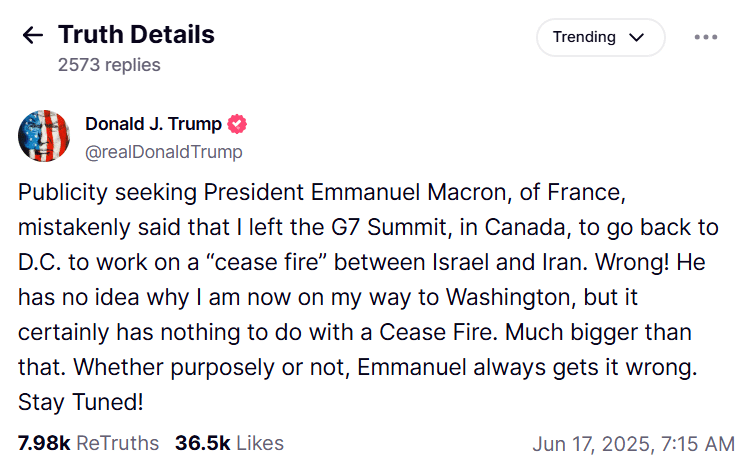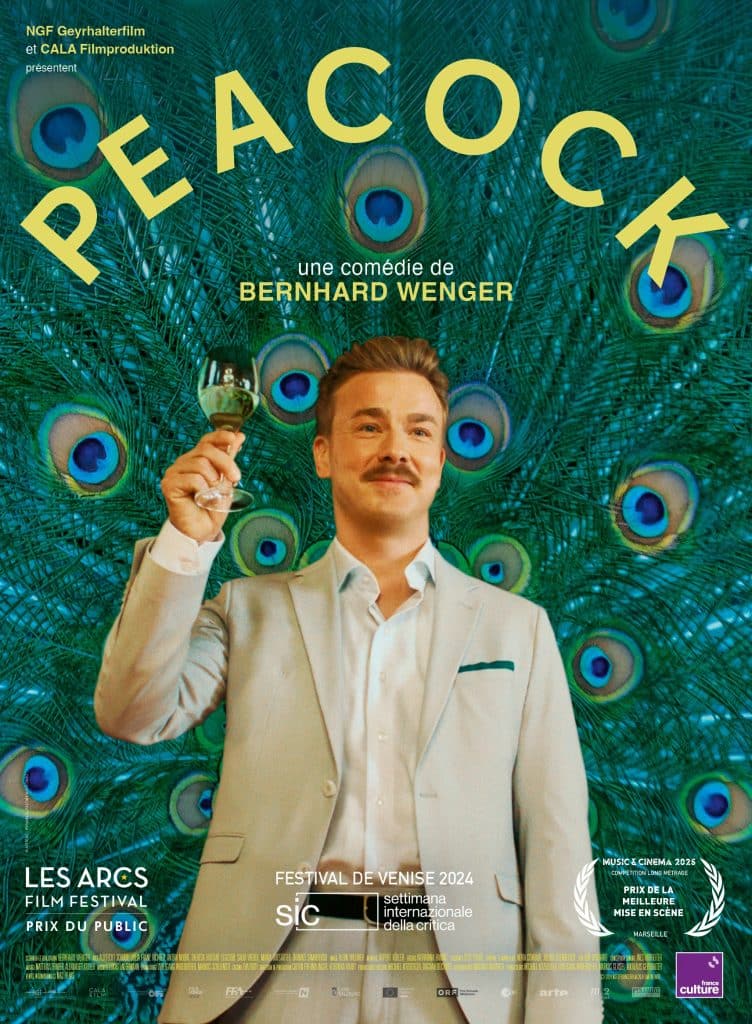À Kananaskis, en Alberta, tous les yeux étaient rivés sur sa Majesté orange, Donald Trump.
En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, même petite comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne : “Transporte-toi d’ici là !”, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible.
Matthieu 17:20-21
La montagne ne mène que vers ses hauteurs ; arrivés à sa cime, elle se transforme en précipice.
Anise Koltz.
Le cadre est magnifique. Kananaskis, en Alberta, province productrice d’un des pétroles les plus sales au monde. Station balnéaire des montagnes rocheuses opportunément épargnée par un des nombreux feux de forêt qui ravagent l’ouest canadien avec de l’avance sur le calendrier. Un sommet élevé, censé élever.
La présidence en était assurée par le premier ministre canadien, Mark Caney, qui, depuis sa prise du pouvoir, et même avant, avait su courtiser le président américain tout en exprimant humblement son refus de devenir le simple proconsul du 51e état américain; il y a d’ailleurs eu des discussions préalables et parallèles au sommet entre Carney et Trump au sujet des droits de douane. A suivre dans 30 jours, mais l’on peut tenir pour acquis que le ministre Dominic Leblanc, qui exsude l’iode, a su plaider la cause du homard acadien avec force.
A lire aussi, Gil Mihaely: Bombe iranienne: divergences entre militaires et renseignement aux États-Unis
Comme l’on pouvait s’y attendre, Trump, qui a quitté le sommet avant sa conclusion, a encore soutenu, à bord de Air Force One, que devenir le 51e état aurait été la formule idéale pour le Canada, notamment parce qu’il ferait l’économie de 61 milliards $ au titre de la contribution au programme militaire « Dome doré » (oui, après réflexion, le commandant en chef de l’armée américaine a accordé une petite ristourne amicale car il avait auparavant évoqué 71 milliards $). Le seul hic est que les avantages de ce parapluie spatial ne sont pas totalement évidents (tant pour les Etats-Unis que le Canada) vu que les spécialistes y voient plutôt un mirage technologique, sur le plan de l’efficacité, du calendrier, et du coût total (il faudrait sans doute multiplier par 10 le budget global annoncé de 175 milliards). Il s’agit essentellement d’une reprise de la chimérique « Guerre des étoiles » promue jadis par l’ex-acteur de série B, Ronald « The Gipper » Reagan (d’ailleurs le véritable père du slogan « Make America Great Again), dont les plans ont fini dans un tiroir. Ce fut une étoile filante. Mais, parlant de doré, l’industrie militaire donatrice à la caisse électorale républicaine peut compter sur des retombées astronomiques du remake concocté par Trump.
Carney a eu recours aux services de la chanteuse québécoise Charlotte Cardin pour divertir les invités, mais, manifestement, ses cordes vocales et vocalises n’ont pas convaincu le président américain de renoncer à ses velléités annexionistes, encore qu’il reconnaît magnanimement aux Canadiens le droit de choisir leur destin.
A noter aussi la présence de l’Inde, explicable et expliquée par son immense poids économique; on peut supposer que, pour maintenir la bonne ambiance, Carney n’a pas jugé bon d’évoquer devant le Premier ministre Modi, suprémaciste hindouiste et infatigable (pour)chasseur de musulmans, les assassinats politiques de Sikhs perpétrés sur le sol canadien que de mauvaises langues lui attribuent. (On s’est sans doute inspiré de la réhabilitation de Mohamed Ben Salman, qui n’avait rien, mais vraiment rien à voir avec le traquenard et l’élimination avec extrême préjudice de Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien à Istanbul, commis par de méprisables électrons libres, cela va de soi). D’ailleurs, au pays du Mahatma Gandhi, on n’a pas exactement la conception canadienne du multiculturalisme, notamment en matière d’« accommodements raisonnables ».
Pour les autres pays de passage, l’idée était évidemment de présenter, avec une génuflexion, leurs suppliques économiques au cours de l’audience quasi-papale gracieusement accordée par Sa Majesté orange. Ils comptaient défiler chacun leur tour; « au suivant » aurait dit Jacques Brel, mais le départ précipité de Trump a bouleversé ces plans.
Trump a commencé par critiquer le cercle trop restreint de ce sommet, trop européen à son goût, auquel aurait dû être conviée la Sainte Russie poutinesque, exclue à tort, selon lui, par Barack Obama et l’insipide Justin Trudeau; sauf que cette mesure fut prise par le très conservateur Premier ministre Stephen Harper, mais, peu importe, l’occasion était encore trop belle pour railler le roi du surf des neiges déchu.
A lire aussi, Ivan Rioufol: Iran: face aux mollahs, cette France qui se débine
L’histoire se répète souvent, pas toujours pour les mêmes causes. Le propriétaire de Truth Social a quitté précipitamment le sommet dit économique. Il a pu prendre le président français pour tête de Turc supplémentaire, même si c’est un « chic type » (« nice guy » en v.o.) : « Emmanuel se trompe toujours », dixit Trump… L’époux de Brigitte, qui avait eu l’outrecuidance de visiter auparavant le Groenland, avait attribué le départ prématuré de Trump à sa volonté d’œuvrer sur un cessez-le-feu entre Israël et l’Iran. Que diantre, le président américain a démenti en revendiquant de bien plus hautes ambitions. Sans oublier que le Canada est « une grande nation souveraine » selon l’imprudente déclaration de l’occupant de l’Élysée.
Parlant de mastodontes hirsutes et impulsifs, absents du sommet, il y a aussi le grizzli. Toutes les mesures de sécurité avaient été prises afin d’éviter l’intrusion d’un de ces féroces Ursus horribilis (barrières de sécurité, destruction des arbres fruitiers constituant leur source de nourriture…).
En conclusion, des instructives déclarations de bonnes intentions. Pas un mot sur l’Ukraine. Mais unanimité quant à l’inacceptabilité de la bombe nucléaire iranienne. Le monde y voit déjà plus clair. Un succès confirmé par le président Macron.
Ce sommet a permis aux Etats concernés de redescendre dans leur vallée. Qu’elle est verte!