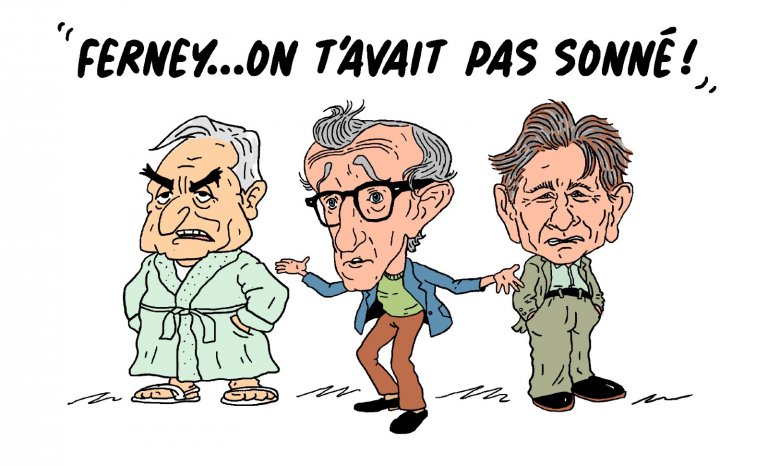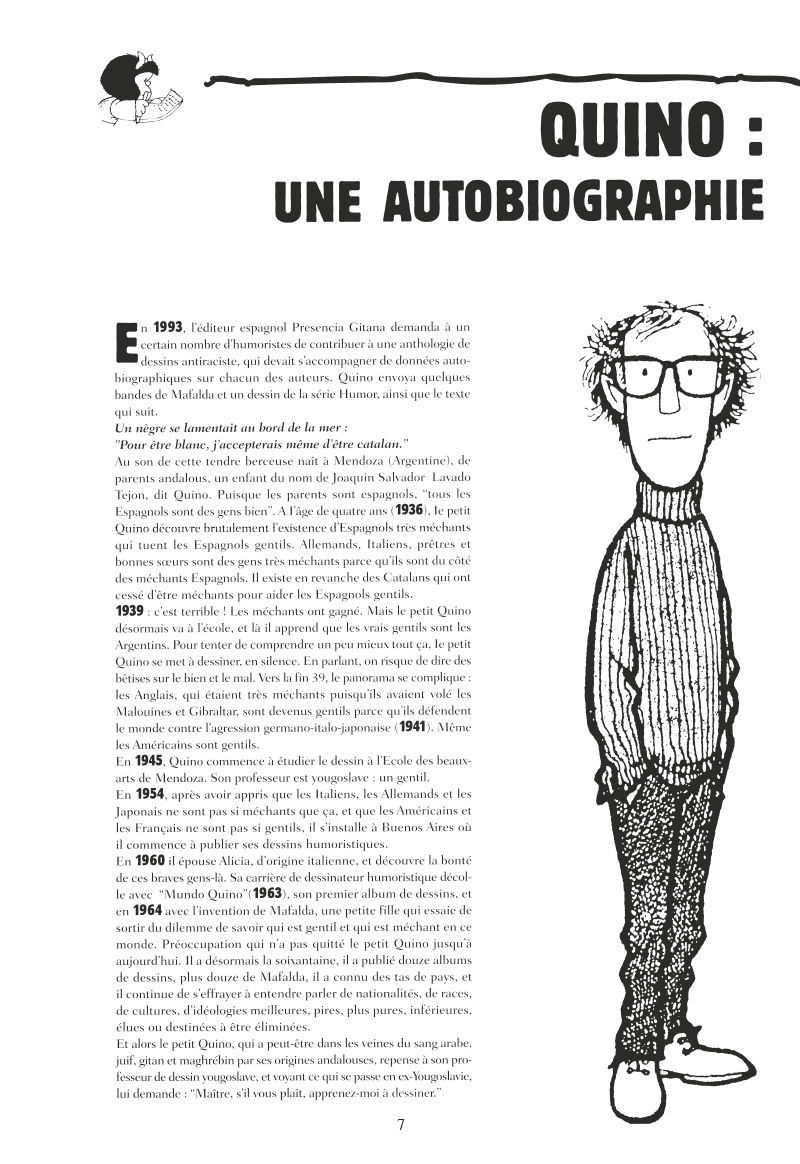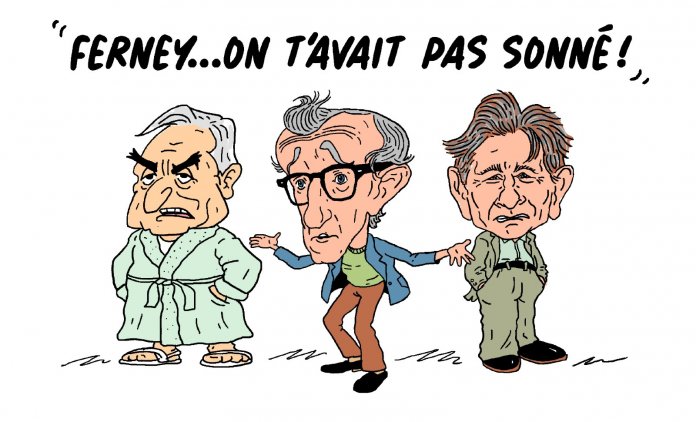De manière virale, la langue est contaminée à grande vitesse par un vocabulaire ou des tournures qui nous forcent à voir le réel différemment.
Depuis quand « problématique » a systématiquement ou presque remplacé le bon vieux « problème »? Faut-il rappeler que « problématique » signifie l’ensemble des problèmes soulevés par une question et n’était guère utilisé que pour préciser la méthodologie d’une bonne dissertation ? On ne devrait pas lire, par exemple, « Lot et Garonne: la problématique de l’eau » comme je viens de le faire.
Je sais, ça fait vieux con (ou Maitre Capello pour les plus anciens d’entre nous). Mais, pour « impacter », on a laissé faire et on a vu le résultat. Impacter, il y a quoi, quatre ou cinq ans, maximum, qu’il a remplacé « toucher ». On va finir avec des « j’ai été très impacté par la mort de mon ami. »
Le monde, cette start-up
Il ne s’agit même plus du franglais dont Etiemble le premier avait dénoncé les ravages dès… 1964. De ce côté-là, notamment dans le monde du management et de l’entreprise (mais le monde n’est-il pas entrain de devenir une gigantesque start-up ?), la bataille est déjà perdue. Un « appel » est définitivement devenu un « call », c’est-à-dire que l’anglicisation n’a même plus l’excuse de remplacer un mot qui n’aurait pas d’équivalent en français. Alors que l’Académie tente pourtant, régulièrement, de faire preuve d’ingéniosité avec des fortunes diverses pour remplacer le mot anglais par un mot français : « divulgâcher » pour « spoiler », par exemple, c’est-dire raconter la fin d’un roman, d’un film ou d’une série à quelqu’un ne la connaît pas.
La chose est plus grave qu’elle en a l’air
Non, cette fois-ci, c’est notre propre langue qui s’auto-intoxique elle-même quand non seulement on a des « problématiques » devant la météo qui « impacte » les transports et qu’on se souhaite quand même une « belle » journée, une « belle » année comme si « bonne » ne suffisait plus.
Tester, tracer, isoler?
Alors, comme diraient les stratèges de l’épidémie, il faudrait tester, tracer, isoler si on ne veut pas se retrouver coincé dans la novlangue post-technocratique des chaines infos, des politiques de second ordre, des managers et autres « communicants ». Parce qu’un jour, quand les bars seront rouverts, un honnête bistrotier de Coudekerque-Branche vous dira « J’ai une problématique avec la pression » et vous répondrez, sans même vous en rendre compte « Moi qui rêvais d’une mousse bien fraîche. Ça va m’impacter le moral. »
A lire ensuite: Aya Nakamura, le grand remplacement lexical?
Oui, tester, tracer, isoler et, éventuellement, ouvrir des centres de rééducation linguistique pour les patients zéro. Parce que la chose est plus grave qu’elle en a l’air.
On ne pense pas en dehors des mots expliquait le philosophe Wittgenstein et on voit bien que se laisser par lassitude, habitude ou inattention, imposer des mots, c’est se laisser imposer une manière de penser. Cette défiguration de la langue peut servir à manipuler tout en masquant l’incompétence, le vide ou le mensonge de tous ceux qui ont intérêt à vous faire entrer dans leur vision du monde et vous la faire accepter malgré vous. Point besoin de police politique pour cela. L’envahissement médiatique dans nos vies des chaines infos ou des réseaux sociaux suffit : ça parle et ça écrit vingt-quatre heures sur vingt-quatre…
Désintoxication
Il y a bien un moyen de se désintoxiquer, malgré tout, et ce moyen c’est la littérature ou la poésie. La langue qui s’y déploie n’est pas une langue zombie. On y retrouve la beauté du monde et un ciel dégagé pour les émotions et la pensée. Mallarmé voulait ainsi redonner « un sens plus pur aux mots de la tribu » ou comme le disait Kafka, « faire un bond hors des rangs du meurtrier. »