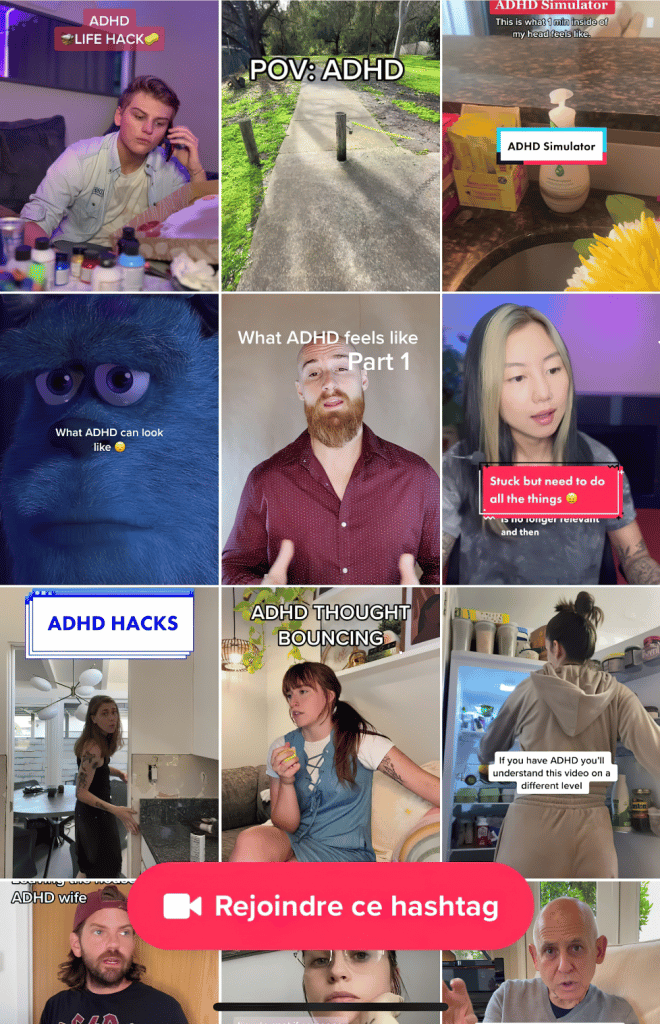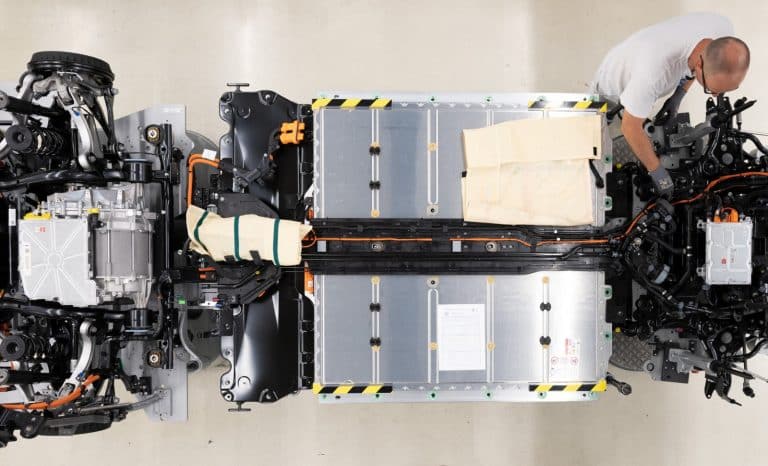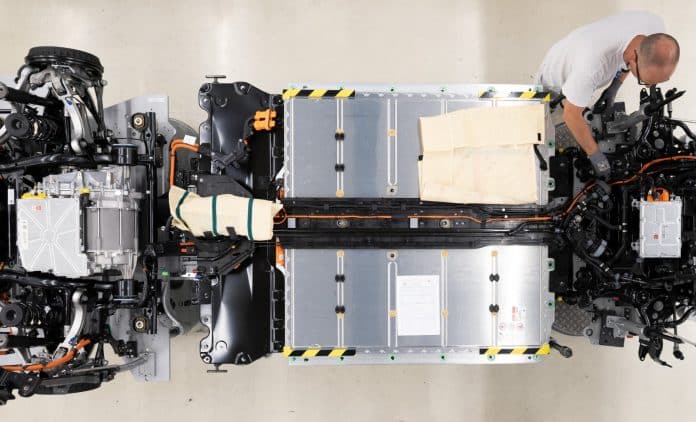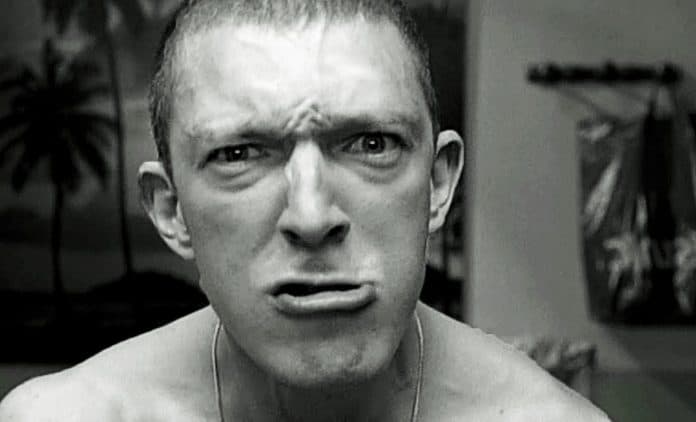32 mineurs vivant dans des camps kurdes ont rejoint la France, mardi 24 janvier. Ainsi que 15 femmes, loin d’être repenties. Que l’on soit pour ou contre ce “rapatriement” des djihadistes, le vrai problème n’est jamais vraiment posé. Analyse.
Continuant à rompre avec la politique dite « du cas par cas » qui lui avait valu les foudres bien-pensantes et hypocrites du « Comité contre la torture » de l’ONU, du « Comité des droits de l’enfant » et de l’inénarrable Cour européenne des droits de l’homme, la France vient de rapatrier 15 femmes jihadistes et 32 enfants, retenus jusqu’ici dans un camp de prisonniers en Syrie, à Roj, sous administration kurde. Et si cette décision suscite de légitimes critiques, le véritable problème n’est hélas que très rarement abordé.
Précisons d’abord qu’il s’agit bien de femmes jihadistes. Qu’elles aient ou non porté les armes, elles ont activement soutenu le jihad et collaboré volontairement à l’un des pires régimes totalitaires de l’histoire de l’humanité. Toutes s’étaient rendues de leur plein gré dans les zones contrôlées par les groupes jihadistes, toutes savaient parfaitement ce qu’elles faisaient. Il faut lire et relire les témoignages bouleversants des femmes Yézidies pour ne jamais oublier à quel degré d’abomination celles qui vont être rapatriées (comme celles qui l’ont déjà été) ont participé, et de quelles monstruosités elles se sont rendues complices et coupables. Parler de « femmes de jihadistes » pour relativiser leur culpabilité ne sert qu’à cracher au visage de toutes les victimes de l’État Islamique (EI) : ces femmes égalent en ignominie les gardiennes des camps de concentration, et méritent le même sort que les nazis condamnés à Nuremberg.
On ne peut catégoriquement refuser de récupérer ces criminelles en France
Précisons également que l’on ne peut évidemment pas appliquer le même raisonnement à leurs enfants. Endoctrinés, dressés à devenir des monstres, ceux-ci ne sont évidemment pas coupables du lavage de cerveau infligé par leurs parents et les sbires de l’EI. Pour autant, il serait irresponsable d’oublier qu’ils sont extrêmement dangereux, et que protéger autrui du danger qu’ils représentent doit être prioritaire : leurs victimes potentielles, elles non plus, ne sont pas coupables du conditionnement de ces enfants, et n’ont pas à en subir les conséquences.
A lire aussi: Les Coréens contre les mosquées
Faut-il rapatrier ces femmes et ces enfants ? La réponse ne nous appartient pas réellement, pas plus qu’elle n’appartient à l’ONU ou à la CEDH. Si des étrangers venaient sur notre sol commettre ne serait-ce qu’une fraction des crimes auxquels ces jihadistes ont participé, nous exigerions à juste titre de décider de leur sort, et ne tolérerions pas que leurs pays d’origine nous empêchent de rendre la justice. Bien sûr, la situation de la Syrie et de son territoire est complexe. Mais il n’en demeure pas moins que les victimes de l’État Islamique ont des droits sur ces femmes, et doivent pouvoir les exercer.
La passivité d’aujourd’hui fait le lit des tragédies de demain
De même, nous ne devons pas oublier que nous-mêmes exigeons de pouvoir expulser les délinquants étrangers, n’en déplaise à notre gouvernement. Dès lors, quoi de plus normal que de devoir récupérer les criminels de nationalité française partis à l’étranger ?
Enfin, et malgré le danger qu’ils représentent, des enfants de nationalité française ont droit à un minimum de protection de la part de l’État, quels que soient les torts de leurs parents.
Sauf donc à déchoir ces femmes et leurs enfants de leur nationalité française, nous avons une double obligation : permettre à leurs victimes et à la Syrie d’exercer la justice comme elles l’entendent, d’abord, et assumer notre responsabilité dans le sort de nos ressortissants, ensuite.
Hésitation, tergiversations, laxisme: nos maux français
Pour autant, ces rapatriements sont-ils satisfaisants ? Bien sûr que non ! Pourquoi ? Parce que nous savons tous pertinemment qu’une fois qu’ils arrivent ici, la France se refuse à les traiter comme ils devraient l’être, qu’il s’agisse des jihadistes de l’État Islamique ou de leurs enfants. Et c’est là le véritable problème, c’est pour cette raison que beaucoup s’inquiètent de ce rapatriement et même le refusent, pour cette raison que le gouvernement a tant tergiversé.
Le Quai d’Orsay a beau jeu de dire que « les mineurs ont été remis aux services chargés de l’aide à l’enfance et feront l’objet d’un suivi médico-social », et d’ajouter que « les adultes ont été remis aux autorités judiciaires compétentes ».
A lire aussi, du même auteur: Youssef al-Qaradâwî, le mort dont on peut exceptionnellement dire du mal
Ces femmes qui ont servi l’EI doivent être mises définitivement hors d’état de nuire, ce qui supposerait pour elles la perpétuité réelle ou une condamnation à mort – ce qui est exclu en France. Notre institution judiciaire est notoirement frileuse à l’idée de la perpétuité réelle, et nous nous sommes interdit l’autre solution. Pourtant, les récriminations indécentes de certaines de ces femmes (et de leurs familles) montrent bien qu’elles n’éprouvent pas d’authentiques remords, et qu’il est indispensable de les briser car à ce jour elles ne craignent pas véritablement la France (exactement comme Salah Abdeslam), ce qui est en soi un échec cuisant, et permet de douter très sérieusement de la force dissuasive que l’Etat saura exercer vis-à-vis d’elles dans la durée. Si une rédemption est possible pour certaines d’entre elles, celle-ci ne relève certainement pas des pouvoirs publics, ni de la société, mais d’une espérance métaphysique qui ne saurait être instrumentalisée pour servir d’excuse à un quelconque laxisme judiciaire.
Quant aux enfants, au regard de l’inefficacité évidente des services concernés dans la prise en compte des mineurs délinquants « ordinaires » (je renvoie le lecteur aux remarquables travaux du Dr Maurice Berger sur le sujet), de l’exemple pathétique des « centres éducatifs fermés » qui n’ont de « fermé » que le nom, de la récidive systémique, des profils douteux de certains « éducateurs », des fiascos à répétition avec des mineurs non accompagnés, et ainsi de suite, les déclarations du Quai d’Orsay sont décidément bien cyniques.
On le voit, le problème n’est pas de rapatrier ces femmes et ces enfants, le problème est de refuser collectivement d’agir envers eux comme nous le devrions. Par manque flagrant de volonté politique bien sûr, le mélange de rodomontades et de pusillanimité du gouvernement ne surprenant plus personne, mais pas seulement. Les Français savent manifester pour défendre leurs retraites (et qui le leur reprocherait ?) mais se gardent bien de descendre dans la rue pour exiger un « Nuremberg des jihadistes » et, bien sûr, de l’idéologie qui les anime, et qui a dévoilé toute son abjection dans les crimes de l’État Islamique. Idéologie qui, comme le rappelait il y a peu Rémi Brague, n’est au fond que la stricte application de préceptes du Coran, un livre dont l’apologie a partout pignon sur rue…
La passivité d’aujourd’hui fait le lit des tragédies de demain.