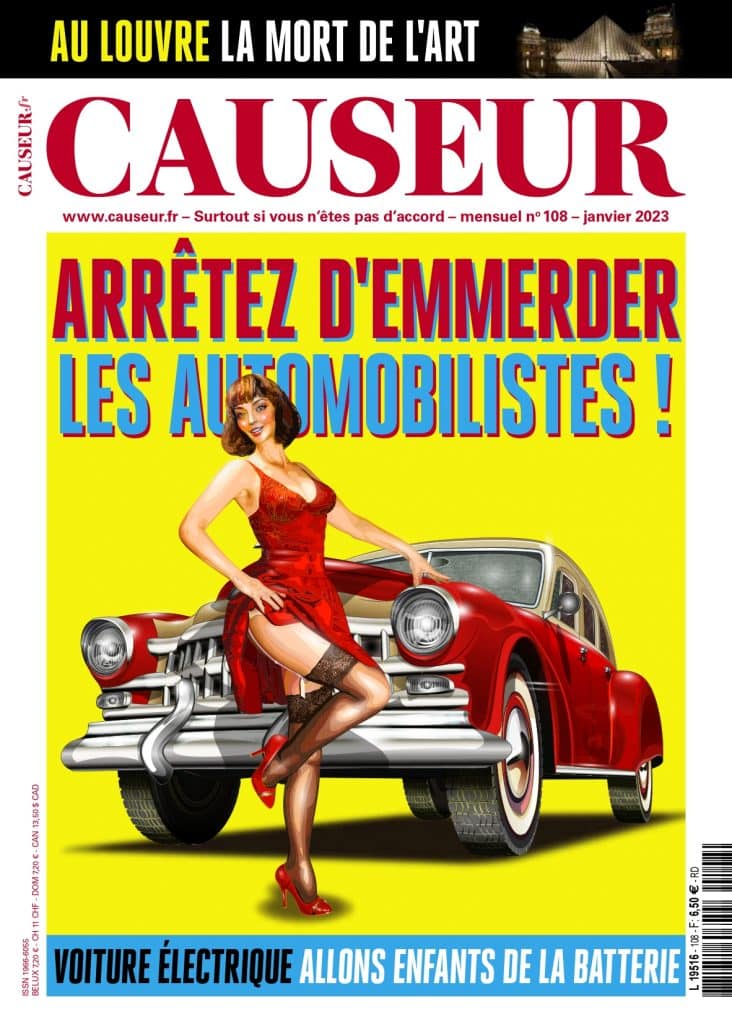France 3 diffuse ce vendredi soir à 21h 10 « Salvatore Adamo, ma vie, la vraie… », une rétrospective de sa carrière écrite par Patrick Jeudy et racontée par Daniel Auteuil.
Et si vous passiez, ce soir, deux heures en compagnie de Salvatore ?
Deux heures où les images en noir et blanc défilent dans un halo de nostalgie, où la chanson d’amour, désuète et essentielle à la compréhension de nos troubles intérieurs, produit un effet sur les cœurs les plus endurcis. Deux heures où la voix de Salvatore, charbonneuse et ensoleillée, ce fil tendu entre la Sicile et les terrils du Hainaut depuis tant de décennies, nous fait voyager dans nos souvenirs. Salvatore ne fige pas le passé, il ne le fossilise pas, il est l’un des rares chanteurs populaires à arpenter cette terre vaste que l’on nomme la mémoire. Il nous libère du poids des années sans oublier ce que nous fûmes. Il arrive sur scène, coiffé et cravaté, dans son costume sur mesure, impeccable, trop sage certainement à l’heure des yéyés. Il a été si bien élevé, alors, on ne se méfie pas de lui. Il ne grogne pas. Il ne bégaye pas à la manière de « Salut les copains ». Il ne massacre pas des guitares électriques sur scène en vantant les vertus des substances illicites. Il ne cherche pas à se faire passer pour un autre, plus révolté, plus libéré, plus moderne, plus équivoque. Il n’a pas besoin de paradis artificiels pour nous emporter ailleurs. Cependant, ne vous laissez pas abuser par sa transparence de façade, cet immigré aux belles manières ne porte pas la pauvreté comme un lourd fardeau ou un étendard démago, Salvatore ne se victimise pas, ne se flagelle pas, il chante indifféremment pour les gamins de la mine et la princesse Paola, pour les lycéennes japonaises et les groupies chiliennes, pour les garde-barrières ch’timi et les romantiques de Passy, sa musique, car il est auteur et compositeur, n’appartient à aucune classe sociale définie. Elle touche partout dans le monde, par l’intelligence de son innocence, la simplicité des choses vécues, là, cet amour qui s’enfuit, ce rendez-vous manqué, toutes les légères meurtrissures du quotidien, Salvatore les capture, en fait son lit et nous les restitue dans leur vérité virginale. C’est la définition même de l’art, un jet direct et prodigieux, une secousse qui ne se ment pas à elle-même.
A lire aussi, du même auteur: À la recherche de l’automobile perdue
« D’inspiration sicilienne, elle est en mineur », il parle ainsi de son inspiration, « anodine et badine » ajoute-t-il, pour en atténuer l’écho. Sa modestie, parfois surjouée, ne nous trompe pas sur son intention première, cristalliser les cahotements des temps indécis. Quand « Tombe la neige » éclata à la radio en 1963/1964 et fit de lui, en un éclair, une vedette riche et assaillie par des centaines de jeunes filles, il y avait déjà dans ce tube planétaire les ferments de la mélancolie.
Ce slow désespéré et tendre est un cri dans la nuit ; à tous les âges de la vie, nous succombons à ce fado lancinant et poignant. La voix de Salvatore, ce torrent de rocailles, agit comme un détonateur, il révèle nos failles, les explose à la dynamite, nous met à nu et nous apaise. Nous ne pouvons retenir nos larmes. Ses paroles d’une sobriété jésuitique sont un appel à la résilience, à monter dans cet impassible manège. Salvatore, petit frère de Brel, redonne aux mots, leur force tellurique, l’onde du fracas est en lui. Il faudrait être sec et bien insensible pour ne pas chavirer au son de « Requiem pour six millions d’âmes » et à sa « Jérusalem coquelicot sur un rocher ». Lors de son Olympia 1965, le fils de puisatier devenu mineur, reçut la reconnaissance du métier. Le tout-Paris l’applaudit durant de longues minutes. Bruno Coquatrix veillait sur lui derrière le rideau rouge, Richard Anthony et Gilbert Bécaud l’embrassèrent à la fin de son tour de chant, Françoise Dorléac le couvait d’un doux regard, et Mauriac préparait déjà sa chronique enthousiaste du lendemain.
A lire aussi, du même auteur: Sophie Marceau: un amour de jeunesse qui ne s’est jamais démenti
Durant deux heures, Salvatore se livre sur sa carrière, un mot qu’il n’aime pas, sur ses parents, son frère et ses sœurs, ses enfants, sur le Liban, sur les incompréhensions d’Inch’Allah, sur une vie de rock-star dans la peau du gendre idéal, sur sa vie privée, sur la solidarité entre émigrés dans le Nord, sur son compatriote Arno disparu en avril 2022, sur les filles du bord de mer, sur l’essence même de sa musique. Alors, vous permettez Monsieur Adamo que l’on vous place très haut dans la chanson française.