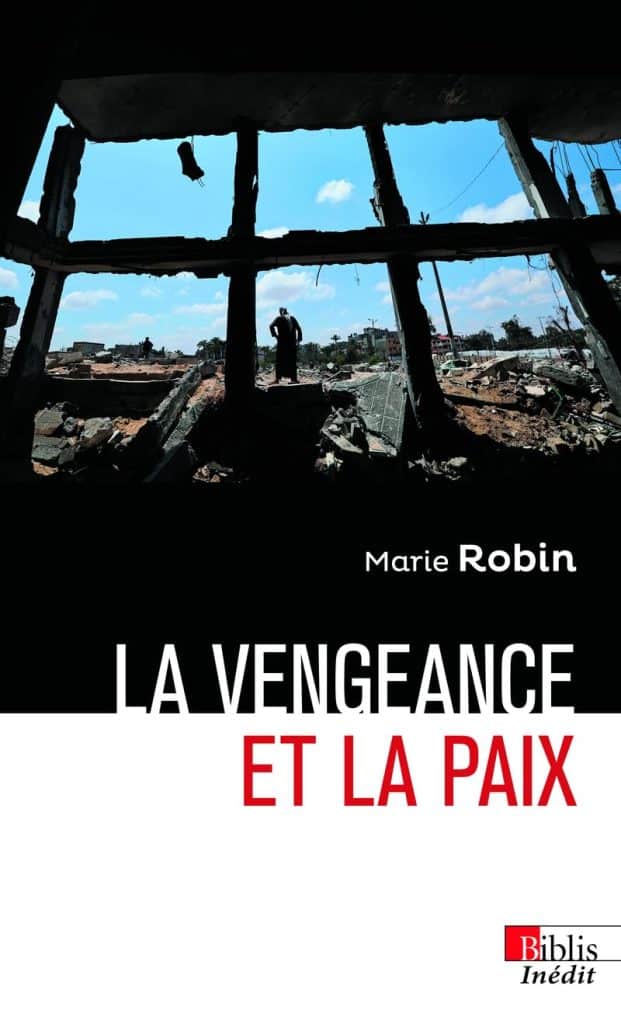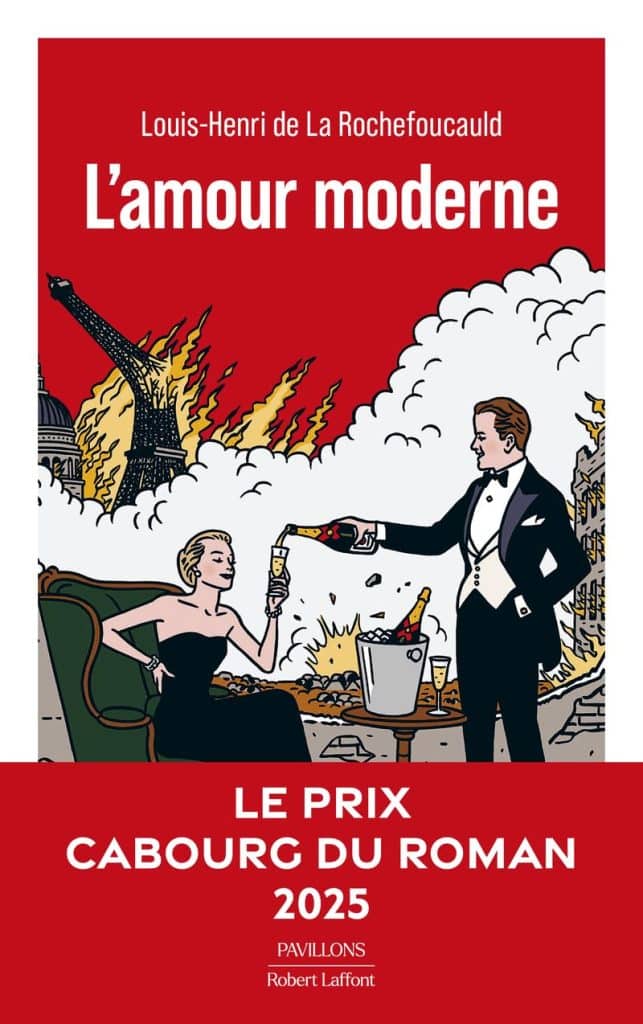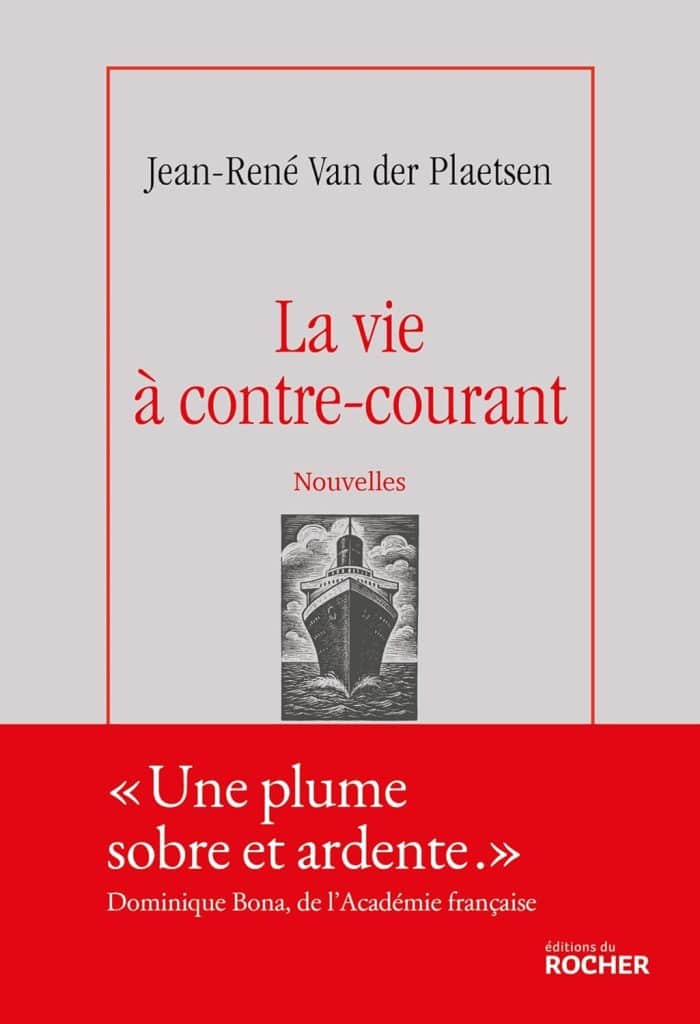La fille de Jean-Pierre Elkabbach rend hommage à la carrière de son père disparu en octobre 2023 dans un documentaire. Ce film pudique et introspectif diffusé hier soir sur France 5 est disponible désormais sur le site France TV. On y voit l’ascension, les chutes et les relances d’un pape de l’information aussi détesté que suivi par des millions de téléspectateurs. D’Oran à l’Élysée…
Au début, on regarde ce documentaire avec la défiance naturelle du journaliste. Sur ses gardes. Connaissant l’animal médiatique, l’insubmersible de la Vème République. Connaissant ses ruses, ses connivences, son caractère, sa capacité de nuisance, ses emportements d’enfant triste, son ambition d’enfant pauvre, nous ne faisons pas le poids. Il était particulièrement retors pour arriver à ses fins. Presque trop folklorique pour être crédible. Carnavalesque. Cassant. Parodique. Terreur des rédactions durant cinquante ans, la bleusaille longeait les murs à sa vue. Aussi redouté que moqué. Imité donc clairement identifié comme une cible par les oppositions changeantes et successives. Pugnace jusqu’à la déraison. Homme lige ou homme libre ? Factice dans sa recherche d’audience à tout prix et, malgré tout, sincère à l’antenne, presque transparent, émotif, Méditerranéen épidermique. Un paradoxal ne sachant pas jouer l’indifférence. Une opiniâtreté sans égale dans le métier. Troublante à certains égards. Ayant compris le sens du spectacle et de l’information à une époque de ronds-de-cuir.
A lire aussi, Didier Desrimais: Peut-on être un golden boy et gauchiste?
Ayant compris que sans tension dramatique, il n’y avait pas de bonne interview politique. Ayant cassé le ronron des débats par des ruptures de rythme. Une voix à rebours, de musicien de Free Jazz. Cent fois viré, écarté, ostracisé par les pouvoirs en place et renaissant sur une antenne, par la petite porte. Jamais mort, toujours debout. Un personnage trop entier et trop autocentré pour susciter une adhésion totale. Alors, on regarde « Jean-Pierre Elkabbach, autoportrait de mon père » réalisé par Martin Veber (disponible sur le site France TV jusqu’en avril 2026) avec suspicion et néanmoins une attirance gênante pour ce ténor de la radio et de la télévision. Il a toujours été là. Avant notre naissance, il squattait déjà le poste avec ses certitudes. Des décolonisations aux mondialisations malheureuses, des soirs d’élection présidentielle à la Bibliothèque Médicis, il avait pris racine. L’instigatrice de ce projet casse-gueule car l’ex-homme publique n’a pas que des amis n’est autre que la fille d’Elkabbach, l’actrice Emmanuelle Bach. On est rassuré. On sait que l’on ne tombera pas dans l’hagiographie mielleuse, ni dans le bureau des plaintes. Ni ripolinage à la gloire, ni procès accusatoire contre papa absent. Ni larmoiement, ni esquive. Et pourtant, une vérité apparait, en filigrane. Douce-amère par moments, aimante toujours. Il faut dire qu’avec cette comédienne trop rare, d’une intensité remarquable, on est étonnamment en confiance. Avec elle, on veut bien ouvrir la boîte aux souvenirs et suivre son histoire personnelle avec la grande histoire du monde en marche. Là où son père avait décidé d’interagir. Jean-Pierre était un buteur, un avant-centre, il ne laissera pas l’Histoire le piétiner. Il sera toujours de la partie, du voyage.
A lire aussi, du même auteur: Derrière l’horizon…
C’est une épopée qu’elle nous conte et pas une réflexion sur la moralité du journalisme dans le chaos des actualités. Tant mieux. La carrière de son père n’a pas valeur d’exemple ou de repoussoir. Elle n’est pas injuste avec lui. Le contraire aurait été fortement déplaisant. Grâce à des images d’archives souvent inédites, on retourne à Oran et l’on se prend même d’affection pour la gloutonnerie de ce gamin qui fait tout pour exister. Elkabbach a perdu son père à l’âge des osselets. Il y a chez lui, une soif de réussite, une rage sociale intacte et salutaire ; une perméabilité aux mouvements culturels de son époque et une joie simple d’homme du soleil. Il aime le foot, Reggiani, Brel, Maria Casarès et pourtant il n’a qu’une envie : foutre le camp et débarquer à Paris. Capitale du monde. Ce Rastignac du Maghreb s’enivre de sorties en Vespa sur les ponts de la Seine et de ses premiers papiers. « Ce qui préexiste, c’est la curiosité » dit-il. Il aura été curieux de tout, il aura tout sacrifié pour l’info et l’égo. Il ne peut être cependant réduit à « Taisez-vous » surtout quand on sait les liens populaires et « amicaux » qu’il entretenait avec Georges Marchais. Toute sa vie, il aura fréquenté les « grands » du monde d’avant avec ce mélange d’excitation enfantine et de fierté professionnelle.
Finalement, on est heureux d’avoir, par son entremise, aperçu de telles bêtes de scène, des carrures inimaginables, impensables à notre époque atrophiée, à la représentation démocratique insignifiante. Revoir Mitterrand et son masque de cire. La silhouette du Général courbée sur un monument aux morts. Sadate dans le prolongement des Pyramides. Deferre et Pasqua au micro. Barbara et la petite Emmanuelle. Ce voyage-là est inoubliable.
Réalisé par Martin Veber, avec la voix de sa fille Emmanuelle Bach. 64 minutes.
Sur France 5 et sur france.tv