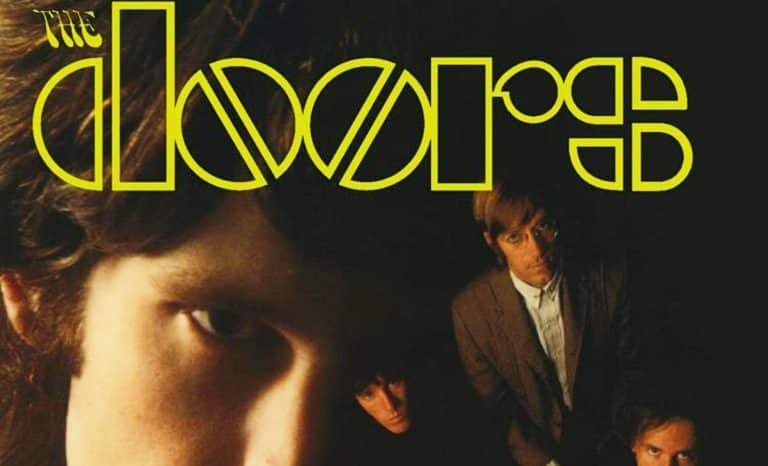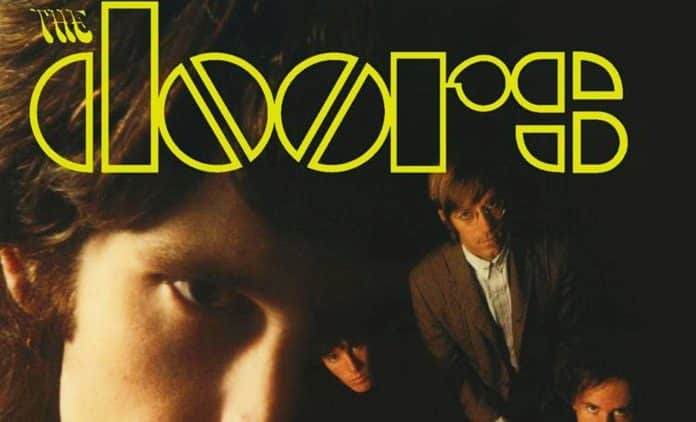Michèle Tribalat a publié le 18 mars 2025 dans Causeur[1] un chapitre qui devait figurer dans un recueil des Presses universitaires de France sur « l’obscurantisme woke ». J’en suis la cible principale. Cette ancienne chercheuse de l’Ined multiplie de longue date les attaques contre moi. Je n’y ai jamais répondu. À mon vif regret, je dois désormais m’y résoudre, car ce qui aurait pu s’en tenir à une discussion scientifique est devenu une diatribe qui met directement en cause mon honnêteté intellectuelle en m’accusant de « tripatouillage », de « malversation », de « mensonge », de « fraude scientifique », et en dénonçant de prétendus errements indignes d’un démographe et « désastreux pour le débat démocratique »… De tels propos vont bien au-delà de ce qu’on pourrait attendre d’un débat scientifique, si vif soit-il.
Aucune des accusations lancées par Mme Tribalat ne résiste à l’examen.
Premier grief: si les Presses universitaires de France ont décidé un temps de ne pas publier son chapitre, c’est qu’elles « craignaient les mesures de rétorsion de François Héran du Collège de France ». La rédaction de Causeur emboîte le pas à Mme Tribalat en dénonçant les « représailles académiques » que j’aurais pu déclencher. Étranges propos, qui ne peuvent recevoir que deux interprétations possibles. La première est l’abus de pouvoir. Du haut de ma chaire du Collège de France, j’aurais menacé les PUF en apprenant la publication prochaine de ce recueil. Le problème est qu’à la date où Mme Tribalat dit avoir appris la décision de l’éditeur, le 12 novembre 2024, j’ignorais tout de ce projet éditorial. J’ai appris son existence en lisant Le Figaro du 11 mars dernier, soit quatre mois plus tard. Je n’ai, du reste, aucun lien avec les PUF (ma dernière publication chez eux remonte à 2009) et j’ignorais même le nom de leur directeur éditorial.
Mais on me suggère une autre interprétation: d’elles-mêmes, sans la moindre intervention de ma part, les PUF auraient considéré qu’un texte aussi agressif s’exposait à un recours en justice. Mais alors, comment croire qu’on ose qualifier de « représailles » ou de « mesures de rétorsion » le simple exercice des droits garantis par la loi de 1881 sur la presse, l’une des lois fondatrices de la République ? Ce serait se moquer de la loi et prendre l’agressé pour l’agresseur. Quelle que soit l’interprétation retenue, l’idée que j’abuserais de ma position pour censurer une décision éditoriale est sans fondement. Je n’ai d’autre moyen pour défendre mon honneur que de recourir au droit de réponse comme n’importe quel citoyen – une première en cinquante ans de carrière.
Second grief: mon appartenance à la cohorte de ceux qui projettent… la « dissolution de la France ».
À cela je réponds que personne n’est propriétaire de l’identité de la France, personne n’a le monopole de l’amour du pays. Mais Mme Tribalat en veut pour preuve mon influence néfaste sur le Musée national d’Histoire de l’immigration, dont elle déplore la création purement « idéologique » par le président Chirac. À l’en croire, j’aurais « fortement inspiré » la nouvelle exposition permanente du musée. C’est faire peu de cas des commissaires scientifiques qui l’ont conçue, quatre historiens et géographes connus pour la solidité de leurs travaux. C’est surtout se méprendre sur l’objectif de l’exposition : non pas dénigrer notre pays mais rappeler, documents à l’appui, que l’histoire de l’immigration fait partie intégrante de l’histoire de France. Libre à chacun d’afficher son désaccord ; cela n’autorise pas Mme Tribalat à faire du collectif qui a préparé cette exposition un fossoyeur de la patrie. Aucun parti pris politique ne guide mes analyses. La « neutralité engagée » que je revendique et que décrie Mme Tribalat s’énonce aisément : ce ne sont pas mes convictions qui dictent mes recherches mais mes recherches qui dictent mes convictions.
Autre faute majeure, j’aurais « naturalisé » l’immigration en la jugeant aussi irréversible que le réchauffement climatique ou le vieillissement des populations. Cette doctrine, assure Mme Tribalat, qui m’attribue décidément de grands pouvoirs, aurait même inspiré Gérald Darmanin. C’est oublier que ni le vieillissement démographique ni le réchauffement de la planète ne sont des phénomènes naturels. Ils sont le produit d’une activité humaine, le résultat de choix collectifs. Évoquer la banalité de l’immigration, ce n’est pas la « naturaliser », c’est constater qu’elle a pris historiquement toute sa place dans nos sociétés, d’autant que le mouvement n’est pas près de ralentir: depuis l’an 2000, en près de 25 ans, le nombre des immigrés compilé par la division de la Population de l’Onu a augmenté de 70% de par le monde, de 105% dans l’Espace économique européen élargi (Grande Bretagne comprise), de 50% en France. On peut rêver d’une réduction drastique de l’immigration, promettre aux électeurs d’inverser la courbe, leur raconter qu’il suffira pour cela de redoubler de fermeté…, une autre approche est envisageable: non pas juguler l’immigration mais la réguler, ce qui ne veut pas dire lui laisser libre cours. De toutes les options possibles, quelle est la plus réaliste ? Où est la « croyance », où est l’illusion ? Qui donc refuse de regarder la réalité en face ? Dans la pensée binaire de Mme Tribalat, c’est simple : l’idéologie et l’aveuglement sont toujours dans le camp adverse. C’est ignorer que le réel est autrement plus complexe.
Concernant les entrées de migrants en France, j’aurais « apposé mon sceau à des tripatouillages statistiques » avant de faire machine arrière. Contresens, là encore. On m’oppose la tribune que j’ai publiée lors de la pandémie de Covid. J’y rappelais que le virus franchissait les frontières sans faire de différence entre les migrants, les visiteurs et les touristes. Il était donc vain de s’en prendre aux seuls migrants pour bloquer le virus s’ils représentaient une fraction minime des 90 millions d’entrées annuelles sur le territoire. Si j’arrivais à une estimation de 550 000 immigrations par an, ce n’était pas en commettant des doubles comptes que je condamne par ailleurs, mais en ajoutant les ressortissants de l’Union européenne installés en France, non inclus dans la statistique des titres de séjour mais tout aussi exposés à la pandémie. Mme Tribalat a beau s’indigner en multipliant les points d’exclamation, nulle palinodie, nul tripatouillage dans ce propos de bon sens.
Ce n’est pas tout. Michèle Tribalat use d’un vocabulaire choisi en évoquant la « fessée » que j’aurais administrée au journaliste Stephen Smith, auteur d’un essai fracassant sur la « ruée » des Africains vers l’Europe, salué dans les médias et doté de plusieurs prix. C’était en septembre 2018. Pour Mme Tribalat, ma critique était une « exécution », alors qu’il s’agissait d’une réfutation chiffrée comme il s’en pratique dans le monde des sciences, et sur un ton parfaitement serein. Mais voici l’argument-massue : j’aurais commis une « erreur méthodologique flagrante » en méconnaissant le fait qu’entre 1982 et 2015, la population subsaharienne a augmenté plus vite en France qu’en Afrique. Pire encore, le piètre démographe que je suis aurait persévéré dans l’erreur en refusant de faire amende honorable.
Rien n’est plus faux. J’ai analysé cette objection à trois reprises : le 10 janvier 2019 dans mon cours public accessible en ligne; en mars 2019 dans le mensuel L’Histoire; en octobre 2021 dans un manuel de la Documentation française – et toujours dans les termes les plus courtois. Je n’ignorais pas que la France comptait en 2014 cing fois plus d’immigrés subsahariens qu’en 1982. Mais, dans le même temps, les immigrés britanniques en France ont été multipliés par 4, les Roumains par 8, les Chinois par 16 – des hausses très supérieures à la croissance démographique de leur pays d’origine, sans que personne y voie l’annonce d’une submersion. Car c’est un phénomène bien connu des études migratoires : les nouveaux courants d’immigration, pas seulement ceux venus d’Afrique, connaissent souvent un rythme de croissance intense dans leur phase d’émergence, évidemment supérieur à la hausse de la population dans les pays de départ, avant de revenir à un rythme plus modéré. On l’a vérifié en France pour des courants plus anciens : portugais, turc, tunisien, etc. On se trompe quand on perpétue pour les décennies à venir le rythme de croissance initial d’un courant migratoire. La précaution à prendre, en revanche, était de vérifier, comme je l’ai fait, que la part des migrants subsahariens rejoignant l’Europe ne variait guère au fil des décennies.
Lorsqu’ils émigrent, c’est à plus de 70% vers d’autres pays subsahariens, du fait, notamment, des accords régionaux de libre circulation. J’ai intégré cette donnée dans mes projections, en même temps que la forte hausse de la population africaine prévisible dans les décennies à venir.
La suite des événements n’a pas encore tranché entre nos deux points de vue. De 1982 à 2023, le nombre des immigrés maghrébins est resté stable en France, alors que la population du Maghreb a doublé. En revanche, les immigrés subsahariens, qui sont une minorité plus récente et plus réduite, sont encore dans leur phase de croissance : leur nombre a progressé plus vite dans cette période que la population subsaharienne en Afrique (une multiplication par 7 au lieu de 3), mais cette hausse reste bien inférieure à celle des immigrés chinois en France (22 fois plus nombreux en 2023 qu’en 1982, alors que la population de la Chine a progressé seulement de 40%). Selon l’Insee, les Subsahariens représentent aujourd’hui 2,3% de la population vivant en France, et leur progression n’est pas exponentielle mais linéaire. Dans le scénario qui justifiait le titre de son essai, Stephen Smith annonçait qu’à ce rythme 25% de la population de l’Europe serait « africaine » en 2050. Il n’hésitait pas, pour le coup, à « naturaliser » la ruée africaine vers l’Europe en jugeant qu’elle était « dans la nature des choses ». Doit-on me vilipender si j’ose dire que ce genre de prophétie me laisse sceptique ? Il y a là matière à discussion et non pas à diatribe. On ne réglera pas la question à coups d’attaques personnelles.
Sur sa lancée, Michèle Tribalat dénonce mes « complices », les rédacteurs du bulletin de l’Ined Population & Sociétés. Elle ne dit mot des trois équipes de recherche que je citais à l’appui de mon travail et dont j’ai repris les méthodes. Basées au Fonds monétaire international, au Joint Research Centre de Bruxelles et à l’International Migration Institute d’Oxford, ces équipes avaient décrit l’évolution des migrations africaines vers l’Europe en exploitant les bases de données ignorées de Stephen Smith. Or mon diagnostic rejoignait le leur. Faut-il croire que ces équipes de rang international étaient aussi nulles que moi en démographie? Ont-elles trempé dans le vaste complot visant à détruire l’identité de la France ? Pourquoi mon intraitable lectrice occulte-t-elle ces références qui corroboraient largement mon travail ? Les réfuter aurait nécessité d’étendre l’accusation d’« incompétence » et d’enfermement dans l’« idéologie » à une communauté internationale à laquelle je suis étroitement associé : j’ai présidé l’EAPS (l’Association européenne de démographie basée à La Haye) de 2008 à 2012 et j’ai dernièrement publié aux éditions Routledge de New York et aux Presses universitaires de Stanford.
Michèle Tribalat est persuadée de détenir la vérité ultime en matière de migrations. Ses anathèmes ont toujours deux temps: soulever des objections d’apparence technique, avant de basculer sur le registre de la condamnation morale infamante. Elle me campe en champion de la « malversation » statistique et de la « fraude scientifique », membre d’une institution trop éminente pour être honnête, « wokiste » assoiffé de pouvoir, menaçant ses rivaux de « rétorsions », rêvant de « dissoudre » l’identité de la France et ne songeant qu’à servir les intérêts de l’« élite dominante » avec de « désastreuses » conséquences pour le « débat démocratique »… A quand un vrai débat scientifique sur l’immigration, qui cherche à établir les faits plutôt qu’à jeter l’opprobre sur les personnes ?
[1] https://www.causeur.fr/immigration-convertir-lopinion-publique-au-lieu-de-linformer-305819 NDLR