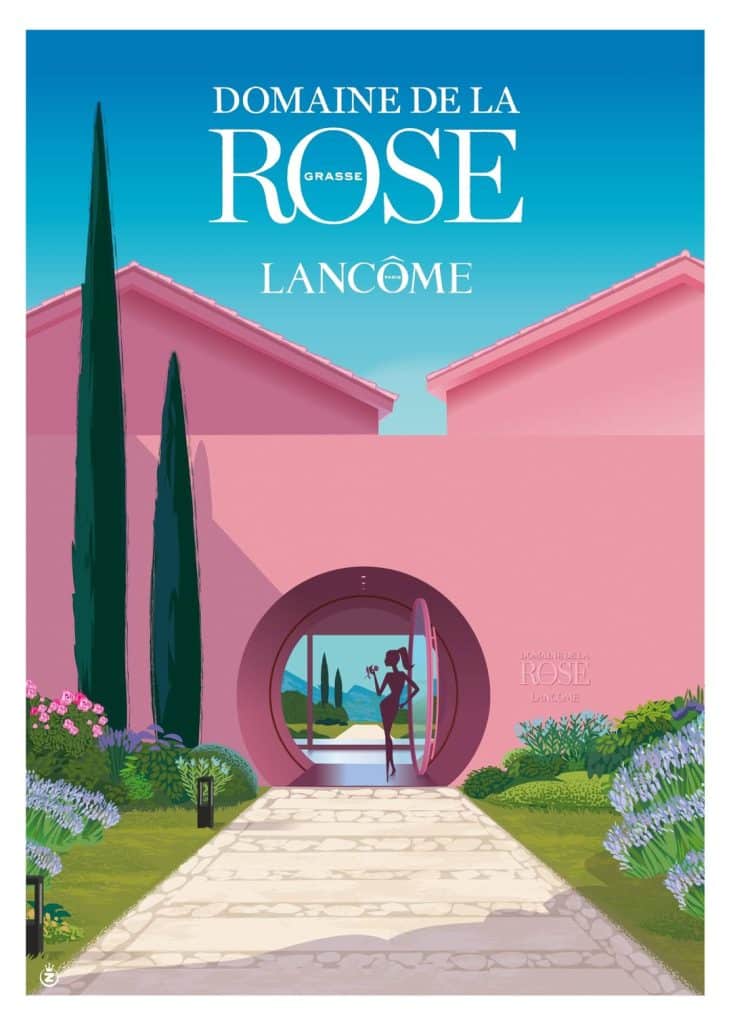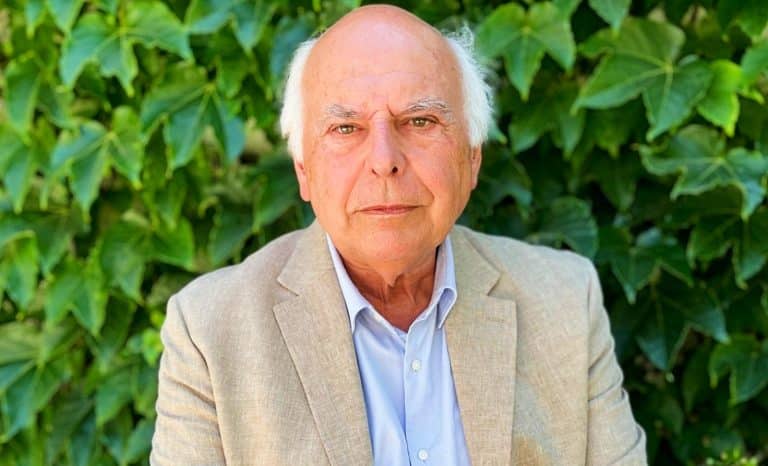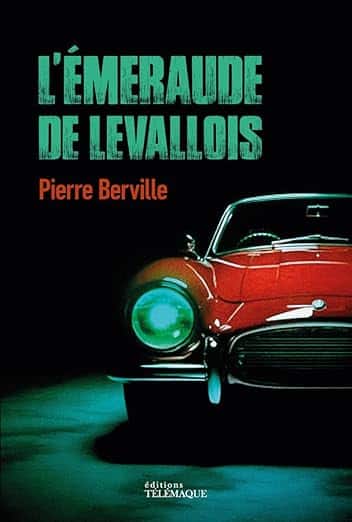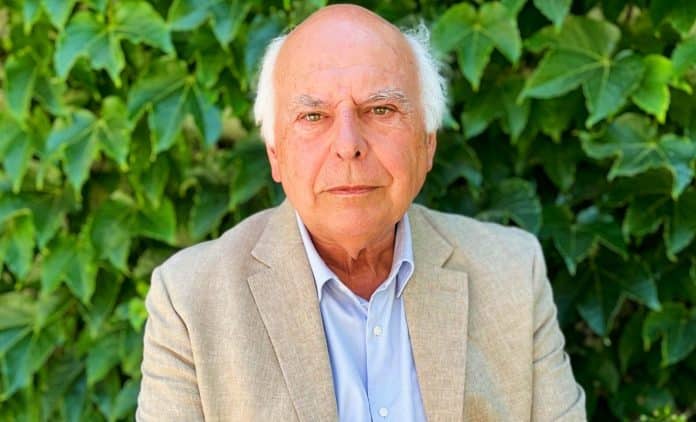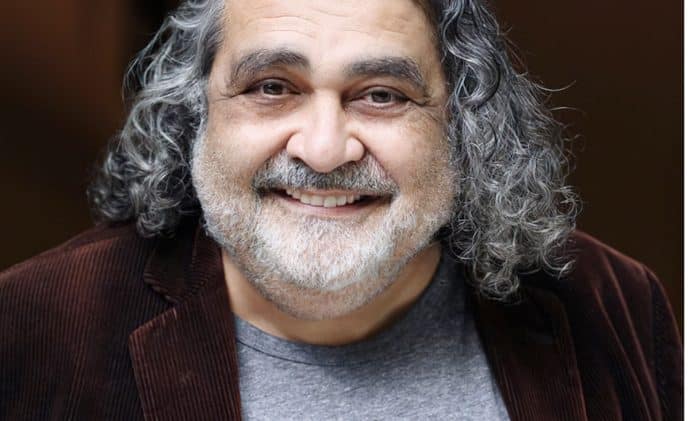Alors que la situation politique en France demeure bloquée, et qu’il n’est pas dit que le poste de Premier ministre ne sera pas de nouveau vacant d’ici au vote du Budget, les progressistes hésitent à interdire l’accès aux villes aux plus pauvres, ou à les empêcher de s’habiller comme ils l’entendent…
On parle beaucoup d’une fin de règne d’Emmanuel Macron, mais moins souvent d’une fin de régime à propos des institutions de la Cinquième République, et encore moins à propos de fondamentaux des rapports sociaux. Pourtant, on voit de plus en plus d’indices qui évoquent la fin de l’Ancien régime dans la façon dont les classes dirigeantes françaises cherchent à maintenir le peuple à distance, et plus généralement dans la manière dont les classes sociales tentent de maintenir leurs signes d’appartenance, par peur du déclassement. On a déjà pu parler d’une forme de réaction nobiliaire à propos des comportements observés lors de la prise de fonction de la nouvelle Assemblée nationale en juillet dernier, et la façon dont les centristes ont fait en sorte d’ostraciser les députés du RN en leur refusant tout poste clé, au profit de la gauche, voire en refusant simplement de leur serrer la main.
La sécession des élites urbaines
Force est de constater que les parallèles de ce genre se multiplient, et illustrent le renforcement de cette crispation sociologique, aux effets éminemment politiques – la fracture croissante, de plus en plus connue et dénoncée, entre la France des villes, et en particulier les élites urbaines, et la France des champs, celle qui « fume des clopes et roule au diesel », selon la formule de Benjamin Griveaux à la veille de la crise des gilets jaunes.
À lire aussi : « Sur les ZFE, je ne lâcherai rien ! »
Et précisément, c’est d’abord ce que l’on cherche à lui interdire : on veut qu’elle ne fume plus, ou de moins en moins, qu’il s’agisse de cigarettes ou de vapoteuses, et qu’elle ne roule plus – c’est tout l’enjeu des ZFE. Celles-ci ont été suspendues par l’Assemblée nationale lors du vote du 28 mai, et si le principe a été « définitivement » abrogé par le vote du 17 juin, il est vraisemblable que l’exécutif n’a pas dit son dernier mot, et sera tenté d’utiliser le Conseil constitutionnel, comme il l’a fait l’an passé pour la loi immigration, pour censurer le vote parlementaire et rétablir ce mécanisme, alors même que la suppression est souhaitée par huit Français sur dix et que la perspective de son maintien a donné lieu au mouvement des « gueux » qui rappelle naturellement les origines des gilets jaunes. Son porte-parole, Alexandre Jardin, a constaté avec justesse que « la macronie s’affirme clairement en sécession assumée par rapport à la République. Elle se referme sur elle-même, durcit ses positions ». Madame Pannier-Runacher a provoqué un tollé en suggérant que les pauvres n’avaient pas de voiture, mais il y a sans doute un fond de vrai dans son affirmation et, surtout, un fait politiquement significatif : les « pauvres » de la France périphérique ne se rendent sans doute que très rarement dans les grandes villes visées par cette loi. Ceux qui s’y rendent en utilisant un véhicule déjà ancien appartiennent plutôt à la classe moyenne, dont le parc automobile vieillit en même temps que son pouvoir d’achat stagne, voire se contracte… Les plus probables victimes des ZFE dépassent donc largement les classes pauvres de la population, et constituent un public qui fait tourner l’économie du pays, paie des impôts, et par conséquent est particulièrement attaché à l’égalité républicaine, l’égalité de droits, et supporte très mal ces vexations sociales comme cette liberté de circulation à deux vitesses ; l’affirmation de l’égale dignité de citoyens est ainsi au cœur du « mouvement des gueux », cependant que le soutien à l’instauration des ZFE apparaît comme la recherche d’un privilège bourgeois.
Un peu de tenue !
Mais il est un nouvel exemple où la crispation bourgeoise paraît se manifester, et où le parallèle avec les privilèges d’Ancien régime semble encore plus flagrant : c’est le cas de la loi anti fast-fashion.
Certes, la proposition de loi déposée en mars 2024 par le groupe centriste Horizons a séduit la représentation nationale très au-delà du centre, puisqu’elle y a été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale en première lecture et à une quasi-unanimité au Sénat, et comme pour les ZFE elle est soutenue par des motifs environnementaux qui font consensus dans la population. Mais il est difficile de ne pas songer aux lois somptuaires en vigueur aux XVIIe-XVIIIe siècles qui visaient à préserver le statut social de la noblesse, en dépit de son appauvrissement relatif par rapport à la bourgeoisie montante, en interdisant à celle-ci de se parer des mêmes étoffes que celle-là. Cette mesure apparut de plus en plus vexatoire pour les roturiers, confinant à l’humiliation lorsque les députés du Tiers État, quoique généralement issus de la bourgeoisie aisée, se virent imposer un habit noir uni et un chapeau sans ornement, tandis que les députés de la noblesse portaient des costumes somptueux, souvent ornés de plumes, de soie, d’or et d’accessoires luxueux, comme des chapeaux à plumes et des manteaux richement décorés. En rendant la mode, y compris la plus éphémère, accessible aux plus modestes, le mode de production et de commercialisation appelé « fast-fashion » efface un autre moyen de distinction sociale, sous le même motif qu’il faut discipliner le peuple et limiter la surconsommation qu’on employait déjà au XVIe siècle : Montaigne disait « régler les folles et vaines dépenses des tables et vêtements »… tout en notant que renchérir le prix des biens ne faisait qu’en accroître le prestige et l’attrait, alors que le seul moyen efficace de les diminuer serait au contraire d’en affaiblir la valeur.
À lire aussi : Alexandre Jardin : Gueux malgré eux
Faut-il aller jusqu’à en conclure que si le moyen est contraire à la fin, c’est que ce n’est pas celle qu’il recherche, mais poursuit plutôt son effet immédiat : maintenir un certain accès à la mode comme outil de distinction sociale ?
Quoi qu’il en soit, ces divers exemples convergent pour donner à voir un malaise général, où les classes sociales se toisent et s’efforcent de maintenir leur statut relatif, alors que l’ensemble du pays fait face à la ruine de l’État et que la méfiance entre les catégories de population s’installe en attendant de voir les efforts demandés dans le cadre de l’élaboration du prochain budget. Cette profonde crise sociale doit être regardée en face, car elle sera lourde de conséquences politiques.