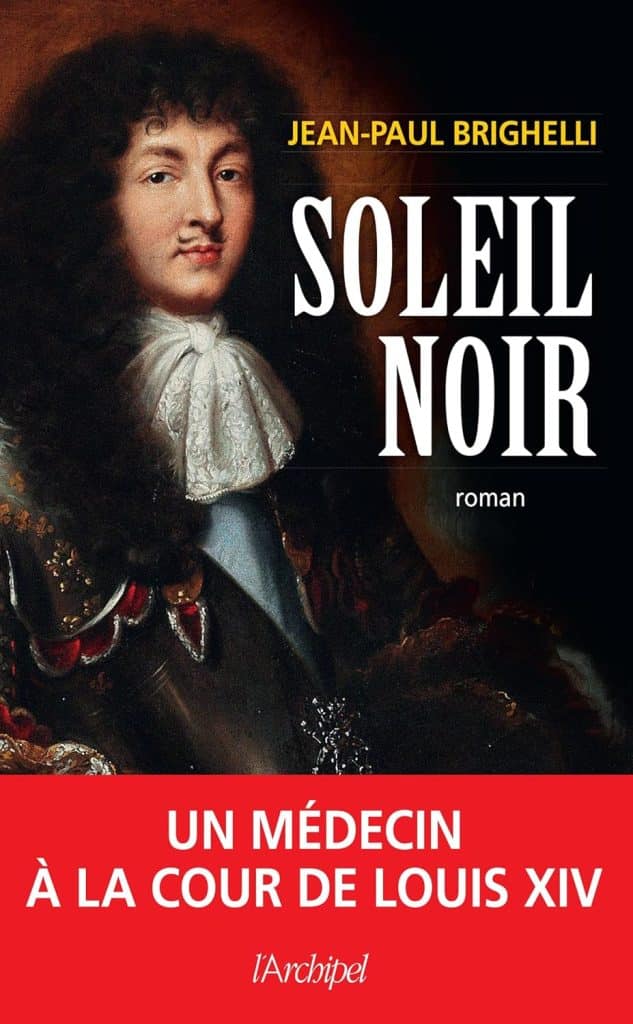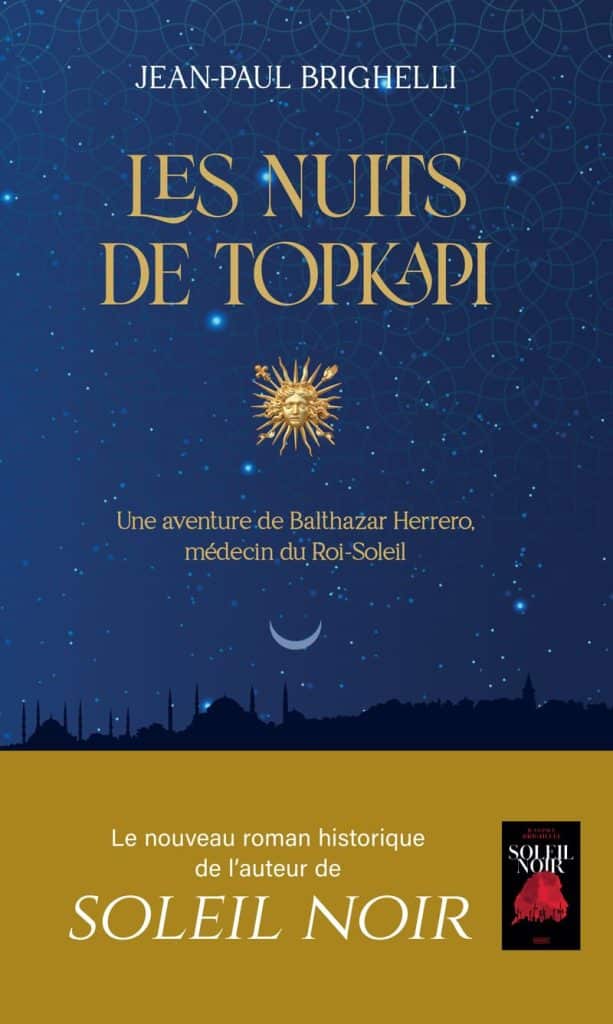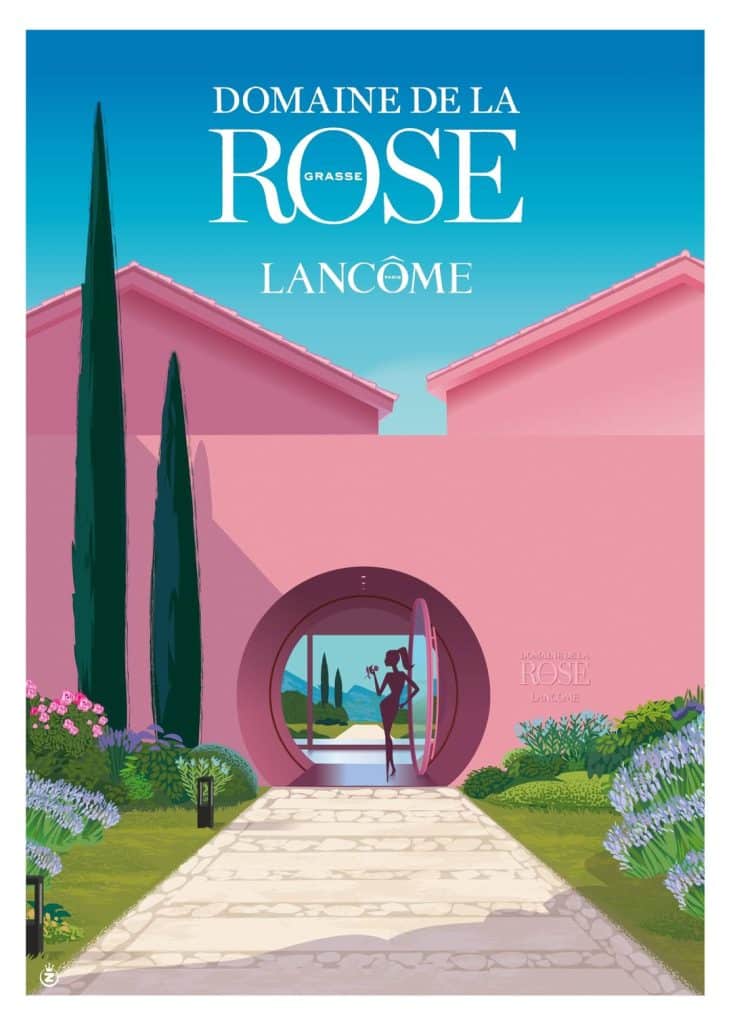86% des Français sont très pessimistes sur l’avenir du « vivre-ensemble » et du civisme.
Le sondage IFOP du 25 juin ne surprend personne, le fond de l’air effraie : individualisme, crétinisation numérique, effondrement éducatif et culturel, croissance en berne, chaos migratoire, violences, narcotrafic, explosion de la dette (3345,8 milliards d’euros, plus 40 milliards en trois mois, 114%, du PIB)… François Bayrou tient son cap, ne fait rien : c’est plus prudent. Emmanuel Macron gesticule comme un hanneton sur le dos. Au fond du bocal, il cherche de l’oxygène. La fin de règne est morose. Encore deux ans. Les Diadoques ont faim. Darmanin, Attal, Philippe : le sprint est lancé !
Un grand concert d’idées brisées
Colbertiste, libérale, patriote, européenne, identitaire, prolo, aristo, orléaniste, bonapartiste, Mariniste, Jordanienne, Jacobine, Girondine, éclatée, fusionnée… Dans le purgatoire depuis quinze ans, les droites hésitent, varient au gré des calculs électoraux et enquêtes du Parquet National Financier. Bruno Retailleau a le vent en poupe. Combien de temps restera-t-il éligible ? La BRI, Tracfin, le Syndicat de la Magistrature et Mediapart sont sur la piste de détournements et financements illicites de Carambars, dans un collège vendéen en 1970.
Les gauches ne vont pas mieux. Olivier Croquignol, Nicolas Filochard et Boris Ribouldingue, se disputent le cadavre du PS. LFI joue cartes sur table, veut faire exploser la nation, sa langue, son histoire, créolise, libanise, vend le pays à l’étranger, à la découpe. Sur le segment porteur mais encombré du lacrymal-victimaire-boulgour-bio, Raphaël Glucksmann a un programme attrape toutous, fusionne les saveurs, enfile les naïvetés et slogans bienveillants comme des colliers de nouilles. À son crédit, la dénonciation de l’ours russe qui menace l’Europe.
A lire aussi, David Duquesne: Charia de transition
Excédé par les casseurs, les crises de nerfs des succubes, harenguières insoumises, lazzaroni, la chienlit, un quarteron de généreux à la retraite, vieux de la veille, en appellent au consensus et à la modération. Trop, c’est trop !
Les forçats de la déroute
Poulidor tranquille de la Social-démocratie, Bernard Cazeneuve plaide –affettuoso allargando- « le retour de la raison en politique, le dépassement des clivages stériles, au service de l’intérêt général ». Son truc c’est « une gauche républicaine, européenne et réformiste, qui refuse tant les outrances que les renoncements ». Un chien parmi les loups, c’est le titre intriguant de son essai. Milou en mai ? Rintintin ? Cubitus ? En 2024, sous le même titre, Marie-Jeanne Rioux racontait les amours d’un pilote d’hélico et d’un biologiste dans le Nunavut canadien. C’est blizzard.
Michel Barnier (Ce que j’ai appris de vous) est porté par une noble conviction : « Chacun est nécessaire ». Il ne donne pas de leçons, mais transmet celles que les Français lui ont inculqué. Voter pour lui, c’est voter pour nous. Bien joué, Michel.
Edouard Philippe frôle le collapsus. Qui paiera Le prix de nos mensonges ? « Nous nous racontons des histoires jolies, rassurantes, glorieuses parfois, qui nous empêchent de proposer au pays des solutions utiles. Pendant que nous nous mentons, les autres avancent, transforment, adaptent, innovent. Et nous nous glosons… Où va-t-il chercher tout cela, Edouard ? Dans Causeur ? Qu’a-t-il fait pendant trois ans ?
A lire aussi, Ivan Rioufol: Villepin, ou ces «humanistes» qui bradent la France
Dominique d’Arabie a trouvé son Chemin de Damas, lance un parti (« La France humaniste »), nous alerte dans Le Pouvoir de dire non. « Il est temps de se réveiller. De déchirer les voiles d’illusions, de renoncer aux reflexes politiciens … Dire non, à ce qui porte atteinte à l’avenir de l’humanité et à la dignité de la république ». Fini les grands moulinets à la Cyrano. De Guiche de la Mirandole Galouzeau de Villepin a muri son projet, affiné depuis 18 ans (son départ de Matignon) : « Une politique d’équilibre et de mesure… Créer les conditions de la recherche du consensus… L’immobilisme, il faut tout faire pour essayer de l’amender ». C’est l’allure finale, les visages du cirque.
Des éléphants, apparatchiks, Esterhazy à l’abri des lambris, s’inquiètent, accusent ! Les pieds-nickelés de la remontada dînent du mensonge et soupent du scandale, s’ébattent dans les Pactes, Grenelle, dénis d’initiés, le « toutlemondisme », des rapports bidons de chercheurs islamo-trotskistes, à l’Hamas et au CNRS. Nos élites lotophages se gargarisent de schibboleth de pacotille : « modèle français », « exception culturelle », repoussoirs qui font éclater de rire à l’étranger. Hors-sol, incompétents, confits dans l’idéologie, aux commandes depuis des générations, ils ont cramé la caisse, plombé le pays, mais restent intarissables sur les leçons de bonne conduite, recettes de potions magiques pour combattre le populisme et défendre l’Etat de droit. Marianne est dans la fosse.
Pas de panique. Il y a le ressenti et la réalité. Les sociologues de France Inter et Télérama sont formels. Dans le passé, le pays a traversé des pics de violence et d’angoisse : Paris en juin 40, en juillet 1793, en août 1572… Haut les cœurs ! Le taux d’exécution des OQTF pourrait atteindre les 10% en 2055. Elisabeth Borne concocte un plan « Zéro machette, Zéro Coke » dans les salles de cours. Sorbonne Université lance un Master 2 d’influenceurs, spécialité « Rap.t-Tag-Crypto ». L’avenir du pays c’est l’éducation, la culture, la jeunesse. 6/20, c’est la barre d’admissibilité pour le concours de professeurs des écoles dans l’académie de Créteil.
« Les hommes sentent dans leur cœur qu’ils sont un même peuple lorsqu’ils ont une communauté d’idées, d’intérêts, d’affections, de souvenirs et d’espérances ». Voilà ce qui fait la patrie. Voilà pourquoi les hommes veulent marcher ensemble, ensemble travailler, ensemble combattre, vivre et mourir les uns pour les autres » (Fustel de Coulanges). Tout s’explique.