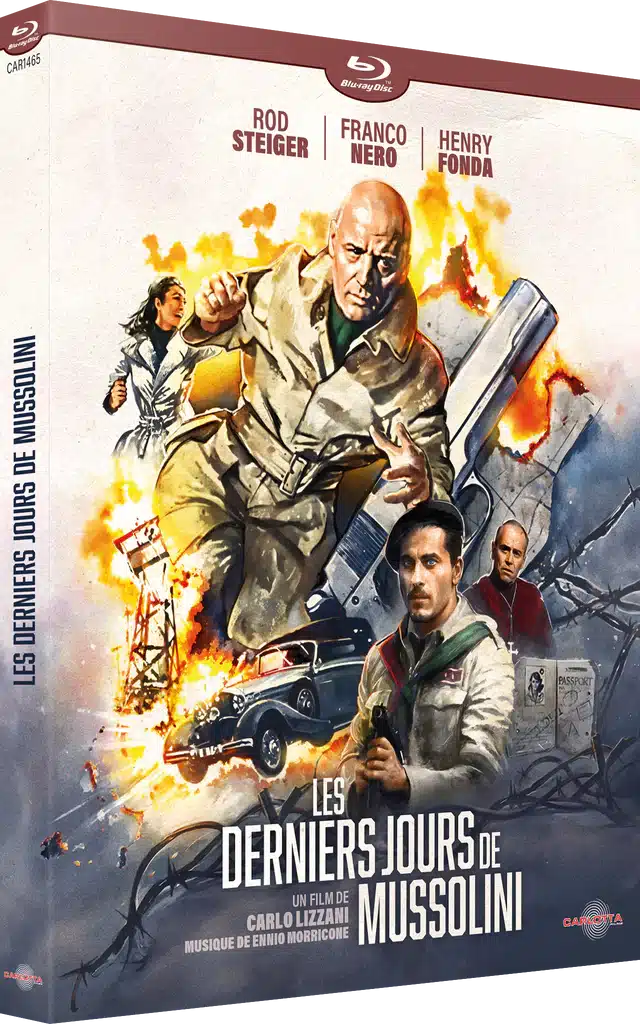Le parti de la présidente pro-intégration européenne et le Bloc Patriotique tourné vers la Russie sont à touche-touche dans les derniers sondages. Analyse des enjeux.
La Moldavie est un pays minuscule par la taille – à peine 2,5 millions d’habitants présents sur le territoire (beaucoup plus si l’on compte sa diaspora disséminée entre l’Italie, la Roumanie, la France ou l’Allemagne). Mais depuis quelques années, ce pays, coincé entre l’Ukraine et la Roumanie, est devenu un laboratoire à ciel ouvert des nouvelles formes de guerre hybride menées par Moscou.
Dimanche 28 septembre 2025, les Moldaves se rendent aux urnes pour élire les 101 députés de leur Parlement. Un scrutin banal ? Non. L’enjeu est immense : il s’agit de savoir si le pays restera arrimé au projet européen défendu par la présidente Maia Sandu et son Parti d’Action et de Solidarité (PAS), ou s’il basculera dans l’orbite russe par le biais d’une opposition pro-Moscou regroupée dans le Bloc Patriotique et ses alliés. Comme souvent en Europe centrale, les élections ne se jouent pas seulement sur des programmes économiques ou
sociaux : elles incarnent un choix de civilisation.
Une campagne sous haute tension
Les dernières semaines ont été marquées par une avalanche d’incidents inquiétants. En effet, des cyberattaques massives ont visé les institutions publiques, certaines étant attribuées à des groupes affiliés aux services russes. Parallèlement, des dizaines de suspects accusés de préparer des « actions violentes » destinées à troubler le scrutin ont été arrêtés. Dans ce contexte tendu, le Premier ministre Dorin Recean a porté des accusations directes, affirmant que Moscou ne cherche pas seulement à influencer l’élection, mais bien à « prendre le pouvoir » à travers elle. Enfin, les tensions se sont également manifestées sur le plan diplomatique : la Moldavie a refusé d’accréditer des observateurs russes, invoquant un risque de manipulation, tandis que Moscou a dénoncé une « violation des standards démocratiques ».
À quelques jours du vote, un sondage publié par l’institut CBS-AXA donnait le PAS à 30% des intentions de vote et le Bloc Patriotique à 28%. L’écart est infime, d’autant que près de 20 % des électeurs se déclarent encore indécis. Dans un système proportionnel, tout peut basculer.
La désinformation, arme de guerre
Ce qui frappe dans cette campagne, c’est l’ampleur des campagnes de désinformation. Rien de nouveau sous le soleil : dès 2014, lors de la crise ukrainienne, la Russie avait utilisé les réseaux sociaux et les médias « relais » pour semer la confusion. Mais en Moldavie, l’offensive est systématique, multiforme, et technologiquement avancée.
On retrouve :
– Des réseaux de bots et de faux comptes diffusant en boucle des messages hostiles au gouvernement.
– Des vidéos truquées à l’IA faisant parler Maia Sandu avec des phrases inventées.
– Des sites clonés de médias occidentaux, publiant de faux articles annonçant, par exemple, que l’Union européenne exigerait la fermeture des églises orthodoxes.
– Des prêtres proches du Patriarcat de Moscou martelant depuis la chaire des sermons où l’UE est assimilée à Sodome et Gomorrhe.
Le tout est amplifié par des chaînes de télé russophones captées légalement ou illégalement en Moldavie, qui déversent un flot constant de récits anxiogènes : « Si vous votez pro-européen, vous serez envoyés à la guerre », « Bruxelles vous privera de votre religion », « l’OTAN occupera votre pays ».
Une société fracturée
Pour comprendre l’efficacité de cette propagande, il faut examiner la société moldave elle-même. C’est un pays fragile, traversé par de multiples clivages. Sur le plan linguistique, une majorité roumanophone, parlant le moldave très proche du roumain, coexiste avec une minorité russophone, héritage de l’époque soviétique, concentrée notamment en Transnistrie et en Gagaouzie. À cela s’ajoute un clivage religieux: si 90 % de la population se revendique orthodoxe, une partie dépend du Patriarcat de Moscou, tandis que l’autre se rattache au Patriarcat de Roumanie. Les fractures sont également économiques : les villes et la diaspora soutiennent massivement l’Europe, alors que les zones rurales, pauvres et vieillissantes, se montrent plus réceptives aux sirènes russes.
Enfin, une réalité brutale pèse sur l’ensemble du pays : la Moldavie demeure l’État le plus pauvre d’Europe, avec un PIB par habitant d’environ 6 000 dollars, et la moitié des familles ne survit que grâce aux envois de fonds de la diaspora. Dans ce contexte, toute promesse de stabilité – fût-elle trompeuse – séduit.
Témoignages du terrain
Dans un village du nord, Maria, 67 ans, confiait au Monde1 : « Je ne comprends pas bien la politique. Tout ce que je vois, c’est que ma pension ne suffit pas. À la télévision russe, ils disent que l’Europe nous prendra tout et qu’avec la Russie, la vie sera moins chère. Je veux seulement vivre en paix. » À Chisinau, en revanche, Ana, 24 ans, étudiante, dit l’inverse : « La Russie, pour moi, c’est le passé, c’est la peur. J’ai envie de voyager, d’avoir des opportunités. Si on s’éloigne de l’Europe, je partirai à l’étranger. » Deux mondes coexistent dans le même pays, deux mémoires, deux horizons.
A lire aussi: Quand Francis Lalanne invente le pacte Mélenchon-Bardella
En Moldavie, la Russie ne se contente pas de faire campagne : elle expérimente. Les laboratoires de l’influence moscovite testent ici toutes les formes modernes de manipulation :
– Bots automatisés capables de publier plusieurs millions de messages par jour.
– Vidéos truquées à l’IA où Maia Sandu appelle prétendument à envoyer les jeunes Moldaves mourir en Ukraine.
– Spoofing médiatique : de faux sites copient l’apparence de médias occidentaux.
L’objectif est double : affaiblir la confiance dans les institutions et démobiliser l’électeur pro-européen en le plongeant dans la confusion.
Les fragilités internes : un terreau fertile
La pauvreté chronique est l’alliée objective de Moscou. Dans un pays où la moitié des familles dépend des transferts de la diaspora, la promesse russe de « gaz pas cher » ou d’« ouverture des marchés » sonne comme une bouée de sauvetage. Autre plaie : la corruption endémique. Même si Maia Sandu incarne une volonté de rupture, la défiance reste immense. Moscou joue sur cette corde : « L’Europe vous parle de transparence, mais vos élites volent », répètent les relais pro-russes.
Identité et mémoire
Est-elle roumaine ? Moldave autonome ? Un pont entre l’Est et l’Ouest ? Les Russes exploitent ce flou. « Défendre la langue russe » ou « protéger la foi orthodoxe » sont autant de slogans qui résonnent.
Géopolitiquement, la Moldavie constitue un maillon stratégique. Elle représente d’abord un levier supplémentaire contre l’Ukraine à travers la Transnistrie, mais aussi une brèche potentielle dans le projet européen. Par ailleurs, elle envoie un signal aux Balkans en montrant que Moscou peut encore espérer retourner certains pays. À l’inverse, un succès électoral du parti de Mme Sandu constituerait une victoire symbolique majeure pour l’Occident.
La Moldavie apparaît comme un miroir grossissant de vulnérabilités européennes. On peut en effet établir plusieurs comparaisons : en Slovaquie, la victoire de Robert Fico en 2023 avait été précédée par une vague de deepfakes à caractère anti-européen ; en Bulgarie, l’instabilité chronique s’alimente à la fois de l’influence russe et de la corruption ; en France enfin, si des campagnes de désinformation ont bien été détectées, elles ont été largement amorties par la solidité des institutions.
Une lecture conservatrice: ordre, souveraineté, vérité
Pour un esprit conservateur, l’affaire moldave ne se réduit pas à une question géopolitique : elle touche aussi à des principes fondamentaux. L’ordre d’abord, car le mensonge engendre le chaos. La souveraineté ensuite, puisqu’une élection manipulée cesse d’être l’expression de la nation. Enfin, la vérité, sans laquelle la démocratie ne peut survivre. Dans cette perspective, Maia Sandu apparaît moins comme une simple technocrate européiste que comme une véritable résistante. Reste alors la question de l’après-28 septembre, qui ouvre trois scénarios possibles. Le premier serait une victoire claire du PAS, permettant la poursuite de la route vers l’Union européenne, mais au prix de réformes douloureuses. Le deuxième verrait le triomphe du Bloc Patriotique, marquant un retour à la dépendance russe. Le troisième, enfin, serait celui d’un résultat serré et contesté, débouchant sur le chaos, des troubles internes et une exploitation immédiate par Moscou. En définitive, ce scrutin s’impose comme un test pour l’Europe entière.
La Moldavie n’est pas une curiosité aux marges de l’Europe. Elle est un test grandeur nature. Si ce petit pays réussit à organiser une élection libre malgré l’assaut de la désinformation, ce sera un signe d’espoir. Si elle échoue, ce sera un précédent inquiétant.