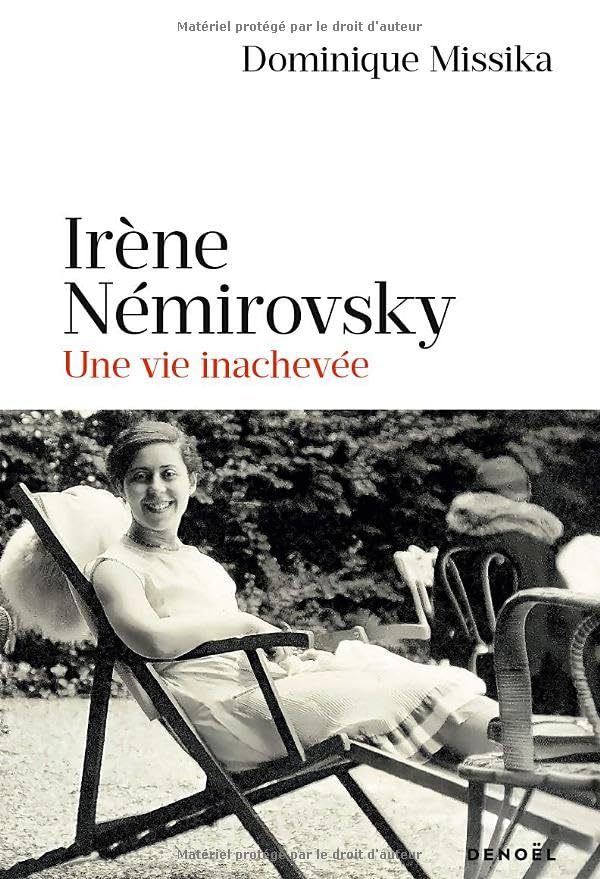L’Amérique du Sud penche de plus en plus à droite. Sitôt élu dimanche soir, José Antonio Kast, nostalgique de Pinochet, a rappelé qu’il donnait aux quelque 340 000 étrangers illégaux jusqu’au 11 mars, jour de son investiture, pour quitter le pays de leur plein gré…

Comme attendu, le candidat de droite, José Antonio Kast, 59 ans, avocat se réclamant ouvertement de l’ancien dictateur Augusto Pinochet, a très largement remporté, avec une avance de 17 points, dimanche 14 décembre, le second tour de l’élection présidentielle au Chili. Il a recueilli 58,3 % des suffrages contre 41,7 % pour sa rivale, Jeannette Jara, communiste qualifiée par la presse locale de « modérée ». Celle-ci avait été désignée candidate à l’issue d’une primaire de l’ensemble de la gauche, incluant la Démocratie chrétienne.
José Antonio Kast double son score
« C’est le pire résultat qu’a enregistré la gauche depuis le retour de la démocratie en 1990 », a souligné lundi le très conservateur El Mercurio, principal quotidien du pays. De son côté, l’autre grand quotidien, le libéral La Tercera, a estimé qu’il s’agissait d’une « très amère défaite ». Deux seules fois au cours des 35 années qui ont suivi le rétablissement de la démocratie en 1990, période durant laquelle la gauche gouvernait avec le centre au sein de l’alliance dite de la Concertation, elle a été battue : en 2010 et en 2017, par une droite classique qui avait pris ses distances avec Pinochet. Elle avait alors obtenu respectivement 48 % et 46 % des voix.
Entre les deux tours, M. Kast, qui avait recueilli 23,9 % au premier, a plus que doublé son score, tandis que Mme Jara, arrivée en tête avec un très décevant 26,85 %, n’a progressé que d’une quinzaine de points. Le succès de M. Kast était acquis dès le soir du premier tour. Les deux autres candidats de droite, Johannes Kaiser, un peu le pendant chilien de Javier Milei, et Evelyn Matthei, représentante de la droite classique et héritière politique de l’ancien président Sebastián Piñera, ont appelé sans la moindre réserve à voter pour lui. Le candidat populiste Franco Parisi, arrivé troisième, avait pour sa part laissé la liberté de choix à ses électeurs. Une bonne partie d’entre eux s’est reportée sur Kast, qui est ainsi arrivé en tête dans l’ensemble des seize régions et dans 90 % des communes.
Cette victoire écrasante de Kast, qui fait de lui le président le mieux élu depuis le rétablissement de la démocratie, interroge. Elle est en quelque sorte une réhabilitation sur la pointe des pieds de l’ancien dictateur dont le régime, tant sur le plan institutionnel qu’économique, a survécu à sa chute en 1990, à l’issue d’un référendum portant sur son maintien au pouvoir. C’est toujours sa Constitution, datant de 1980, qui est en vigueur. Réformée à la marge en 2005, elle a vu les articles instaurant une forme de tutelle de l’armée sur le pouvoir civil abrogés, mais le reste est demeuré grosso modo inchangé. Quant au système économico-social ultralibéral, inspiré par l’école de Chicago de Milton Friedman, il n’a connu que des corrections cosmétiques.
Finis les artifices !
En conséquence, pour la politologue chilienne Stephanie Alenda, l’élection de M. Kast « clôt en réalité, explique-t-elle au quotidien espagnol El País, un cycle politique qui met fin à la dichotomie entre dictature et démocratie », laquelle prévalait de manière quelque peu artificielle. Elle constitue en somme un aboutissement logique, M. Kast ne proposant pas un rétablissement de la dictature, mais la pérennisation du modèle de société pinochétiste, modèle que, convient-il de le souligner, l’alliance entre le centre et la gauche, qui a exercé un pouvoir hégémonique pendant plus de trois décennies, n’a jamais véritablement remis en cause.
Le président élu s’était présenté une première fois en 2017. Il s’affichait alors clairement comme héritier de Pinochet et faisait figure de candidat folklorique. Il n’avait recueilli que 7 % des suffrages. Il récidive en 2021 et, là, surprise : il accède au second tour. Mais il est battu, 46 % contre 54 %, par le candidat de gauche Gabriel Boric, président sortant qui n’a pas pu se représenter, la Constitution limitant à deux le nombre de mandats présidentiels non consécutifs.
Cette année-là, après des émeutes très violentes de 2019 contre la vie chère, provoquées par une hausse du ticket de métro et bus à Santiago, la capitale, la campagne avait été axée les questions sociales. Cette fois-ci, c’est M. Kast qui a donné le ton en imposant le thème de l’insécurité consécutive à un afflux massif d’immigrés essentiellement vénézuéliens. La candidate de gauche a reconnu son erreur d’avoir négligé cette préoccupation partagée par une majorité d’électeurs des classes populaires, les premiers affectés.
Dimanche soir, M. Kast a rappelé qu’il donnait aux quelque 340 000 étrangers illégaux jusqu’au 11 mars, jour de son investiture, pour quitter le pays de leur plein gré. Quant à ceux qui sont en règle et ont un travail, ils n’ont pas souci à se faire. Ils sont les bienvenus, a-t-il affirmé.
Sa victoire s’inscrit aussi dans un glissement à droite de l’Amérique latine entamé en décembre 2023 par l’élection de Javier Milei en Argentine, puis conforté, à la surprise générale, par son succès aux législatives de mi-mandat. Le 8 novembre, le démocrate-chrétien, Rodrigo Paz Pereira, le candidat qu’on n’avait pas vu venir, était élu à la tête de la Bolivie, mettant fin à deux décennies de régime ethnico-socialiste d’Evo Morales, aujourd’hui retranché dans son fiel du Chapare, région de la culture de la feuille de coca très liée au narcotrafic.
Des élections générales doivent avoir lieu au Pérou en avril prochain et en Colombie en mai. La droite est, d’après les études d’opinion, en position de l’emporter. Au Brésil, le mandat de Lula expire à l’automne 2026. Il a laissé entendre qu’il serait disposé à se succéder. À ce stade, s’il se présente, il apparaît comme favori. Mais au sein de la gauche brésilienne, certains s’interrogent : Lula est-il encore réellement de gauche ou s’est-il mué en cacique se revendiquant de gauche ?