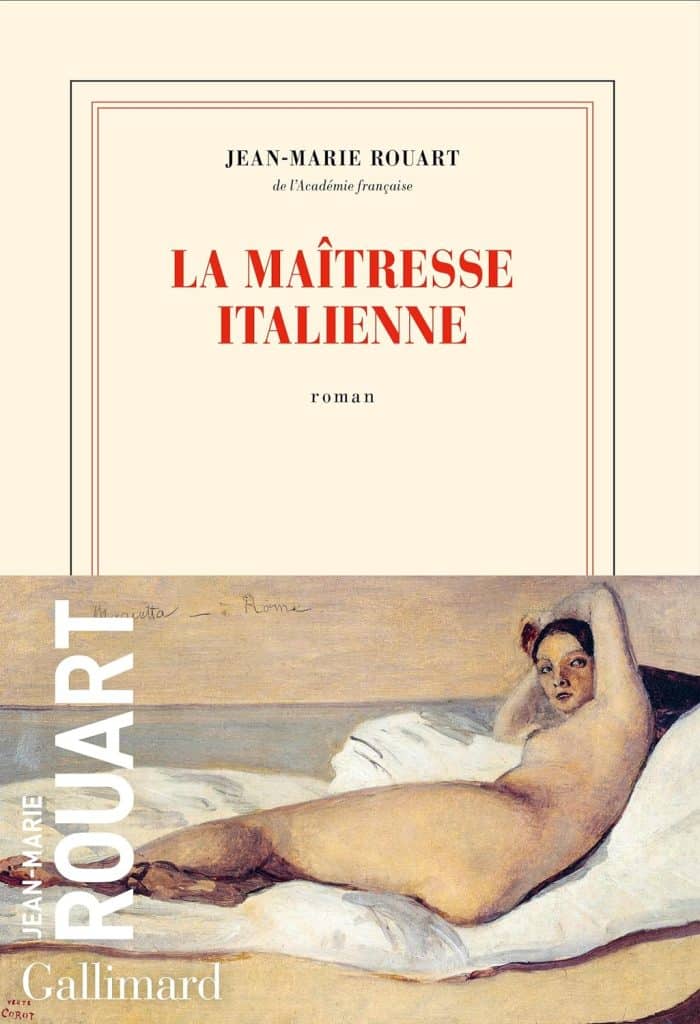Le roman de Cécile Chabaud retrace l’étrange parcours de Georges Despaux (1906-1969). Ce collabo notoire a été déporté par les nazis à Auschwitz et Buchenwald puis condamné à l’indignité nationale à la Libération. L’horreur des camps a pourtant révélé chez ce marginal une grande humanité.
Certains d’entre nous vivent entre chien et loup : dans la lumière, ils se perdent, dans l’ombre, ils s’égarent. Ils incarnent notre humanité inquiétante et pitoyable et, parfois, admirable. C’est le travail de l’écrivain de remonter la piste qui mène de leur déchéance à leur énigme. Cécile Chabaud est un écrivain.
Pendant la guerre, M. Mélenchon aurait-il été résistant ou prudent ? Maquisard en blouson de cuir ou petit pépère du peuple en charentaises ? Ne pouvant répondre pour moi-même, je ne saurais me prononcer pour notre trotskyste d’arrondissement. Mais je l’imagine sans peine, à la Libération, en imprécateur de prétoire. Les coupables, réels ou supposés, auraient-ils eu la moindre chance devant ce justicier expéditif qui se serait levé tôt pour requérir, ce « matin du 6 décembre 1945, où s’ouvrait le procès d’un salaud » ?
C’est compliqué !
L’homme que l’on va juger, à Pau, se nomme Georges Despaux (1906-1969). Souffreteux, contrefait, il a l’apparence de ces personnes prodigieusement maigres, avec, dans le regard, un reflet de lassitude et de découragement, et que l’on appelait les déportés. D’ailleurs, c’est un déporté : d’abord à Auschwitz, ensuite à Buchenwald, où il se lie d’une amitié fraternelle avec Samuel, un juif originaire de Louvain, en Belgique. Pourtant, peu de temps avant sa déportation, il avait écrit des articles éclaboussés d’une tache indélébile d’encre antisémite, dans une feuille de chou éditée par la branche locale du Parti populaire français (PPF), fondé par Doriot, que Sophia Chikirou croit reconnaître dans Fabien Roussel, actuel chef du Parti communiste, auquel appartenait avant sa conversion au nazisme ce même Doriot !
Contre l’illusion de l’apparence
Cécile Chabaud ne dissimule rien des fautes, ni rien de leur gravité, de ce personnage auquel elle donne un destin : de cet homme qui eut une existence physique, elle fait une création littéraire. C’est par la fiction, cette chance supplémentaire accordée au réel, qu’elle fonde cette personnalité trouble autant que troublante, acharnée à se perdre, à s’égarer dans les passions tristes, à suivre les conseils de cette présence négative qui vient le visiter régulièrement, qu’au fond il exècre, mais dont il est sûr qu’elle nuira définitivement à sa réputation, jusqu’à le rendre « indigne » de vivre au milieu des hommes…
A lire aussi: Patrice Jean, le dos au mur, choisit la littérature
Il est malaisé d’entrer dans les détails d’un récit impeccablement construit. Despaux, guidé par un esprit retors, emmêlé dans ses contradictions, a brouillé les cartes et n’a pas fait d’aveux indiscutables. Sans doute contrarié par ses vilenies, ce diable d’homme, qui donne l’impression de se sentir surnuméraire, se cherche un mauvais rôle dans le théâtre de l’Occupation. On le sait collaborationniste, il quitte le PPF, il prétend avoir œuvré en sous-main pour l’Intelligence Service, on le suspecte d’être un escroc. À la fin, il est effectivement arrêté par la Gestapo le 1er février 1944. Condamné comme prisonnier politique (!), après quelques pérégrinations, il parvient à Auschwitz en avril, puis rejoint Buchenwald le 12 mai, jusqu’à la libération du camp, le 11 avril 1945[1].
L’auteur a d’abord mené une enquête, croisé des textes, rencontré les derniers témoins. Quelque chose lui interdisait de refermer le dossier Despaux sur l’infamie qui le signalait à la mémoire de presque tous ceux qu’elle a rencontrés. Elle a tenu tête à l’illusion de l’évidence, elle a trouvé une ligne d’espoir. Elle tenait son affaire, qu’elle pouvait faire basculer dans l’univers hautement révélateur du roman.
Les métamorphoses
C’est à Auschwitz, où il est enfermé peu de temps, et surtout à Buchenwald, dans un univers de pure cruauté, qu’il va se révéler tel qu’en lui-même : amical, protecteur, sensible, talentueux. Il dessine sur des feuilles de fortune ; ses œuvres éblouissent ses codétenus, les divertissent : il est solidaire, estimé, reconnu. Cet ancien de la collaboration, en quittant ses vêtements souillés d’ordures morales pour le pyjama rayé des martyrs, consent enfin à baisser sa garde de crapulerie et trouve sa rédemption. Georges était doué, il possédait toutes les qualités qui font les vies réussies : quelle faille originelle n’avait cessé de grandir en lui, de diviser son être, d’égarer sa raison, de le discréditer ? Dans le camp, il s’attache à Samuel, se prive de pain pour le nourrir, le sauve de la mort : Samuel est juif, de cette « race » qu’il disqualifiait dangereusement dans ses articles d’agitateur plébéien. Ce faisant, il n’assure nullement son avenir : ce cloaque d’extermination abolissait tout espoir de survie. Il survivra, cependant, et Samuel aussi[2]. Néanmoins, en 1945, peu après sa libération, Georges Despaux, collabo notoire, est condamné à l’indignité nationale. Par la suite, il abandonne sa famille, il se retire du monde, se métamorphose encore, cette fois jusqu’à l’effacement social, avant de mourir dans la solitude et le dénuement complet. Samuel ne va jamais le renier, va le secourir sans relâche, mais il était impossible de le maintenir longtemps au-dessus du vide.
A lire aussi: Et si c’était le talent que la gauche reprochait à Sylvain Tesson?
Soit un homme, un Français, un sale type selon toute vraisemblance, plus précisément un mystère français qu’a voulu percer un écrivain. Cécile Chabaud a sauvé du néant d’abjection où il s’était jeté volontairement, un homme voué au malheur d’être né.
À lire: Cécile Chabaud, Indigne (illustré de superbes dessins de Georges Despaux), Écriture, 2023.
Du même auteur, professeur de français : Rachilde, homme de lettres, Écriture, 2022 ; Tu fais quoi dans la vie ? Prof !, L’Archipel, 2021.
[1]. « Le 11 avril 1945, des prisonniers affamés et émaciés prirent d’assaut les tours de guet et s’emparèrent du contrôle du camp. Plus tard dans l’après-midi, l’armée américaine entra dans Buchenwald. […] On estime qu’au moins 56 000 prisonniers masculins, dont 11 000 juifs, furent tués par les SS dans le complexe concentrationnaire de Buchenwald » (Encyclopédie multimédia de la Shoah).
[2]. Depuis plusieurs années, une passionnante exposition intitulée « Georges Despaux : une mémoire contre l’oubli » présente, avec un appareil pédagogique très complet, nombre des dessins que Georges confia à son ami Samuel Vanmolkot (pour l’état civil). Cette exposition itinérante, qui circule partout en France, est une initiative du fils de Samuel. Elle témoigne de l’abominable condition de vie des déportés. Prochaines dates d’expo non communiquées à ce jour.
Rachilde, homme de lettres - prix du grand roman de Mennecy 2023
Price: 18,00 €
16 used & new available from 4,39 €