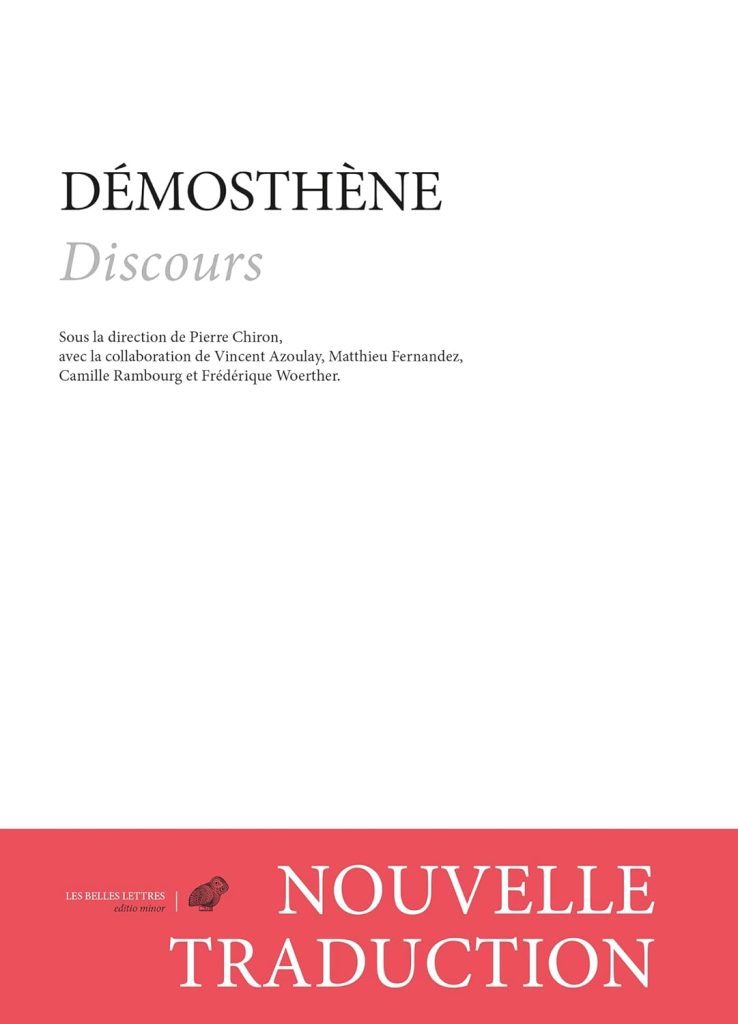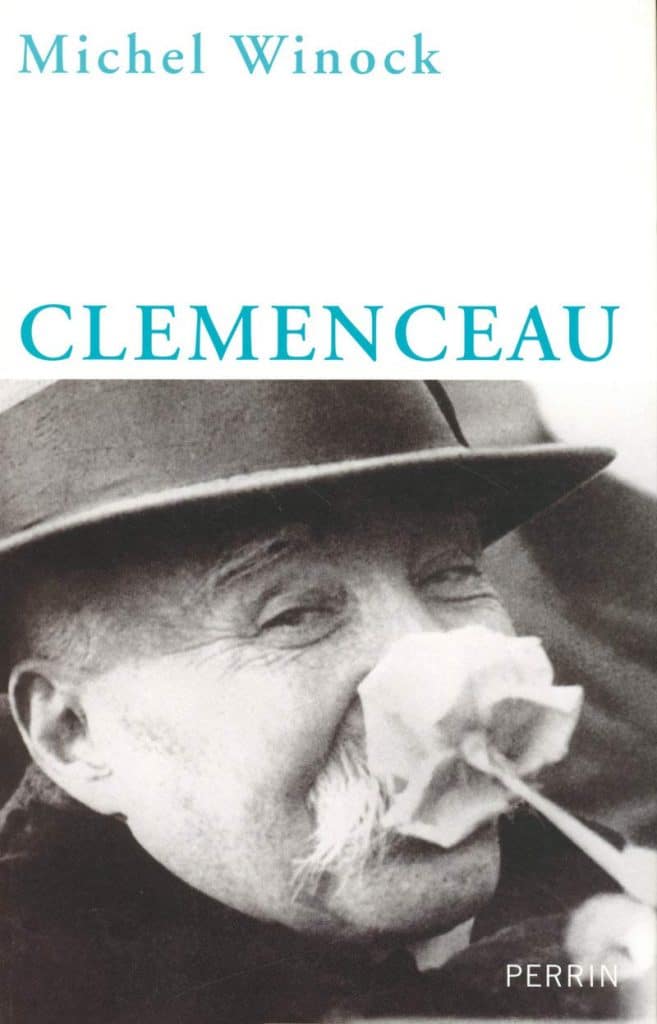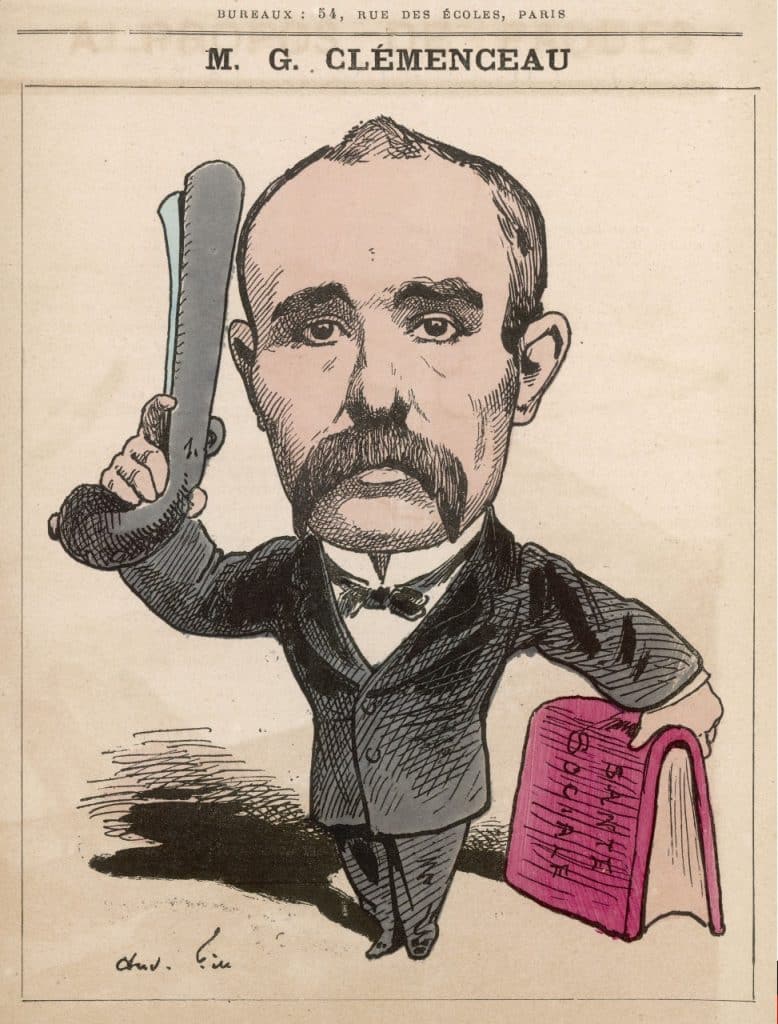La femme la plus riche du monde, de Thierry Klifa, en salles le 29 octobre, est le film le plus astucieux du mois. Ceux qui voudront ensuite tout apprendre de l’affaire Bettencourt peuvent en outre retrouver un documentaire en trois volets sur Netflix…

Toute ressemblance avec des personnes réelles serait évidemment fortuite. On s’en paye tout de même une bonne tranche dans La femme la plus riche du monde, hors compétition à Cannes cette année, transposition transparente de la saga qui, il y a une quinzaine d’années, pour la délectation des médias, mettait aux prises les héritiers du groupe L’Oréal sur l’accusation d’abus de faiblesse portée contre le photographe François-Marie Banier, le protégé de l’aïeule Liliane Bettencourt (1922-2017).
Huppert au meilleur de sa forme
Les noms sont changés, mais pas les protagonistes : « Isabelle Farrère », passablement rajeunie sous les traits d’Isabelle Huppert dans le rôle-titre (Liliane est morte nonagénaire) ; André Marcon pour camper le mari, « Guy Farrère » ; Laurent Lafitte pour incarner Banier, devenu « Pierre-Alain Fantin », tout comme la vraie Françoise Meyers, jouée par Marina Foïs, s’appelle ici « Frédérique Spielman », épouse de « Jean-Marc Spielman » (Matthieu Demy). Pascal Bonnefoy, le majordome dévoué à sa patronne qui, par ses enregistrements clandestins, déclencha le procès que l’on sait, prend le nom de « Jérôme Bonjean », figuré à l’écran par Raphaël Personnaz, le cheveu parcouru de mèches blondes. Jusqu’au mec de Banier, Martin d’Orgeval, conserve sa particule à l’écran, sous le patronyme de « Raphaël d’Alloz » (Joseph Olivennes). Au reste, le film ne fait qu’une potiche du d’Alloz, alors qu’en vrai le d’Orgeval a fini en taule, à l’instar de son amant et protecteur. Idem, le petit-fils de la milliardaire, fade blondinet BCBG, est aperçu crawlant sous le soleil d’Arros, l’île privée de grand-mère aux Seychelles, claironnant à la fin du film qu’il part pour Dubaï.
Bref, tout est supposément vrai dans le canevas de cette fiction qui, tout de même, pousse un peu loin le bouchon de la caricature. Malgré tout, on rit de bon cœur aux répliques ciselées à l’ancienne, dans la tradition ‘’qualité française’’ (sur un scénario du vieux compère Cédric Anger, aidé de l’émérite Jacques Fieschi pour les dialogues). Jean-Marie Banier/ Pierre-Alain Fantin est présenté, d’un bout à l’autre du film, comme une follasse adipeuse et libidinale, sire graveleux, vulgaire, méchant, manipulateur, crapule proprement odieuse. Lorgnant par exemple un phallus antique devant le trumeau du salon, il lâche cette saillie au mari de Liliane : « n’oubliez pas de le lubrifier ! ». Ce parti pris d’appuyer sur le burlesque ne permet pas de comprendre tout à fait l’adoration que lui a voué Liliane Bettencourt/Marianne Farrère, dont notre Huppert nationale, ici au meilleur de sa forme, fait une enfant gâtée, sincère dans son égoïsme infantile comme dans le délire de ses largesses. Marianne entraînée par Pierre-Alain dans une boîte de nuit gay, prétexte à une échappée poétique par le truchement d’une chanson d’Alex Beaupain interprétée par Anne Brochet, on hésite à y croire. Reste que le film condense efficacement l’inexorable progression d’une emprise qui, dans les faits, étalée sur plus de vingt ans, a fini par soumettre à ses caprices une vieillarde devenue à peu près sénile.
A lire aussi: Tant qu’il y aura des films
C’est peut-être la limite d’un film qui, à défaut de creuser profondément la nature et la férocité de cette liaison dangereuse, ne se contente pas, néanmoins, d’emprunter les couleurs d’un pur divertissement : à travers les personnages de Guy, le vieil époux expiant les errements vichyssois de sa jeunesse, et de sa fille Frédérique, l’épouse de l’israélite Jean-Marc Spielmann, il interroge les fluctuations confessionnelles, et cette pollution antisémite dont l’actualité montre assez qu’elle est loin d’être endiguée.
Une affaire qui a scotché l’opinion
Dans la réalité, le très catholique homme d’affaires André Bettencourt (1919-2007), plusieurs fois ministres sous De Gaulle et Pompidou, a bel et bien dû quitter ses fonctions de vice-président de L’Oréal à la suite des révélations sur son passé maréchaliste. Mais le vrai cagoulard collaborationniste, pas évoqué dans le film, c’est Eugène Schueller (1881-1957), le père de Liliane et fondateur de l’entreprise à l’origine de la fortune du clan Bettencourt. Enfin et surtout, focalisé sur Fantin, La femme la plus riche du monde fait volontairement l’impasse sur l’intrication de l’intrigue Banier/Bettencourt avec la politique et la finance, à partir des accusations portées contre Nicolas Sarkozy, Éric Woerth et le gestionnaire de fortune Patrice de Maistre, précisément sur la base des enregistrements du majordome ainsi que des déclarations fluctuantes de la comptable, Claire Thibout. Sont également effleurées les longues tractations judiciaires de Françoise Bettencourt-Meyers pour aboutir à la mise sous curatelle de sa mère et écarter définitivement Banier du colossal héritage.
Moins désopilant et moins fictif que La femme la plus riche du monde, mais aussi palpitant quoiqu’assez racoleur, le documentaire en trois parties L’affaire Bettencourt, scandale chez la femme la plus riche du monde pourra, en option, vous tenir scotché trois heures durant sur Netflix, – toujours disponible à la demande.
La femme la plus riche du monde. Film de Thierry Klifa. Avec Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte, Raphaël Personnaz, André Marcon… France/ Belgique, couleur, 2025. Durée : 2h03. En salles le 29 octobre 2025
L’affaire Bettencourt, scandale chez la femme la plus riche du monde. Documentaire de Baptiste Etchegaray et Maxime Bonnet. France, couleur. 3x 52mn (1- Parce qu’il le valait bien, 2- De l’affaire aux affaires, 3- Le Bal des profiteurs).