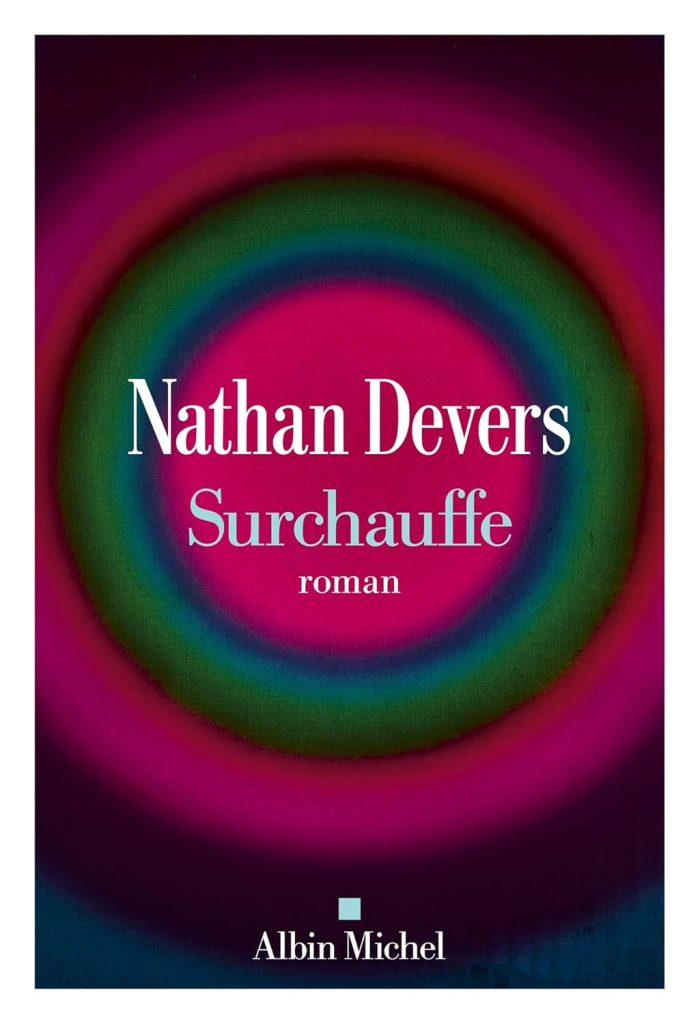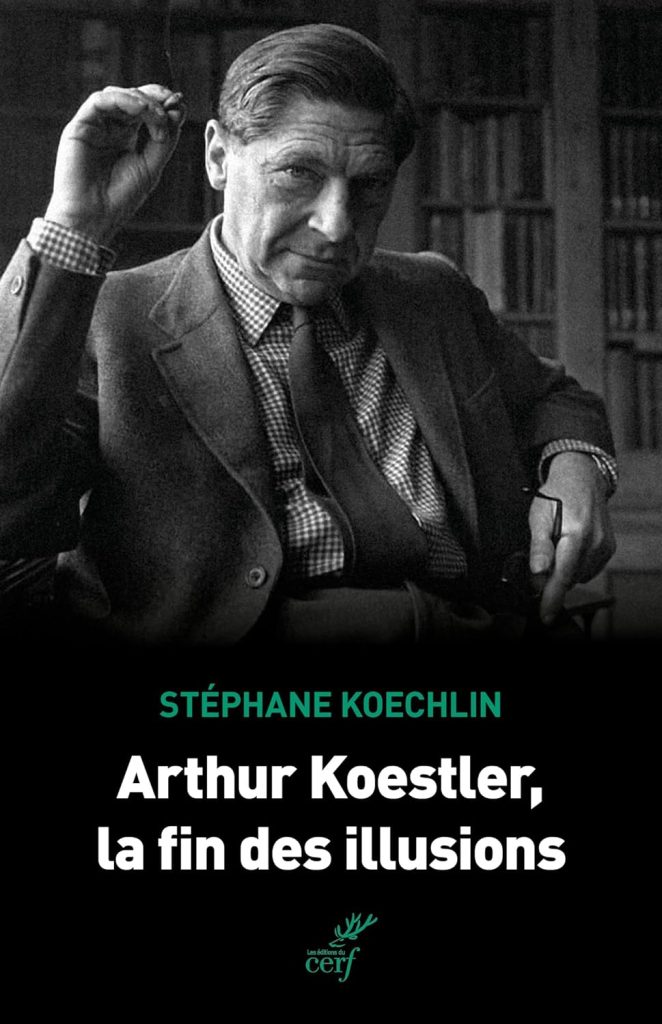Selon le président Macron, la poursuite de la guerre décidée par le gouvernement Nétanyahou dans l’enclave palestinienne est «totalement contreproductif». Israël est en train de «détruire totalement sa crédibilité» a déclaré le président français, dans un entretien à la chaîne 12 de la télévision israélienne, diffusé jeudi. L’offensive terrestre israélienne contre le Hamas dans la ville de Gaza, malgré ses conséquences civiles tragiques et les critiques internationales, ne relève pas du génocide mais d’une guerre urbaine complexe. Qualifier ces actions de génocide constitue en fait une instrumentalisation politique visant à diaboliser Israël, rappelle notre contributeur.
L’offensive actuelle que mène Israël a pour but de détruire le Hamas et pour cela d’occuper la ville de Gaza. Cette décision a suscité des réserves, même au sein de l’armée, mais celle-ci comme il se doit, suit les ordres de l’échelon politique. Les arguments du gouvernement sont que les exigences du Hamas dans le cours des négociations pour la libération des otages étaient telles que les accepter aurait signifié aux yeux des ennemis d’Israël que le mouvement terroriste, qui n’a jamais caché ses ambitions de répéter le 7-Octobre, avait finalement gagné la partie et qu’il sortait victorieux d’un combat solitaire de deux ans contre l’armée la plus puissante de la région. Cela l’aurait maintenu au pouvoir, sous une forme ou une autre, et il n’aurait fait qu’une bouchée d’une Autorité palestinienne sclérosée, corrompue et profondément hypocrite à qui la France avec d’autres pays prétend offrir au pire moment le paquet-cadeau d’une indépendance palestinienne fantomatique.
Les otages au second plan ?
Mais comment concilier cette offensive avec la récupération des otages, mise désormais au second plan? Contrairement à ce qu’on dit, ce n’est pas la première fois qu’Israël aurait fait un tel choix. La libération de Gilad Shalit contre 1027 prisonniers palestiniens a fait oublier que la doctrine habituelle était de ne pas négocier avec les preneurs d’otages pour ne pas encourager de nouveaux enlèvements.
En 1974, l’assaut contre l’école de Maalot effectué sur ordre de Golda Meir, avait coûté la vie à 25 enfants sur la centaine maintenus en otages par le FDPLP. Le refus d’un autre chantage sur les otages a entrainé deux ans plus tard, l’opération d’Entebbe, dont le héros fut, comme chacun sait, Yoni, le frère ainé de Benyamin Nétanyahou.
Pour donner un avis sur le bien-fondé de la décision du gouvernement israélien, il faudrait avoir une compétence sur la situation locale et les moyens militaires que je ne me donnerai pas le ridicule de feindre.
Nous qui ne savons pas ce que les services israéliens savent, nous ne pouvons qu’espérer que les opérations à Gaza permettront, par un moyen ou un autre, de libérer vivants autant d’otages que possible. Rares sont les Juifs qui, au cours des semaines prochaines, ne penseront pas aux otages et à leurs familles. Je suis sûr qu’un certain nombre d’entre eux penseront aussi, à juste titre, à la détresse des habitants de Gaza, mais ils n’auront pas oublié, eux, que le responsable de cette détresse, c’est le Hamas, et que s’il l’avait voulu, le retour des otages aurait arrêté la guerre.
Or, l’oubli des otages est constant dans la description – apocalyptique – par la plupart des medias et des acteurs politiques de la situation à Gaza, comme s’il permettait d’évacuer un élément gênant dans la description des actions d’Israël comme un génocide.
A lire aussi, Elisabeth Lévy: Un faible pour la Palestine
Après avoir découvert la notion de génocide d’immeuble par M. Gallagher Fenwick sur LCI, j’ai entendu le 17 septembre sur Arte Mme Julia Grignon, professeur de droit humanitaire à Paris Assas, annoncer avec fougue qu’il était inconcevable de ne pas appeler génocide les actions d’Israël à Gaza, que d’ailleurs beaucoup d’Israéliens l’admettaient eux-mêmes et que ce terme avait été validé par des Institutions de l’ONU aussi indiscutables et prestigieuses que le Conseil des Droits de l’Homme et la Commission d’enquête indépendante sur le territoire palestinien occupé présidée par l’éminente juriste sud-africaine Navi Pillay, ancienne Haut-Commissaire des Nations unies aux Droits de l’homme.
Pour qui connait le palmarès du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU, où trônent certaines des pires dictatures de la planète, et celui de Navi Pillay dont l’obsession anti-israélienne a largement favorisé la carrière internationale, ces références sont grotesques. Mais pour le téléspectateur moyen, l’argument d’autorité est terriblement efficace, car l’ONU reste une marque de prestige.
Il serait donc impossible de nier qu’Israël soit l’auteur d’un génocide? C’est pourtant ce qu’a écrit il y a deux semaines le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, sur la base d’une analyse du Foreign Office, une institution qui n’est réputée ni pour son israélophilie exacerbée, ni pour sa frivolité intellectuelle. Ce rapport a été curieusement passé sous silence, contrairement aux accusations contre Israël du moindre fonctionnaire de l’ONU.
Mme Grignon balaie enfin l’argument d’intentionnalité sans lequel on ne peut pas parler de génocide. Elle le déduit aussi bien des événements, ce qui revient à une tautologie, que des déclarations des responsables. Pour mémoire, la plus grave de ces déclarations est celle du général Gallant, alors ministre de la Défense, qui avait dit le 9 octobre, alors même que les modalités des massacres glaçaient les esprits: « Nous nous battons contre des animaux humains», en hébreu חיות אדם. Preuve, suivant l’accusation, que les Israéliens considèrent leurs ennemis comme des animaux.
Un linguiste aurait peut-être signalé que l’expression, tirée de la vision d’Ezechiel, est utilisée dans l’hébreu d’aujourd’hui pour insulter une personne dont on considère qu’elle se conduit de façon ignoble et que cela ne conduit pas forcément à trainer l’auteur de ces paroles devant un tribunal, a fortiori international…
Il est ahurissant que l’accusation de génocide portée contre Israël devant la Cour internationale de Justice repose sur de simples mots d’une colère bien légitime…
Combats particulièrement complexes
Mais la question qui se pose aujourd’hui c’est de savoir si c’est commettre un génocide que d’engager la guerre contre une ville? Il semble aujourd’hui que la réponse soit oui, à condition que l’assiégeant soit l’Etat d’Israël.
Le noyau commun des accusations c’est que la guerre que mène Israël entraine des victimes civiles…. Comme si ce n’était pas le cas dans toutes les guerres qui se déroulent dans une ville et pas sur un champ de bataille.
Personne n’a parlé de génocide lors des combats urbains en Yougoslavie, en Tchétchénie, à Fallouja ou contre Daech. Seul l’assassinat de sang froid de 8 000 Bosniaques musulmans par les troupes serbes après la prise de Srebrenica a été qualifié, à juste titre, de génocide: il n’y en a pas la moindre correspondance au cours de la guerre actuelle de Gaza où cette accusation de génocide repose sur le seul fait qu’il existe des victimes civiles lors des combats.
Pour rappel, ces combats sont particulièrement complexes du fait de l’immensité du réseau souterrain qui permet aux combattants impossibles à distinguer de la population civile de déboucher de façon imprévue dans des immeubles par ailleurs soigneusement piégés. Du fait de ces difficultés exceptionnelles l’action de l’armée israélienne, dont on rappelle qu’elle est la première dans l’histoire à prévenir autant que possible les habitants d’un immeuble avant qu’il soit détruit, a été souvent saluée par les techniciens de la guerre urbaine. La transformer en action génocidaire conduit non seulement à trivialiser ce terme mais à faire porter sur Israël une accusation profondément injuste.
La guerre de siège a ses règles. Les manuels de guerre américains et britanniques étudiés récemment dans le très remarquable dossier établi par le Centre Begin Sadate de l’Université de Bar Ilan (sur lequel je reviendrai), les détaillent. On y apprend que le blocus alimentaire est une méthode légitime de guerre, surtout si la population civile a la possibilité de quitter la zone de combats. La fuite des populations civiles est une constante dans ce type de guerre: elle eut lieu massivement à Sarajevo, à Grozny et ailleurs quand elle a été possible et les Israéliens l’organisent à Gaza que plusieurs centaines de milliers d’habitants ont quittée.
Ces départs sont toujours déchirants mais à ma connaissance ce n’est que dans le cas d’Israël que le mot de déportation a été utilisé. Ce mot a certes une connotation plus neutre en anglais qu’en français, mais on ne peut se départir de l’idée qu’il s’agit aussi avec ces mots de génocide et de déportation de désamorcer enfin la charge mémorielle si lourde de la Shoah.
Le siège de Mossoul contre Daech entre octobre 2016 et juillet 2017 a été mené par une coalition dont la France faisait partie. Il s’est déroulé en coupant l’aide alimentaire à une population civile prise au piège et un nombre indéterminé de morts a eu lieu. Personne à l’époque, je crois, n’a utilisé le terme de génocide.
Tous, nous redoutons les conséquences de la décision israélienne de porter la guerre dans la ville de Gaza. Mais dire que cette guerre est un génocide est une perversion du langage dont les objectifs sont politiques. Pour certains il s’agit seulement de manifester leur opposition au gouvernement de Benyamin Nétanyahou, sans qu’ils prennent en considération que ce faisant, c’est l’État d’Israël et tous ceux qui le soutiennent qu’ils marquent ainsi du sceau de l’infamie. Pour d’autres, il s’agit naïvement de «mettre à jour» les définitions classiques du terme de génocide défini il y a près de 80 ans. Mais pour les véritables instigateurs de cette terminologie de la honte, c’est un objectif prémédité de diaboliser l’Etat d’Israël. Cette dernière configuration marque malheureusement l’ensemble des institutions de l’ONU qui sont loin de jouer le rôle d’arbitre neutre que les espoirs populaires voudraient leur attribuer…