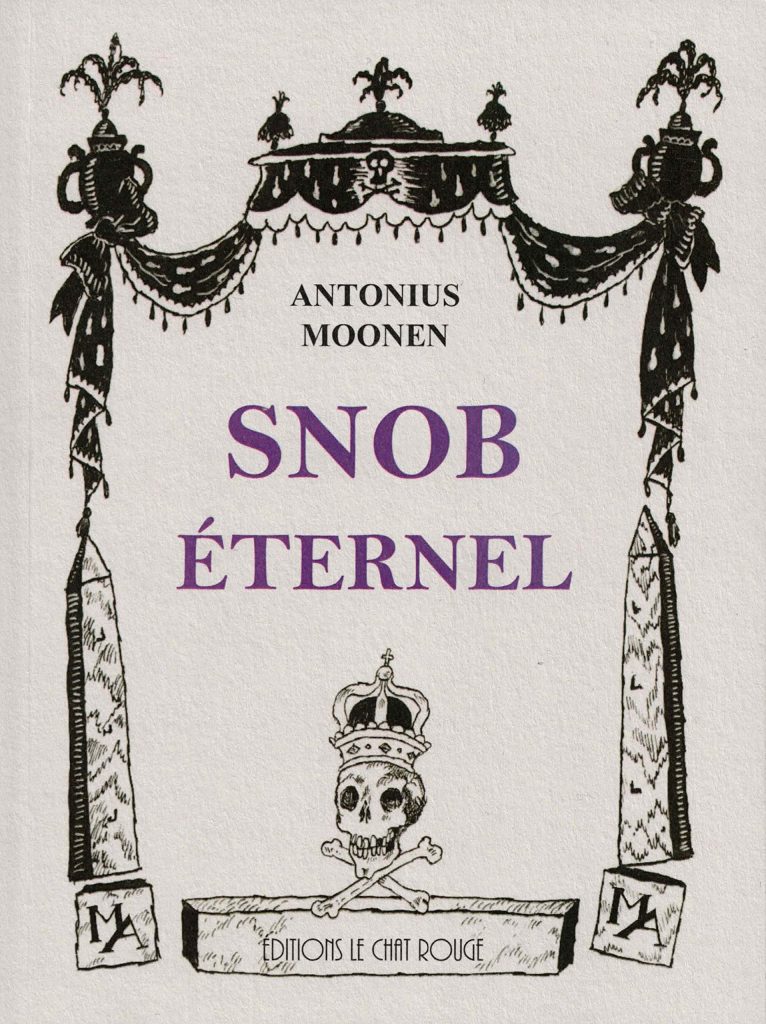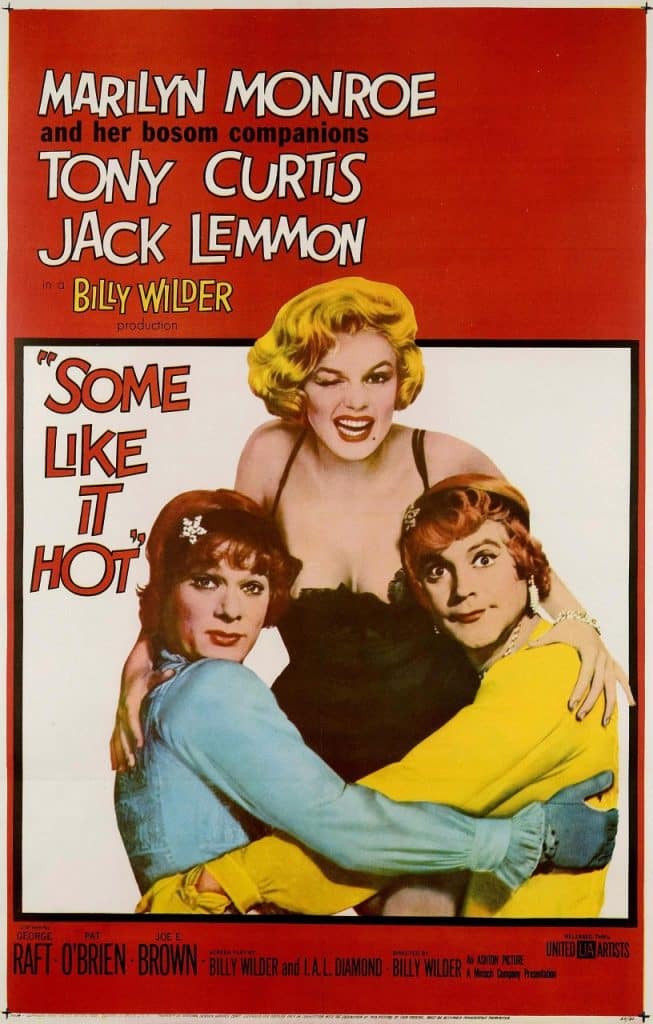Le récent suicide assisté d’une jeune Belge de 23 ans en « état de souffrance psychique » représente plus qu’une dérive de la légalisation de l’euthanasie. C’est un meurtre légal qui permet à notre société d’assumer son incapacité à sauver une génération totalement déconstruite.
« Autant jeter les fils vivants dans les brasiers. » Pierre Legendre
Rendu public en octobre dernier, le « suicide assisté » en Belgique d’une jeune femme de 23 ans, suite à l’aval donné par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie (laquelle justifia après-coup du bien-fondé de sa décision en expliquant que « la jeune fille était dans un état de souffrance psychique telle que sa demande a été logiquement acceptée »), m’a fait penser à la mort du canari dans le puits de la mine. Une mort qui, pour signaler la modification invisible de l’environnement, prévenait les mineurs de l’explosion prochaine.
L’événement une fois connu suscita un certain émoi, de sévères critiques se firent entendre. Mais suite à un signalement (Le Monde, 7 septembre 2022), le parquet d’Anvers, estimant que la « procédure avait été suivie », classa l’affaire. Il s’était en effet trouvé deux psychiatres démiurges pour porter le diagnostic fatal de « maladie incurable » autorisant dans la loi belge le suicide assisté. Et cela arguant du fait qu’à la suite des traumas subis (un viol quelques années plus tôt, et sa présence lors de l’attentat terroriste de 2016 à Bruxelles), les hospitalisations et les traitements médicamenteux n’avaient pu délivrer cette jeune femme d’une « souffrance psychologique insupportable ». Sans autre considération d’une causalité psychique interne de sa souffrance subjective, plus profonde et antérieure à ces traumas. Notons que la jeune femme avait refusé la proposition d’une psychothérapie.
La décomposition de l’Interdit
Ce cas – à ma connaissance une première européenne pour une personne de cet âge et un tel motif – signe, je le crains, un pas supplémentaire dans la dérive folle de ce juridisme dé-civilisateur qui, légitimant le fantasme meurtrier sous-jacent aux demandes les plus insensées, déconstruit depuis plusieurs décennies la barrière de protection : les digues du droit civil soutenant l’architecture des filiations. Il n’est à tout prendre qu’une conséquence dernière de la décomposition de l’Interdit civilisateur – civilisateur des deux dimensions solidaires du désir qui spécifie l’animal parlant : celles de l’inceste et du meurtre. Un Interdit dont le droit civil, pour procéder de la Loi – la loi langagière de la différence des sexes et des générations –, a sous nos cieux vocation (anthropologique) à garantir la logique[1].
Longtemps témoin du recul des pratiques du soin et de l’assistance éducative et sociale pour faire face au « meurtre » – à tous les équivalents symboliques du meurtre œdipien visant l’une ou l’autre des figures fondatrices Mère et Père –, je soutiens que nous sommes loin d’avoir pris la mesure de la régression dans laquelle nous nous trouvons enferrés. Et ce dernier cas, effrayant, révèle dans quelle fuite en avant, nihiliste, la dévastation de notre environnement symbolique nous entraîne.
A lire aussi : Trans-folie: Budweiser ne s’y fera pas prendre deux fois
Ayant cru pouvoir jeter par-dessus bord, sans autres conséquences que de « progrès » n’est-ce pas, les invariants existentiels – les contraintes indépassables de la différenciation humaine (Legendre) –, l’idéologie du Sujet-roi a promu le libre-service normatif. La mythologie subjective parentalela plus confusionnelle, celle des « parents combinés » d’avant l’accès à la différence des sexes,a pris, sous les termes de l’« homoparentalité », force de loi. La représentation fondatrice Mère/Père soutenue par le couple femme/homme, support du cours de la construction subjective, en a été juridiquement et culturellement pervertie.
Par-delà l’ébranlement moral qu’il engage, ce cas extrême me paraît exemplaire de la façon dont, pour occulter l’ordinaire de la négativité – cette part sombre irréductible de l’humain, nichée au fond de l’être de chacun –, le positivisme ambiant, sous les flonflons du Bien et de l’Empathie, nous conduit vers le pire. À quelques exceptions près, les milieux professionnels de l’éducation et du soin eux-mêmes méconnaissent ou mésestiment la puissance négative, liant le meurtre à l’inceste, du désir inconscientqui spécifie l’animal parlant. Et plus encore, ils occultent les conditions de sa reliaison à la Loi, pour civiliser ce désir. Épousant la tendance culturelle du temps, ils s’aveuglent, à l’identique du monde intellectuel et politique, sur les effets délétères, présents et à venir, de la décomposition juridique en cours des fondements langagiers institués du sujet, ceux de la différence des sexes et des générations.
La paresse de sentiment
Dans un tel contexte, faire entendre qu’on ne saurait aider les sujets les plus dépressifs, les plus perturbés, sans d’abord oser ne pas les satisfaire comme ils disent le souhaiter, devient une gageure… Comme si l’on pouvait combler le désir de l’enfant en donnant satisfaction à son impérieuse demande ! Une satisfaction apportée par des parents culpabilisés, des pères papaïsés, maternalisés, dont on voit par exemple fort bien dans le récent film The Son à quelle issue fatale cela peut conduire…
Après avoir cru pouvoir faire de la « religion » – du lien transcendantal au Tiers, à la Souveraineté – une affaire privée, et par-là être politiquement débarrassé du Père et de l’Interdit, du Totem et du Tabou – une fable freudienne fausse et inutile selon un anthropologue accompagnateur de la déconstruction indéfinie –, la déshérence éducative et thérapeutique est au rendez-vous. Nous avons abîmé le fil de la transmission, perdu les ressources symboliques et psychiques pour soutenir la Limite et le Non face à la destructivité subjective des jeunes générations. Les parents d’aujourd’hui, enlacés aux idéaux du temps, sont priés de fermer les yeux. L’enfant est un ange. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil – les monstres exceptés.
Sait-on combien de drames pourraient être évités si, a contrario du mode de satisfaction aujourd’hui promu sous les termes d’un humanisme de bon aloi, ceux d’une écoute empathique, on comprenait en quoi un refus contrariant la demande du sujet peut bien davantage autoriser celui-ci à accéder, pour son propre compte, à sa culpabilité subjective ? À vouloir effacer toute conflictualité structurante, ce sont des multitudes de jeunes qui ne peuvent plus symboliquement tuer le Père, c’est-à-dire se dégager de l’Image narcissique de leurs parents. Ils se trouvent privés du chemin de leur propre émancipation de sujet. Faudrait-il alors s’étonner que, pour un nombre de plus en plus grand de ceux-là, mais aussi de nos concitoyens, une destructivité qui n’a pas trouvé à se métaboliser dans le creuset familial passe au réel ? Soit en s’extériorisant dans des violences multiformes. Soit, pour les sujets les plus fragiles, emprisonnés dans la tyrannie intérieure de leur Surmoi – la tyrannie d’une culpabilité qui n’est pas la leur –, en se retournant contre soi. Un profond déni culturel opère quant à la source la plus profonde de ces violences et de ces souffrances, souffrances d’autant plus intolérables pour les sujets qu’elles leur sont tenues hors sens.
A lire aussi : Crise de l’école: «Des solutions existent mais elles butent sur l’idéologie!»
« Le sentiment est paresseux, de là son inconcevable cruauté… / Qui pêche par pitié présente après-coup la note la plus impitoyable… Gardez-vous du pathétique de l’empathie. » (Hermann Broch, Les Somnambules.)
Un lien en souffrance à la Mère
C’est ainsi qu’à croire devoir donner satisfaction à une telle demande de sujets en détresse existentielle, on verrouille – dans ce cas sous la formule, que je n’ose qualifier, de « maladie incurable » – toute possibilité de remanier leur lien en souffrance à la Mère, lien à cette Image narcissique la plus primitive d’une mère réduite à cette matrice à laquelle ils demeurent inconsciemment scotchés, con-fusionnés. Et si le monde psy a depuis plusieurs décennies reculé, régressé, c’est bien de ne plus comprendre en quoi c’est toujours et encore via l’Œdipe, dans la longue traversée, toujours plus ou moins boiteuse et douloureuse, du drame subjectif, qu’un sujet, institué dans une triangulation adéquate, peut dialectiser sa relation à l’Idole Mère, s’en distancier, en symboliser les Figures. Alors la souffrance, rapportée au drame du vivre et du mourir, peut prendre sens. Et le sacrifice, nouant la perte (l’acceptation du manque, de la limite) au sacré (de la Référence souveraine commune), peut se métaboliser pour la Vie, celle du sujet comme de la cité.
Comment faire résonner cela, que je sais difficile, quand, sous le règne de Big Mother, les fils déguisés en père (H. Michaux) s’avancent si bons, si innocents ? Comment faire reconnaître, alors que la négativité constitutive du désir est circonscrite de tous bords, en quoi la légitimation d’un tel suicide assisté libère dans la société, bien au-delà du cas, la pulsion de mort, la tendance de l’humanité à la mort ? Les nouveaux droits pactisent avec le meurtre.
Laisser accroire à ces sujets de grande sensibilité à la fin de l’angoisse et de la souffrance, à une vie d’innocence et de pur amour comme au Paradis d’avant la chute, c’est les dés-instituer, c’est les placer hors de la condition humaine commune, et au final, comme l’ont engagé tous les totalitarismes, en faire la proie du fantasme de la solution finale. Solution démoniaque et impitoyable de cet autre empathique qui, telle une mère toute bonne et toute-puissante, jamais ne saurait contrarier le fantasme des fils, aussi incestueux et meurtrier soit-il.

Dans le contexte culturel actuel, est-il encore loisible de soutenir qu’il n’aurait fallu en aucune manière se prêter à la demande de cette jeune femme en souffrance, en proie au tourment du vivre et du mourir ? Nul ne semble s’être demandé en quoi l’enjeu de mort qu’elle mettait sur la table était d’une tout autre nature que réelle. Sous le règne de l’empathie, agir et fantasme se sont confondus.
Alors que la problématique œdipienne nouant le cours de la reproduction subjective est donc considérée comme caduque – une vieillerie normative réactionnaire selon la doxa de pointe –, questionner l’enjeu de meurtre que ces jeunes sujets qui se suicident ou tentent de se suicider n’ont pu transposer dans la parole semble de plus en plus irrecevable. Comme demeure tout aussi incompréhensible que ces sujets, enkystés dans une telle débâcle subjective, identificatoire, soient les plus immédiatement sensibles, tel le canari de la mine, au grisou du nihilisme libéré par la déconstruction indéfinie des montages civilisateurs.
A lire aussi : Ce député n’a rien trouvé de plus urgent que de légiférer contre les “discriminations capillaires”
Un écrivain américain l’a noté : « Si nous n’identifions pas les changements qui, dans notre civilisation, attaquent nos systèmes immunitaires sociaux et éthiques – systèmes auxquels nous nous référons d’habitude en parlant de tabous – il ne faudra pas longtemps avant que nous succombions tous. » (Russell Banks, Lointain souvenir de la peau.)
Un meurtre pour la vie
Le suicide d’un jeune sujet relève le plus souvent de cette dimension meurtrière du désir inconscient qui n’a trouvé son issue – du meurtre de cet autre que je est (hais).Mais d’un meurtre pour la vie : ce dont les dernières paroles rapportées dans la presse de cette jeune femme, résonnant du « manque », témoignent tragiquement. Il signe l’impasse de la séparation première d’avec la Mère, ce qui, de la différenciation subjective d’avec ce premier Autre que fut la mère, n’a pu s’élaborer. Pierre Legendre l’a ainsi posé : « Un suicide est un sacrifice humain, qui s’inscrit comme témoignage d’une différenciation manquée, dans la logique généalogique. » (« Le sujet du suicide », in Filiation, « Leçons IV, suite 2 ».). Tout suicide de ce genre signe un abcès généalogique. Le suicidé paie un impayé. L’impayé d’un sacrifice subjectif, celui de générations antérieures. Mais pour faire résonner ici l’enjeu de mort sur lequel ont pu buter douloureusement cette jeune femme, son entourage familial et institutionnel, qu’il soit entendu que c’est bien d’abord la régression dans laquelle nous nous trouvons enkystés, placés comme nous sommes sous l’imperium des idéaux post-hitlériens de la subjectivité sans loi (Legendre), que je vise. Une régression dont je soutiens, après avoir relevé plusieurs décennies durant dans la protection de la jeunesse combien elle pouvait hypothéquer la destinée subjective de tant de jeunes, leur maturation, que cet acte effroyable – tuer en toute légitimité, au nom de son bien, une jeune femme en souffrance psychique aiguë de 23 ans qui le demande – est une ultime manifestation barbare, légalisée.
[1] Cf. P. Legendre, « L’indestructible question de l’Interdit », in Les Enfants du Texte : étude sur la fonction parentale des États, « Leçon VI », Fayard, pp. 25-31.