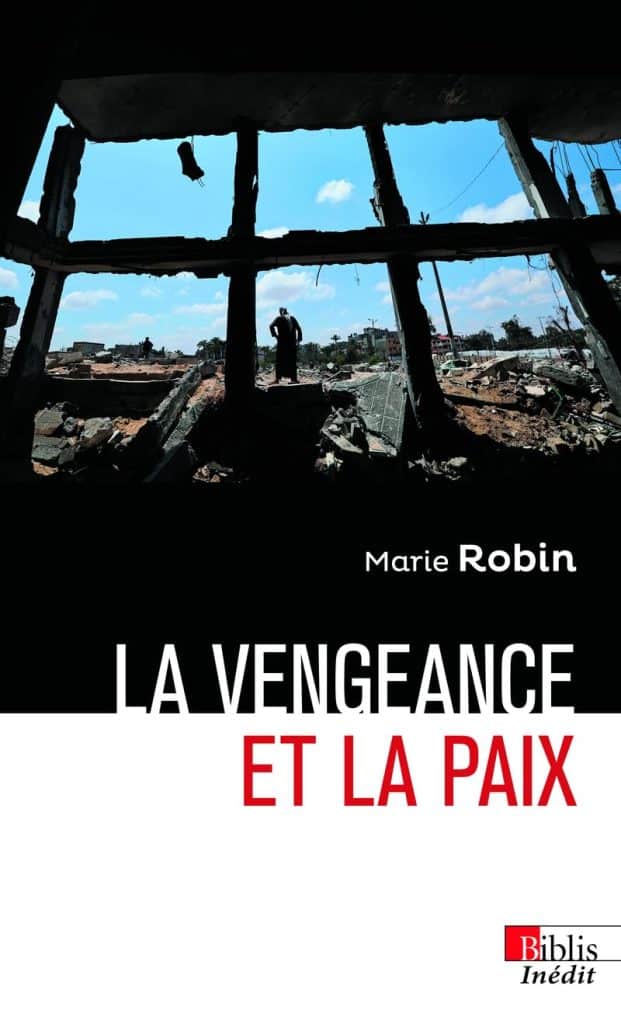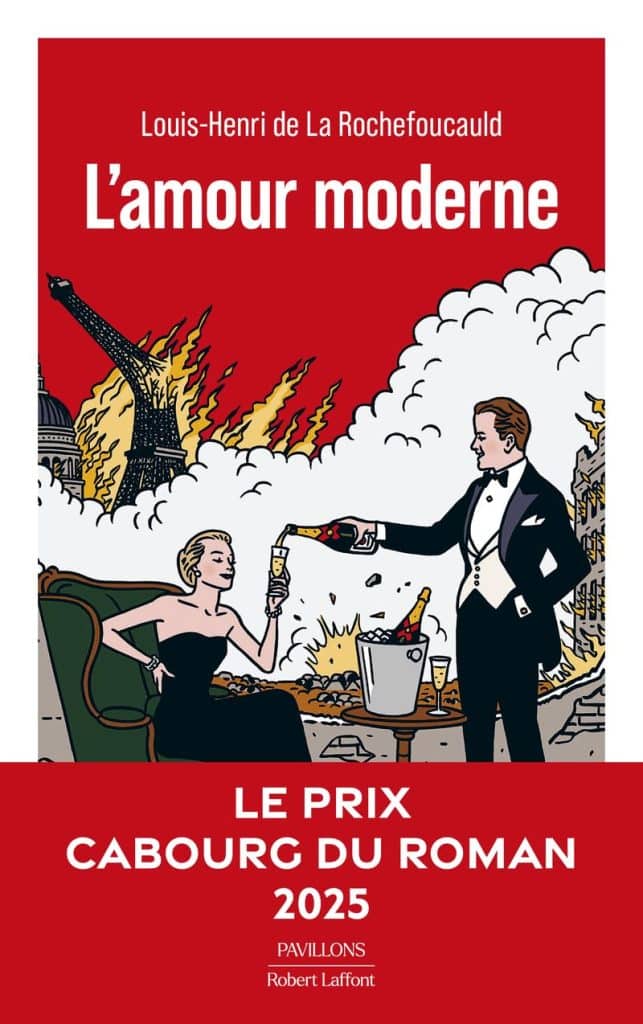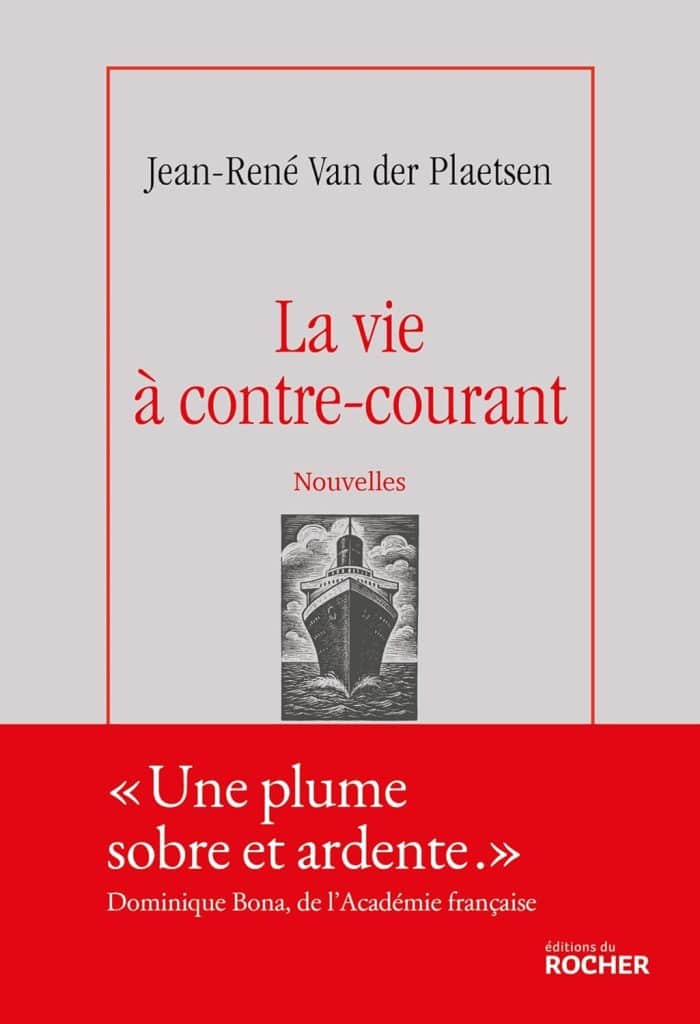Si l’élimination de Hassan Nasrallah enlève un pion important sur l’échiquier tragique du Proche-Orient, l’Iran conserve sa férule sur le petit Liban. Analyse.
Le 27 septembre 2024, l’armée israélienne a éliminé Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah depuis plus de trente ans. Une frappe d’une précision inédite, qui a pulvérisé le cœur du dispositif sécuritaire du mouvement et brisé le mythe d’un chef intouchable. Sa disparition a déclenché une joie visible dans une large partie du Moyen-Orient : Nasrallah n’était plus qu’un symbole de terreur, soumis aux ayatollahs de Téhéran.
Un an plus tard, le constat est implacable. L’homme n’est plus, mais le système qu’il servait demeure. Le Hezbollah n’a pas été démantelé ; il reste le bras armé du régime iranien. Et le Liban, toujours sous le joug d’une idéologie étrangère, voit sa souveraineté piétinée et son avenir confisqué.
L’élimination d’un homme ne suffit pas à mettre fin à une machine politico-militaire conçue pour survivre à ses chefs. Car la menace ne résidait pas seulement dans la personne de Nasrallah, mais dans l’idéologie totalitaire du Wilayat al-Faqih, qui confère au Guide suprême de Téhéran une autorité absolue et qui transforme des milices étrangères en instruments d’une entreprise impérialiste. Tant que cette cléricature demeure en place, le Hezbollah — ou ses avatars — continuera d’écraser le Liban et de menacer Israël, la région et, au-delà, le monde libre.
Une frappe spectaculaire, un système inchangé
La mort de Nasrallah a été perçue comme une prouesse militaire. L’armée israélienne a démontré qu’elle pouvait pénétrer les dispositifs les plus sophistiqués du Hezbollah et frapper son chef là où il se croyait protégé. Sur le plan psychologique, ce fut un séisme : l’homme qui se présentait comme l’incarnation de la « résistance » fut anéanti en quelques secondes.
Mais sur le plan structurel, l’effet est resté limité. Le Hezbollah a perdu son visage le plus connu, mais ni ses arsenaux, ni ses tunnels, ni ses réseaux logistiques reliant l’Iran au Liban. La disparition d’un chef ne suffit pas à effacer quarante années de construction méthodique : une armée parallèle, un appareil politique, une machine sociale et une idéologie religieuse qui, ensemble, tiennent le pays sous verrou.
Islam et politique : un héritage fondateur
Pour comprendre la permanence du Hezbollah, il faut en revenir aux racines. L’islam, dès son origine, a mêlé intimement le religieux et le politique. Mahomet ne fut pas seulement le fondateur de l’islam : il fut aussi chef militaire et bâtisseur d’un État. À Médine, il organisa une communauté, leva des armées et imposa son autorité sur la péninsule arabique.
À sa mort, la querelle de succession ouvrit une fracture durable. Les califes sunnites revendiquèrent une légitimité par consensus, tandis que les chiites affirmèrent que seul un descendant d’Ali, gendre du Mahomet, pouvait gouverner. De cette divergence naquit une opposition théologique et politique qui traverse encore le monde musulman.
Le chiisme : de l’exclusion au pouvoir
Longtemps persécutés et marginalisés, les chiites développèrent une doctrine centrée sur l’attente du douzième imam occulté. Cette attente nourrit une tension permanente entre passivité et contestation.
Au XVIᵉ siècle, la dynastie safavide imposa de force le chiisme duodécimain comme religion d’État en Iran, afin de se distinguer des Ottomans sunnites. Cette décision transforma l’Iran en bastion chiite, mais au prix de guerres confessionnelles et de fractures internes. Le chiisme devint non seulement une foi, mais un instrument de pouvoir politique.
C’est dans ce terreau que la cléricature iranienne moderne a bâti son idéologie : une religion transformée en arme politique et en outil impérial.
Le régime des ayatollahs : une théocrature totalitaire
En 1979, la chute du Shah ouvrit la voie non pas à une démocratie, mais à une théocrature. Le régime des ayatollahs plaça le Guide suprême au-dessus de toutes les institutions. Derrière les apparences électorales, la réalité était celle d’une dictature religieuse.
La doctrine du Wilayat al-Faqih devint la clé : le juriste-théologien gouverne au nom de l’imam occulté, concentrant dans ses mains l’autorité spirituelle et temporelle. Ce modèle fit du Guide suprême l’équivalent d’un monarque absolu, justifiant à la fois la répression interne et l’expansion externe.
Le projet était clair : domestiquer l’Iran sous la férule cléricale et exporter ce modèle à l’étranger. C’est ainsi que naquit le Hezbollah.
La naissance du Hezbollah : un bras armé des ayatollahs
En 1982, les Gardiens de la Révolution iranienne profitèrent de la guerre civile libanaise pour créer un mouvement islamiste armé, entièrement soumis au Guide suprême du régime des ayatollahs. Le Hezbollah adopta immédiatement la doctrine du Wilayat al-Faqih et fit allégeance au Guide suprême.
Sous Abbas Moussaoui, puis surtout sous Hassan Nasrallah, le mouvement devint une machine hybride, à la fois militaire, avec une armée mieux équipée que l’armée nationale libanaise, politique, en s’infiltrant au Parlement et dans les ministères, sociale, en offrant des services éducatifs et médicaux, et idéologique, en diffusant une culture de la haine et du sacrifice.
En quatre décennies, le Hezbollah s’est imposé comme un État dans l’État, confisquant la souveraineté libanaise.
Nasrallah : un pion de Téhéran
Hassan Nasrallah aimait se présenter comme un leader libanais, défenseur de son peuple. En réalité, il n’était qu’un pion docile de Téhéran, toute sa carrière placée sous l’autorité du Guide suprême. Ses discours exaltés n’étaient que l’écho servile de la propagande iranienne.
Sous son commandement, le Hezbollah a semé la mort en Syrie et en Irak, soutenu les Houthis au Yémen et renforcé le Hamas à Gaza. Rien de tout cela n’avait pour but de protéger le Liban : tout servait les intérêts de l’Iran, au prix du sang des peuples de la région et de la ruine d’un pays pris en otage par une milice confessionnelle.
Double discours et mensonge permanent
Le Hezbollah vit du mensonge, comme son maître iranien. Aux Libanais, il promet la protection : il impose la peur. À l’international, il se maquille en acteur politique : il n’est qu’un agent de Téhéran. Dans sa propagande, il revendique une légitimité nationale : il n’est qu’une milice terroriste.
Tout n’est que tromperie. La vérité est simple : le Hezbollah n’est pas libanais. C’est l’instrument armé du régime des ayatollahs en Iran.
Un appareil tentaculaire
Le Hezbollah n’est pas seulement une organisation militaire, mais une structure multiforme insérée dans toutes les sphères libanaises :
- Militaire : roquettes, drones, missiles, tunnels ;
- Politique : députés, ministres, institutions sous influence ;
- Social : écoles, hôpitaux, aides financées par l’Iran ;
- Économique : trafics, blanchiment, contrebande ;
- Médiatique : Al-Manar, Al-Mayadeen, réseaux numériques…
Un tel maillage assure au Hezbollah une solidité durable : la disparition d’un chef ne suffit pas à ébranler un appareil aussi enraciné.
L’idéologie de la mort
Depuis les années 1980, le Hezbollah glorifie la mort. Les combattants tombés au front sont présentés comme des héros, leurs portraits envahissent les rues de Beyrouth et du Sud-Liban. Dans les écoles du mouvement, on inculque aux enfants que le sacrifice de soi est la plus haute vertu.
Cette idéologie mortifère ne vise pas seulement Israël : elle enferme toute une communauté dans une logique sacrificielle. Elle transforme chaque perte en victoire, chaque disparition en récit héroïque. C’est cette culture de la mort qui permet au Hezbollah de survivre à ses chefs.
Le Liban en faillite
Un an après la mort de Nasrallah, le Liban reste englué dans une crise totale. L’élection du général Joseph Aoun à la présidence n’a pas mis fin à la paralysie politique. La livre s’effondre, la pauvreté explose, l’exode des jeunes s’accélère.
Le Hezbollah est le principal responsable de cette faillite. En plaçant ses armes au-dessus de la Constitution et en alignant le Liban sur Téhéran, il empêche toute réforme, toute reconstruction, tout partenariat international.
La disparition de Nasrallah n’a rien changé : le pays reste sous tutelle étrangère. Son élimination a été saluée dans la région comme à l’international, redoutée par d’autres. Beaucoup y ont vu l’occasion d’affaiblir l’emprise iranienne. Mais une évidence s’impose : la mort d’un homme ne suffit pas. Le régime des ayatollahs conserve ses relais, ses financements occultes, ses trafics. Le Hezbollah reçoit toujours armes et argent. Le danger ne disparaîtra que si la communauté internationale frappe à la racine : la cléricature qui dirige Téhéran.
Trois scénarios pour l’avenir
- Déprise progressive : le Liban parvient, avec l’aide internationale et sa société civile, à réduire l’emprise du Hezbollah.
- Recomposition radicale : le mouvement se régénère sous une nouvelle direction, parfois plus violente.
- Statu quo mortifère : la milice se maintient, paralysant l’État et ruinant le pays.
Aujourd’hui, faute de volonté internationale ferme, le troisième scénario est le plus probable.
L’élimination de Hassan Nasrallah par l’armée israélienne, le 27 septembre 2024, restera une date marquante. Le chef du Hezbollah n’était pas invincible. Israël l’a prouvé. Mais la mort d’un homme ne libère pas un pays. Le problème n’était pas Nasrallah. Le problème, c’est Téhéran. Le régime des ayatollahs a créé le Hezbollah, l’a financé, armé et dirigé. Nasrallah n’était qu’un pion docile. Un an après, rien n’a changé. Le Liban reste otage. Arsenaux pleins, financements occultes, réseaux actifs. Et ailleurs, le même schéma : Irak, Yémen, Gaza. Partout, l’ombre du Wilayat al-Faqih. La conclusion est nette : tant que la cléricature de Téhéran existera, la menace persistera. Pas seulement pour le Liban, mais pour toute la région. Le jour où ce système s’effondrera, alors seulement les peuples arabes — et les Libanais en premier — pourront un peu respirer.