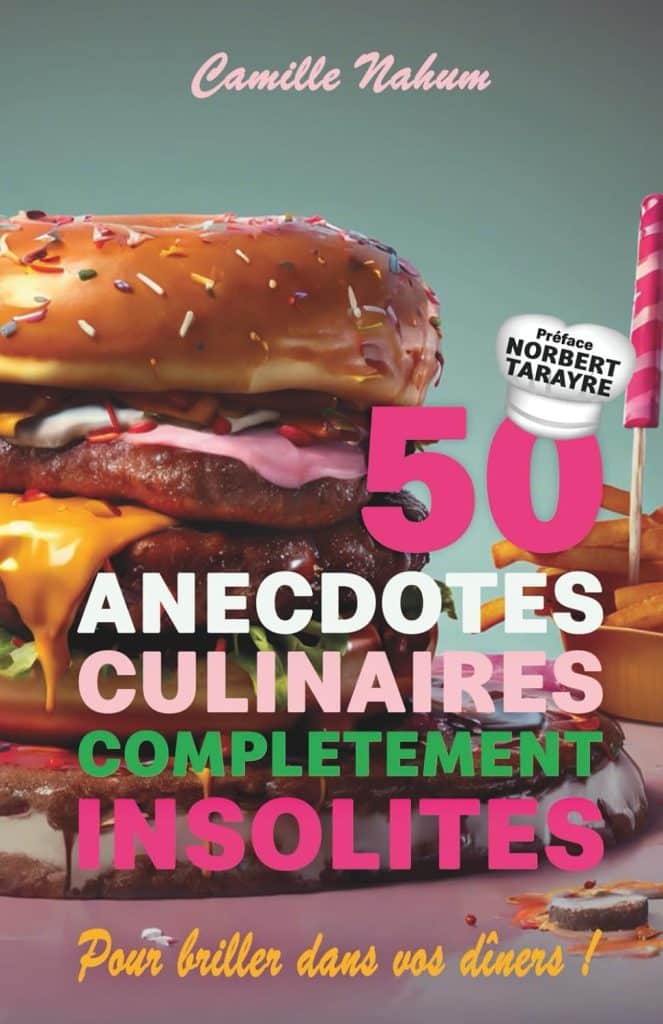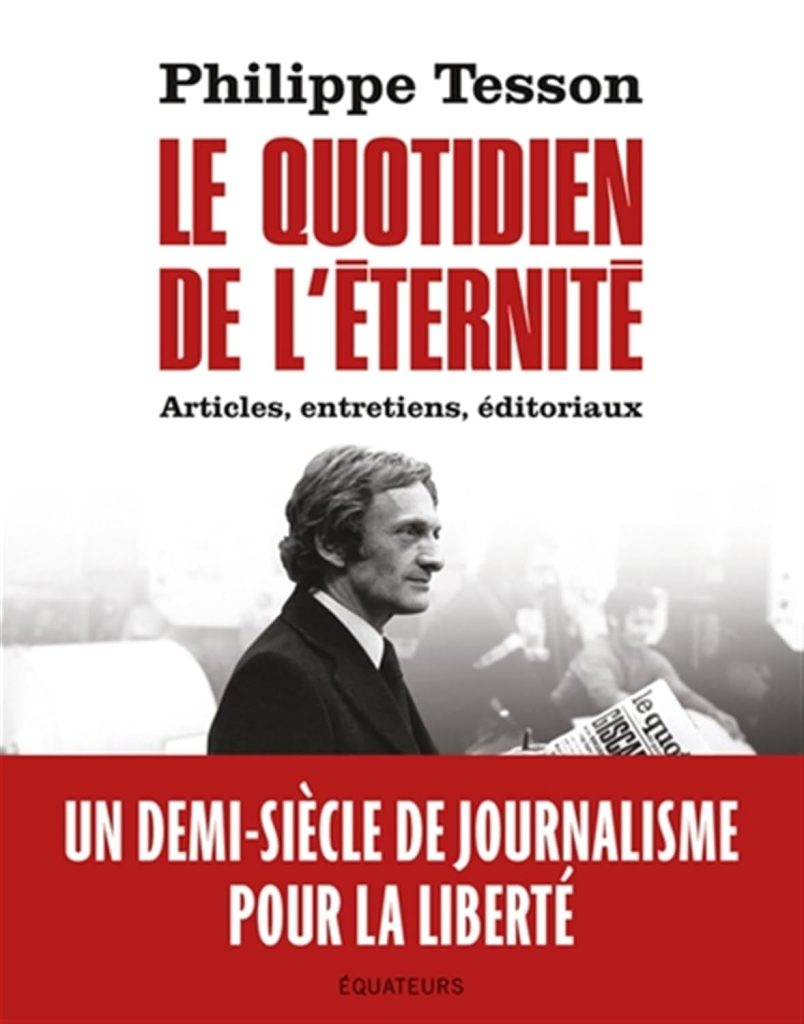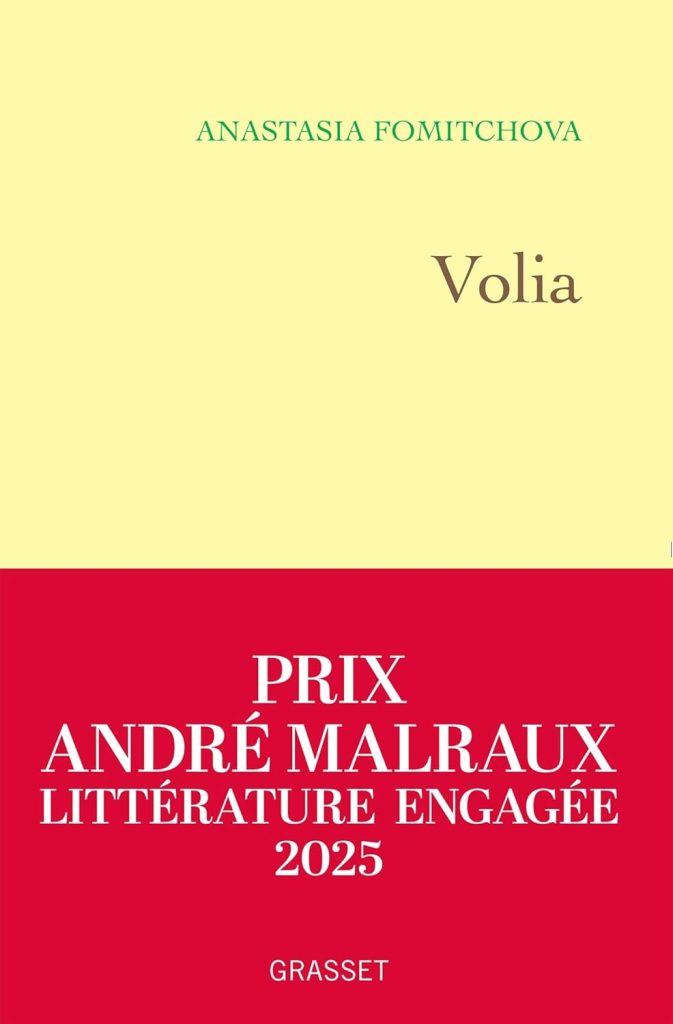Le chanteur préféré des vieilles institutrices abonnées à Télérama menace de s’exiler en Suisse si la droite populiste accède aux responsabilités. L’interprète de Foule sentimentale, qui raillait la bourgeoisie d’extrême droite raciste en 1977 dans son titre Poulailler’s Song a un train de retard. Il ne voit pas qu’en 2025, c’est le peuple ordinaire qui vote pour Jordan Bardella.
Les mirobolants progressistes, qui ont mis la France dans ce sale état, se ridiculisent dans leurs forfanteries. Alain Souchon est de ceux-là, quand il déclare, vendredi sur RTL, en promotion pour ses chansons : « Je ne crois pas que les Français soient aussi cons pour élire quelqu’un du Front national pour diriger ». En ajoutant : « Si ça arrivait, on irait en Suisse ». Certes, rien n’est plus convenu que ce commentaire élitiste.
Le mépris pour les Français ordinaires ne passe plus
Le même chanteur prolophobe pétitionna également, en juillet, contre l’implantation dans son quartier (le chic VIe arrondissement de Paris) d’un Carrefour City accusé de faire tache ; Jacques Toubon, ancien RPR recyclé dans la défense des humiliés, avait également apposé sa signature à ce petit carnet mondain[1]. Ce qui est nouveau, cependant, est l’exaspération que le jugement de classe de Souchon a immédiatement produit auprès d’une partie de l’opinion s’exprimant sur le numérique et les médias alternatifs. En fait, le mépris porté aux Français ordinaires par des humanistes d’apparat devient de plus en plus insupportable, à mesure que le système moralisateur produit toujours plus de pauvres, de violences, d’insécurités, de racismes, d’antisémitisme. Quand Souchon menace de rejoindre la Suisse, il fait certes un excellent choix. Mais ce faisant il plébiscite – au-delà du refuge pour les riches – une démocratie exemplaire dans sa politique de votations (référendums) menée en étroite collaboration avec le peuple raisonnable, que lui-même discrédite.
A lire aussi: Le bourgeois de la Rue Vavin: carrément méchant, jamais content?
Pénible spectacle
Ces élites, exhibant leur progressisme en déroute, ont cessé depuis longtemps de penser la réalité au profit d’un monde abstrait et coupé des gens. Leur univers fictif ne répond qu’à des codes sociaux marquant l’appartenance à des castes cloitrées dans leurs croyances. La décence est un mot que ces experts et donneurs de leçons ignorent, quand ils lancent des procès en incompétence contre les populistes, s’épargnant de s’arrêter sur leurs propres bilans désastreux. Jordan Bardella est une des cibles des salonnards. Ils en oublient de demander des comptes à Emmanuel Macron pour ses déroutes budgétaires et civilisationnelles. Il sera pourtant difficile de faire pire. La péroraison des faillis et des ratés, appuyés par un show-biz pétochard, devient un spectacle pénible. Mais l’air du temps se raidit. La morgue des récitants en clichés devient un carburant qui alimente la rébellion des proscrits, des injuriés. Ils ont face à eux la lâcheté molle de la pensée officielle qui a contaminé ses clones.
C’est très timidement que l’intelligentsia a ainsi défendu Boualem Sansal, emprisonné durant un an en Algérie et libéré mercredi grâce à l’intervention de l’Allemagne. Parce que la droite résistante à la dictature algérienne et à l’islamisme avait proposé le nom de l’écrivain, en septembre, pour le prestigieux Prix Sakharov, ses éditeurs, Antoine Gallimard et Jean-Marie Laclavetine, s’étaient opposés à cette initiative, vue comme venant de l’« extrême droite ». Cette posture snobinarde est celle de Souchon. Celle des imbéciles heureux.
[1] https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2025/07/19/a-paris-les-tres-chics-opposants-a-une-superette-pres-du-jardin-du-luxembourg_6622120_4500055.html