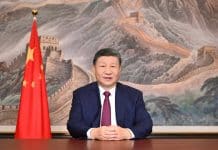Depuis bientôt une décennie, le Royaume-Uni donne l’impression d’un pays dont l’économie avance les yeux bandés vers l’affaiblissement.
Les performances économiques britanniques, parmi les plus faibles du monde développé depuis le Brexit, prolongent un déclin entamé avec la crise financière de 2008. À force de chercher des responsables, tantôt l’Union européenne, tantôt la mondialisation ou les banquiers, les gouvernements successifs ont fini par ignorer l’essentiel : ce n’est pas un événement isolé qui a brisé la trajectoire britannique, mais un ensemble de choix politiques qui ont rendu la crise durable et le pays plus fragile.
Les trois illusions du Royaume
L’histoire récente offre pourtant un contre-exemple saisissant. En 1992, lorsque la livre sterling fut contrainte d’abandonner son ancrage au Deutsche Mark, ce qui devait être un désastre devint une libération. L’économie rebondit, les exportations repartirent, la croissance du PIB par habitant fut pendant près de vingt ans la plus rapide du G7. Mais pour que cette renaissance soit possible, il avait fallu accepter une vérité douloureuse : le système économique construit par le gouvernement de John Major reposait sur une fiction. Une fois la fiction effondrée, la réalité, dure mais féconde, reprit ses droits.
Aujourd’hui, une crise similaire semble se préparer, avec la même potentialité de renversement. Car si le Royaume-Uni va mal, ce n’est pas seulement en raison des chocs de 2008 et de 2016, mais parce que ses dirigeants persistent à s’accrocher à trois illusions destructrices : des règles budgétaires arbitraires et intenables, l’idée qu’un État-providence généreux peut être financé sans augmenter l’imposition de la majorité, et la conviction qu’une croissance miraculeuse jaillira spontanément de ce carcan contradictoire.
A lire aussi, Jeremy Stubbs: Royaume-Uni: Farage est-il trumpiste?
Keir Starmer, qui avait promis une gestion sobre et responsable, voit sa popularité s’effondrer à un rythme inédit dans l’histoire du pays. Quinze mois après sa victoire électorale, son gouvernement est devenu le plus impopulaire jamais enregistré par les instituts de sondage. Sa ministre des Finances, Rachel Reeves, se trouve dans une situation encore plus délicate car c’est elle qui devra annoncer, lors du budget du 26 novembre, une hausse d’impôts allant jusqu’à 40 milliards de livres pour respecter des règles budgétaires que plus personne ne défend sérieusement, sauf ceux qui les ont édictées.
Le Royaume-Uni semble donc entré dans ce moment paradoxal où la réalité économique rattrape les promesses politiques. Et les chiffres sont impitoyables. Depuis 2016, la croissance du PIB par habitant a été presque divisée par deux. Autrefois champion du dynamisme, le pays est désormais dépassé par la France, l’Italie et même le Japon. Faut-il pour autant invoquer le Brexit ou la crise financière comme des fatalités ? Ce serait trop simple. La question centrale n’est pas ce qui est arrivé, mais pourquoi cela a produit des effets si durables au Royaume-Uni, et beaucoup moins ailleurs.
La première réponse touche à l’identité économique même de la Grande-Bretagne. Le pays disposait de deux puissants moteurs de croissance qui ont nourri la prospérité entre 1992 et 2016 : la finance mondiale et les services paneuropéens. Pourtant, ce sont ces deux secteurs que la politique britannique a méthodiquement affaiblis. Depuis la crise financière, la finance est devenue un mot toxique. Après le Brexit, les activités paneuropéennes qui faisaient briller les entreprises britanniques (conseil, culture, universités, recherche) ont été entravées ou amputées. Le Royaume-Uni s’est volontairement privé des domaines dans lesquels il excellait.
Le ruissellement, mais dans le mauvais sens
La deuxième réponse est plus subversive encore. Dans un consensus partagé par la gauche et la droite, les dirigeants britanniques ont réorganisé la fiscalité pour alléger la charge sur les salariés « ordinaires » et faire reposer le financement de l’État-providence sur les très hauts revenus. Présentée comme un geste de justice sociale, cette mutation fiscale a en réalité produit un paradoxe dévastateur : jamais les impôts n’ont pesé aussi lourd dans l’économie, et jamais les travailleurs moyens n’en ont payé aussi peu. Le 1 % des contribuables les plus riches finance désormais près d’un tiers de l’impôt sur le revenu (contre 20% en France).
Un progrès moral peut être, une erreur économique certainement. Car une telle concentration de l’impôt décourage précisément les secteurs où les salaires sont les plus élevés comme la finance internationale, les technologies, l’industrie pharmaceutique, la recherche. Autrement dit, les secteurs qui tirent le moteur invisible de la prospérité, la productivité.
Or, la productivité ne naît pas dans un climat de stagnation. Elle exige un minimum de croissance. Augmenter les impôts en pleine faiblesse conjoncturelle revient à étouffer l’économie et à précipiter la prochaine crise. Le Royaume-Uni est aujourd’hui piégé dans cette boucle autodestructrice avec un déclin de la productivité, un déficit public croissant, une hausse des impôts, une nouvelle contraction de la demande et enfin une nouvelle baisse de la productivité.
A lire aussi: Le plus long «shutdown» américain s’achève: mais à quoi tout cela a-t-il servi?
De ce cercle vicieux, une issue existe. Mais elle suppose de rompre avec les illusions politiques actuelles. Rachel Reeves risque de condamner son propre budget si elle persiste à vouloir tout à la fois rassurer les marchés, financer l’État-providence, ménager les électeurs, et éviter une hausse de l’impôt sur le revenu. Pour sortir de l’impasse, il faudrait renverser la logique et stimuler la croissance à court terme en évitant les hausses d’impôts immédiates, tout en programmant pour 2028 ou 2029 une augmentation du taux standard de l’impôt sur le revenu. C’est le seul instrument suffisamment large et stable pour à la fois restaurer la confiance et financer durablement un État-providence universel.
Le Royaume-Uni n’a pas besoin d’une énième réforme technique, mais d’un changement de doctrine. Il doit cesser de taxer obsessivement les secteurs les plus productifs, cesser de construire ses budgets sur des promesses impossibles, et surtout reconnaître que l’État-providence, pour survivre, doit être financé par tous, y compris les classes moyennes qu’on cherche aujourd’hui à ménager.
Au fond, la leçon de 1992 demeure valable. Une crise peut libérer un pays des illusions qui l’étouffent. Reste à savoir si le gouvernement britannique acceptera d’ouvrir les yeux avant d’y être contraint.