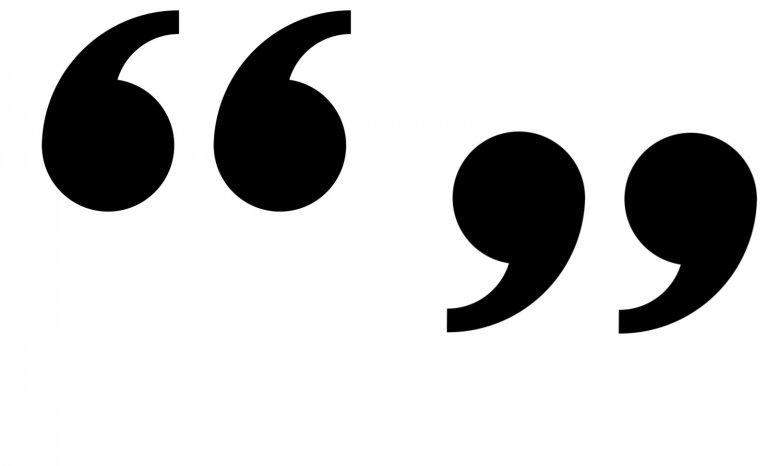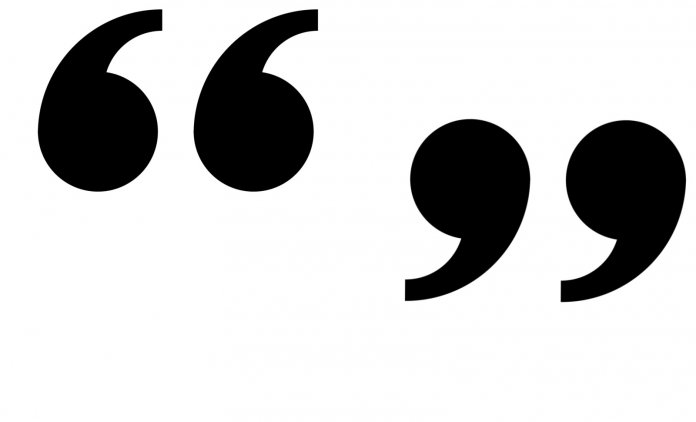Je ne connais de signification précise au mot « liberté », écrivait Valéry en 1938, que celle qu’en donnent la dynamique et la théorie des mécanismes ; c’est-à-dire, comme latitude demeurant à un système une fois toutes ses contraintes conformationnelles respectées. C’est dans cette soustraction opérée sur une mobilité qui serait absolue que naît la sensation de liberté, nous dicte-t-il encore : sans gênes, son sentiment n’advient pas. La liberté, pour le dire autrement, réside donc dans un hypostatisme léger, et non dans un hypostatisme total ; si on l’éprouve, c’est parce qu’elle est amputée, et non intacte : la liberté est un reliquat. La vouloir sans entraves, c’est désirer l’impossible ; une liberté non bornée est une idée destructrice d’elle-même, comme celle de néant. La liberté illimitée, cela a néanmoins un nom : cela s’appelle la licence, et c’est l’antithèse de la liberté. La tragédie de notre époque se noue alors là : elle croit qu’il n’y a de liberté que dans la licence ; alors qu’elle n’existe qu’en dehors de celle-ci.
Continuum de la licence et de la tyrannie
La licence, répétons-le encore, n’est pas la liberté ; la licence, c’est une liberté exercée dans l’anomie, une liberté pratiquée dans l’indiscipline et le désordre. C’est une liberté dont on jouit sans conscience, une liberté qu’on fait jouer dans le sens du chaos, et qui n’aboutit qu’à s’annihiler elle-même. « L’ordre, et l’ordre seul, fait en définitive la liberté », écrivait Péguy en 1905. « Le désordre fait la servitude ». Il en va ainsi de la licence, c’est-à-dire de la liberté entendue comme allergie à toute espèce d’ordre : elle n’affranchit pas l’individu, elle prépare son assujettissement. Aux contraintes fortifiantes de la liberté, fabriquant les âmes fermes et tendues, elle substitue un sybaritisme dissolvant, qui les fait molles et alanguies. Le continuum ne va donc pas de la liberté à la licence ; il va de la licence à la tyrannie. Dynamite pour discipline intérieure, la licence ne prépare pas des régimes libertaires ; mais, consubstantielle à l’État faible, prédispose au contraire à la dictature. Après tout, si l’on en croit La Boétie, Cyrus n’eut-il pas qu’à établir dans la ville de Sardes « des bordels, des tavernes et des jeux publics », et à rendre obligatoire leur fréquentation, pour s’assurer définitivement des Lydiens ?
D’une liberté que rien ne borne, l’homme finit vite par se lasser ; il mesure alors, effrayé, l’état de dislocation produit par sa pratique démissionnaire, quand elle est généralisée à l’échelle d’une société. Mais qu’est-ce qui pourrait bien sauver un édifice public dont chacun, pour paraphraser Nietzsche, a cessé d’être pierre ? La tyrannie elle-même ne saurait directement remédier à ce ferment centrifuge qui est d’abord intérieur. Son idée, toutefois, finit par s’imposer, comme pis-aller nécessaire devant le spectacle, révoltant pour l’esprit, d’une incurie publique de tous les instants. Qui, d’ailleurs, serait en état de s’opposer à son instauration ? Non, la dictature est le lot d’une société ayant collectivement décidé de démissionner, comme le prix à payer pour son douloureux dégrisement.
La toute-puissance originelle du poncif
La grande illusion de la liberté, chez l’homme, c’est qu’on la croit innée et naturelle, première et originelle ; alors qu’elle n’advient jamais qu’au terme d’un apprentissage. La liberté, en effet, ne consiste pas à n’avoir aucun maître ; elle consiste à être à soi-même son maître[1]. Et même chez un anarchiste tel que Bakounine, on n’y trouvera pas la liberté décrite comme un fruit vers lequel l’individu n’aurait qu’à tendre la main pour s’en saisir. Au contraire, professait-il, la liberté requiert une éducation, et ce n’est qu’à mesure qu’elle progresse que la figure extérieure d’autorité cesse graduellement d’être nécessaire, et devient dispensable. « Une immolation progressive de l’autorité au profit de la liberté » : telle est la définition qu’il donne d’une éducation rationnelle, dans Dieu et l’État.
Notre premier élan, contrairement à ce que nous aimerions croire, ne va pas à l’original, mais au cliché ; de même que nous n’avons pas l’instinct de la liberté, mais celui de la licence. Ce qui règne d’abord tyranniquement en nous, ce n’est donc pas l’inusité, le jamais-vu ou l’inouï ; c’est, à rebours, le lieu commun. Appelés à décrire une tour ancienne, combien, à cet égard, fût-elle de couleur claire, ne manqueraient pas, à l’instar de l’écolier d’Alain, d’en signaler les inévitables « pierres noircies par le temps », que la toute-puissance du poncif leur fait voir alors même qu’elles sont à l’évidence absentes ? La pensée singulière d’un enfant n’est pas une source claire n’attendant qu’un coup de pioche pour jaillir ; c’est un liquide trouble contenant beaucoup de truismes et peu d’idées en propre, qu’il faut chauffer et porter à ébullition longtemps pour en extraire à froid quelques gouttes de distillat.
Programmatique de la page blanche et pupillarité éternelle
Las, une telle vérité n’est pas à l’ordre du jour ! La modernité éducative, à rebours du réalisme des siècles passés, qui voyait dans l’enfant l’élément humain le plus faible – c’est-à-dire celui auquel il fallait tout donner, celui qui devait tout recevoir -, feint de n’avoir plus affaire en la matière qu’à des surhommes, capables de tout tirer de leur fonds. L’écolier n’est plus un pupille vis-à-vis duquel l’adulte exerce un magistère ; c’est un génie qu’il importe avant tout de laisser à son œuvre, pour n’en pas falsifier l’accouchement. L’assimilation des trésors du passé, dès lors, ne lui est plus une addition nécessaire et féconde ; mais un fardeau malvenu et stérile, un appesantissement même nuisible, propre à en détourner les Muses, et à en bouleverser l’homéostasie intérieure. L’instruction ne se présente plus alors que sous un seul visage : celui de la toujours possible aliénation.
A lire aussi: Petite philosophie du selfie
Bakounine ressuscité, plaidant pour le maître, aurait ainsi aujourd’hui des allures de conservateur, sinon de réactionnaire. Il est vrai aussi, pour lui, que la férule des premiers jours avait toutefois une contrepartie : c’est que cette autorité ne s’éternise pas ; c’est que cette tutelle finisse effectivement par s’abolir. Sinon, dénonçait-il, l’École ne sera jamais que le nouveau nom de l’Église, et le peuple demeuré troupeau aura seulement changé de tondeurs. Ô, pensée d’un autre âge ! Cela fait bien des années que l’institution a abandonné ce vieux projet émancipateur : fabriquer des citoyens adultes, aptes à penser par eux-mêmes, chez lesquels l’esprit de responsabilité aura été développé à part égale de celui de liberté, est une mode qui a passé. Nous en sommes désormais revenus au régime éprouvé que le philosophe russe connaissait : celui de l’éternelle minorité, dans lequel l’adulte ne l’est jamais qu’à titre sursitaire, et se voit d’ailleurs quotidiennement traité comme s’il ne l’était pas.
Le risque démocratique est-il encore admissible?
C’est qu’entre-temps, le totalitarisme nazi a eu lieu, et que nos sociétés occidentales demeurent sous l’émotion des horreurs qu’il a produites. Or, cette dimension d’abord charnelle qu’ont conservé pour nous ces événements historiques a réactivé, pour tout ce qui touche à cette période, des logiques de pur et d’impur. Qu’une chose, quelle qu’elle soit, ait un point de contact avec le nazisme, sa vérité se résume alors à cette intersection, son Être devient indissociable de l’horreur génocidaire ; la penser « innocemment » cesse d’être possible, son premier visage est désormais – toujours – celui de sa parenté avec le Mal[2].
Aussi, parmi les irréparables dégâts causés par l’hitlérisme, faut-il encore compter ceux liés aux mots et aux idées dont il a pour longtemps vicié l’emploi, par son compagnonnage radioactif ; et d’abord, à la démocratie comme confiance placée sans réserves dans l’instruction, et dans l’homme ordinaire qui en a bénéficié. A cette foi, en effet, le nazisme a fait rétrospectivement se succéder l’effroi ; or, la démocratie ne va de soi qu’en régime de banalité du bien. Si, au contraire, la loi véritable est celle de la banalité du mal, une société peut-elle encore prendre le risque de la démocratie ? A des adultes intellectuellement émancipés, mais toujours susceptibles de replonger dans l’ignominie, ne vaut-il pas mieux alors préférer le maintien des individus dans une certaine minorité de l’esprit, qui les rendra plus perméables aux clichés ? C’est, à bien des égards, le choix que me paraît avoir opéré l’époque, dans sa substitution de colos vaguement érudites aux anciens cloîtres consacrés au seul culte du savoir.
L’adulte à l’école de l’enfant
Dans cette philosophie nouvelle, l’école n’est plus pensée comme un sas, entre la famille et le monde, entre l’enfance et la majorité, où l’élève est soustrait au Dehors et arraché à lui-même ; au contraire, cette étanchéité, cet hermétisme, cette extraction même, quintessencient ce qu’on entend détruire. L’école, précisément, doit devenir l’espace rieur où le petit d’homme n’a jamais à se quitter, et peut demeurer en permanence dans la fidélité à lui-même ; perméable aux parents (c’est-à-dire à la famille) comme aux enjeux idéologiques du moment (c’est-à-dire au tumulte du monde) ; ouvert sur le jeu (c’est-à-dire sur l’enfance) comme sur l’univers de l’entreprise (c’est-à-dire sur l’âge adulte). Son objet n’est plus l’expérience de la coupure et de la séparation, la distanciation d’avec son Moi ; mais le métissage des extérieurs, et l’arraisonnement à soi.
L’école, alors, de lieu clos, se fait continuum ; et la frontière entre l’adulte et l’enfant se brouille. On n’est plus très sûr de savoir qui doit faire la leçon à qui. Le maître surplombe-t-il vraiment l’élève ? N’ont-ils pas réciproquement beaucoup à s’apprendre ? Dans les matières nouvelles désignées comme vitales par l’école réformée, n’est-ce pas plutôt aux adultes de ressortir leurs cahiers, et à leurs enfants de faire cours[3] ? Certes, ils n’ont qu’une vague idée de l’orthographe et de la syntaxe, et leur vocabulaire ne dépasse pas 300 mots ; mais ne maîtrisent-ils pas le tri sélectif ? N’ont-ils pas déjà appris à déconstruire maints préjugés de genre et de race ?
Le refus du dressage est un refus paradoxal de la liberté
La France, nous a-t-on rapporté récemment avec les résultats de l’enquête TIMSS 2019, dévisse en matières scientifiques au primaire et au collège ; et de nombreux médias – jusqu’au Monde ! – ont cru devoir s’alarmer de voir nos élèves de 4ème n’exhiber plus, en mathématiques, que le niveau alors arboré, en 1995, par leurs homologues de 5ème. Cet effroi général m’a, je l’avoue, bien surpris. Parmi toutes ces voix – et il y en avait de progressistes – , nulle en effet n’a énoncé cette évidence qui aurait pourtant rasséréné chacun : savoir, qu’il y a belle lurette que de tels tests ne sont plus adaptés aux enseignements dispensés par notre école ; et que toutes ces enquêtes ne sont jamais configurées que pour des systèmes d’instruction antédiluviens, où l’on croit encore que connaître ses tables de multiplication est utile au citoyen. Non, interrogeons nos enfants sur les notions que notre école fait travailler, cuisinons-les sur le développement durable, les vertus du métissage, et nous les verrons à nouveau truster les premières places de ces classements iniques.
« Parmi les victimes de la liberté [l’emploi du mot « licence » eût été ici plus juste], les formes, et dans tous les sens du terme, le style. Tout ce qui exige un dressage, des observances d’abord inexplicables, des reprises infinies ; tout ce qui mène par contrainte d’une liberté de refuser l’obstacle à la liberté supérieure de le franchir », consignait encore Valéry. Or, précisément, quels sont les enseignements les plus rigoureusement astreints à l’observance stricte des formes, sinon l’orthographe et la syntaxe, en matière « littéraire », et les mathématiques, en matière scientifique ? Notre école moderne est toute entière fondée sur le refus du dressage, comme maltraitance insupportable perpétrée à l’égard du Moi de l’enfant ; mais comment s’étonner, alors, que la chute du niveau scolaire trouve d’abord à s’illustrer par des prestations minables en ces domaines ? Le paradoxe, en effet, c’est qu’il faut être arraché à soi pour s’y voir ensuite rendu ; mais comment faire entendre une telle vérité ?
L’abstention généreuse
Le malheur de notre époque, c’est que les demi-habiles ont pris le pouvoir, et que tous leurs efforts pour paver des paradis n’aboutissent chaque fois qu’à des enfers, en matière éducative comme en matière de « vivre-ensemble » d’ailleurs. Le motif est systématiquement le même : il consiste à croire en l’existence d’un Autre, avec une majuscule – l’Enfant, mais aussi l’Étranger –, formant avec ses semblables un univers autonome, vis-à-vis duquel, par égard même, nous devons nous abstenir de toute ingérence, pour ne pas leur inoculer notre poison.
Dans l’adulte, dans le natif occidental, gît en effet quelque chose de contagieux, une corruption d’où le mal est sorti[4] et dont la communauté autogestionnaire de l’Autre doit être préservée, si on n’en veut pas vicier irrémédiablement la pureté et l’harmonie. Aussi, par humanitarisme même, faut-il demeurer au seuil de ces mondes, pour ne pas provoquer leur fatale dénaturation. Ce qu’on eût autrefois rangé dans la catégorie des démissions et des lâchetés devient alors l’incarnation même du cœur et du souci généreux. Être altruiste désormais, ce n’est plus s’investir, c’est s’abstenir. Renoncer à avoir pour autrui une exigence – c’est-à-dire une ambition – ne marque plus le désintérêt, ou la désaffection ; mais témoigne au contraire de l’amour qu’on lui porte.
La neutralité devient alors l’horizon indépassable : et vis-à-vis de l’enfant, vis-à-vis de l’étranger, il ne s’agit plus d’être un parent ou un pays singuliers, mais un parent quelconque, et un pays quelconque, ayant le degré d’abstraction et de généralité mobilisé pour les démonstrations mathématiques. La préservation de la virginité ontologique de l’Autre est à ce prix. Il nous faut devenir page blanche, pour l’enfant, et terre vierge, pour l’étranger. L’adulte et le natif ne sont plus des figures à imiter, des référents culturels avec lesquels coïncider un jour, pour le nouveau-né et le nouveau-venu ; à bien des égards au contraire, ces modèles viciés ne constituent plus que leur passé – eux, sont l’avenir –.
Le refus de la continuité du monde
Arendt écrivait : « avec la conception et la naissance, les parents n’ont pas seulement donné la vie à leurs enfants ; ils les ont en même temps introduits dans un monde. En les éduquant, ils assument la responsabilité de la vie et du développement de l’enfant, mais aussi celle de la continuité du monde […] [Car] ce monde aussi a besoin d’une protection qui l’empêche d’être dévasté et détruit par la vague des nouveaux venus qui déferle sur lui à chaque nouvelle génération. »
Mais aimons-nous encore assez notre monde pour en vouloir assurer la continuité ? Y sommes-nous encore assez attachés pour refuser le contractualisme culturel qu’on nous propose, et affirmer qu’à côté de la démocratie des vivants, existe aussi une démocratie des morts, qui nous inscrit une filiation qui n’est pas à choisir, mais qui nous est prescrite ? Avons-nous encore, sur notre propre sol, une civilisation à transmettre et le désir de la voir se perpétuer, ou sommes-nous mûrs pour le multiculturalisme, c’est-à-dire pour la soustraction de la terre à l’Histoire, et la concurrence libre et non faussée des allégeances et des mœurs ?
Chacun, désormais, peut constater les résultats édifiants de 45 années de démission, à l’école et aux frontières. Saurons-nous, pourtant, renoncer à la licence, et assumer le devoir de continuité civilisationnelle qui nous incombe ? Le doute est plus que jamais permis, même si notre pays, à d’autres carrefours de l’Histoire, a su démontrer qu’il avait le sens du sursaut…
[1]Donc, d’abord, à devenir tel.
[2]J’ai à cet égard en mémoire l’interrogation, effarante de stupidité, posée par Ruth Elkrief au candidat Jean-Frédéric Poisson, lors du second débat de la primaire de la droite et du centre : « Jean-Frédéric Poisson, vous, vous voulez un ministère de l’instruction publique, et cette appellation elle date de 1828, elle a même été reprise sous Vichy. Est-ce que c’est la nostalgie qui fera avancer le jeune en 2017 ? » Fermez le ban ! Que Vichy ait pu appeler ainsi un ministère suffisait à disqualifier toute entreprise consistant à définir si l’État doit avoir part à l’éducation des enfants, ou à leur seule instruction – belle question dont on pourrait d’ailleurs dire que la modernité l’a résolue en établissant que l’État doit intervenir toujours davantage dans l’éducation de l’enfant, et toujours moins dans son instruction.
[3]A cet égard, on connaissait depuis longtemps le fameux conseil prodigué par la vieille femme au Zarathoustra de Nietzsche, dans son commerce avec le sexe opposé. Mais l’on ignorait encore, jusqu’à l’avènement de l’inénarrable Greta, sa transposition au monde des adultes. Une version actualisée par notre prophétesse adolescente n’est pas encore prévue, mais je propose déjà : « Tu vas chez les adultes ? N’oublie pas le fouet ! »
[4]Nazi bien sûr ; mais encore colonial, esclavagiste, et aujourd’hui, faustien, anti-écologique.