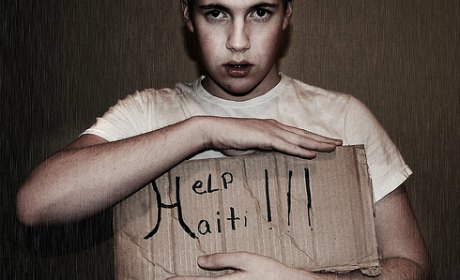Notre confrère et ami publie, avec Pierre Péan, une biographie de Jean-Marie Le Pen qui divise le Parti des médias. Pour les uns, il était temps de traiter cet homme politique comme n’importe quel autre, tandis que les autres accusent les auteurs d’avoir blanchi Le Pen. Paysage pendant la bataille.
Élisabeth Lévy. Votre livre a été très bien accueilli par des personnalités « fréquentables » (Jean-Louis Bourlanges, Philippe Meyer, Éric Naulleau…), peu suspectes de crypto ou de para-lepénisme. D’un autre côté, Le Nouvel Obs, Marianne – votre journal ! − et Patrick Cohen, de France Inter, vous ont accusés, Pierre Péan et vous, de « blanchir » Jean-Marie Le Pen. Votre refus de vous placer sur le terrain moral n’a-t-il pas, sinon l’ambition, du moins la fâcheuse conséquence de vous amener à cautionner les idées et le parcours de Le Pen ?
Philippe Cohen. Ce qui m’étonne le plus dans cette affaire, c’est que, vingt ans avant Pierre Péan et moi-même, en 1994, Gilles Bresson et Christian Lionet avaient entrepris une biographie de Le Pen avec exactement le même genre d’esprit : aller le voir dans une démarche d’enquête, sans a-priori, en acceptant l’idée que la fréquentation de leurs interlocuteurs d’extrême droite risquait forcément de les humaniser. Ils admettaient aussi que l’empathie est inévitable lorsqu’on écrit une biographie. Notre livre ressemble à celui de Bresson et Lionet : il est essentiellement factuel et il poursuit, au fond, le récit qu’ils avaient entamé. La différence, c’est que leur livre a suscité un « accueil zéro » : aucun ou très peu de commentaires, ni pour ni contre ! Probablement parce que ses auteurs venaient de Libération et qu’il était donc difficile de les mettre en cause. C’est la pensée en pilotage automatique. Comme vous l’avez noté, nous ne bénéficions pas de la même bienveillance de tout le monde. Du reste, le papier qu’a écrit Renaud Dély, dans Le Nouvel Observateur, contre notre livre, présente une énorme contradiction : d’un côté, il fait l’éloge du Bresson/Lionet et, de l’autre, il nous reproche de mettre en doute le fait que Le Pen ait torturé en Algérie. Or, concernant ce dossier, Bresson et Lionet l’ont fait bien avant nous, et de manière plus affirmative ![access capability= »lire_inedits »]
ÉL. Conclusion ?
Il y a quatre hypothèses. Soit Renaud Dély n’a pas lu notre livre, soit il n’a pas lu celui de Bresson et Lionet, soit il ne s’en souvient pas, soit il est de mauvaise foi. Je me garderai bien de trancher…
ÉL. Tout cela ne vous en affecte pas moins…
D’abord, cela nous enrage que la présentation de l’ouvrage et de notre travail soit tronquée. Ceux qui se focalisent sur le soupçon de « blanchiment de Le Pen », évitent de rapporter tout ce que le livre révèle sur le parcours de Le Pen et qui est terriblement à charge : les accords secrets locaux avec les partis républicains, les arrangements avec Tapie, les histoires d’argent, etc. Du coup, ils finissent, involontairement bien sûr, par rendre un fier service à Le Pen qui préfère certainement que l’on parle de sa réhabilitation que de ses turpitudes.
ÉL. Oui, mais cela touche aussi à votre histoire….
Ce qui est terrible, c’est que les paroles de Renaud Dély, de Patrick Cohen et de ceux qui pensent comme eux ne me sont pas du tout étrangères. Je suis un peu plus âgé qu’eux et, pendant des années, j’ai répété les mêmes slogans qu’eux, employé les mêmes mots et pensé, comme eux, qu’il fallait opposer une radicalité virile et sacrée contre les « fascistes ». J’ai été un antifasciste militant, ce qui m’a valu quelques coups de barre de fer sur la tête. On m’attendait souvent à la sortie de mon lycée, à Nice, alors bastion de l’extrême droite ; je me souviens même qu’à 18 ans, j’ai mis 2000 lycéens du Parc impérial en grève contre Ordre nouveau.
ÉL. Ôte-nous un doute : tu n’es plus antifasciste ?
Je ne pense pas – et aucun historien non plus, d’ailleurs – que Le Pen soit un fasciste ou un nazi. Et je pense même que le qualifier ainsi lui rend service pour conforter son camp et même recruter. Il n’y a pas de danger fasciste en France et en Europe, mais plutôt un risque sérieux de montée de forces populistes qui jouent la double carte de la démocratie – ils ne feront pas de marche sur Rome – et de la démagogie.
ÉL. Votre dossier se présente mal. Non seulement vous vous abstenez de tout jugement moral, mais vous prétendez faire dans la nuance, montrer ce que le personnage pourrait avoir de bien. Vous discutez la nature de son antisémitisme (y en aurait-il un bon?) et laissez entendre, sans totalement convaincre, qu’il n’a peut-être pas torturé en Algérie. Peut-on éprouver autre chose que de l’aversion ? Peut-il y avoir du bon en Le Pen ?
Nous ne prétendons pas dégager ce que le personnage pourrait avoir de bien : nous avons recherché à retracer avec autant de justesse possible son parcours. Toutes proportions gardées, certaines réactions me rappellent la polémique qui s’est abattue sur Hannah Arendt après la publication de son Eichmann à Jérusalem. Eichmann devait être un monstre : Arendt fait son travail, elle montre qu’il est un homme très médiocre, faible… d’où son expression : « banalité du mal », qui est très mal passée et a suscité une polémique qui perdure encore. Je ne prétendrai jamais arriver à la cheville d’Hannah Arendt, mais il me semble qu’il y a quelque chose de comparable dans le phénomène autour de notre livre. Pendant trente ans, nombre de médias et de personnalités d’une certaine gauche ont construit un monstre qui s’appelle Le Pen. Tout serait haïssable chez lui, depuis le début : dès l’enfance, c’est un salopard, dès l’âge de 5 ans il torture, il est d’extrême droite dès son entrée en fac, etc. Ce corpus est devenu « sacré » : nul n’est autorisé à le remettre en cause, sauf à être traité de « crypto-lepéniste ». Cette légende noire constitue une histoire fermée pour l’éternité, un dogme. Cela m’est insupportable. À chaque génération, on remet sur le métier pour écrire l’Histoire ; Marc Bloch disait que le passé éclaire le présent mais que l’inverse est tout aussi vrai.
ÉL. Tu as prononcé un mot essentiel : Le Pen n’est pas né d’extrême droite. Sans doute, mais il l’est devenu. Et il incarne une idéologie qu’on a quelques raisons de ne pas apprécier particulièrement…
Évidemment. Le Pen est devenu un homme politique d’extrême droite, nous ne le discutons pas. Ce que nous contestons, c’est que son parcours ait en quelque sorte été orienté par une prédestination au mal. En 1968, il ne se joint pas aux SAC ou aux groupuscules d’extrême droite qui attaquent les gauchistes. Trois ans plus tard, il écrit un mémoire de sciences politiques consacré à l’anarchisme en France qui se termine par une citation élogieuse d’Albert Camus. Seulement voilà, rapporter ces faits, ce serait réhabiliter Le Pen…
ÉL. Comment l’expliques-tu ?
Ce genre de détail n’est pas intégrable dans la légende noire fabriquée par la gauche médiatique. Elle tient pour un crime le simple fait de dire qu’il n’est pas seulement fasciste, nationaliste, raciste, antisémite. Cette nuance est insupportable.
ÉL. Pas que, d’accord, mais aussi fasciste, nationaliste, raciste, antisémite, non ?
Il est nationaliste et a tenu des propos à caractère antisémite ; quant à raciste, on peut dire que les mots d’ordre du Front national sur l’immigration pouvaient stimuler le racisme. Fasciste non, si l’on définit le fascisme comme un projet politique visant à prendre ou à garder le pouvoir par la force. Le Pen n’a jamais été tenté par ce genre de stratégie, alors même qu’il a probablement été sollicité par les initiateurs du putsch des généraux en 1961.
Daoud Boughezala. Puisqu’on parle d’Histoire, vous évoquez, dans votre livre, des épisodes occultés par les grands médias : les rapports incestueux entre Le Pen et la gauche, du ralliement de Tixier-Vignancour à Mitterrand en 1965 aux renvois d’ascenseur avec Bernard Tapie dans les années 1990…
Ne vous trompez pas : en 1965, c’est Tixier-Vignancour qui décide d’appeler à voter Mitterrand au second tour de la présidentielle, sans consulter Le Pen, qui est pourtant son directeur de campagne. Le Pen s’oppose à cette décision − peut-être qu’il n’y a pas participé −, et rompt avec Tixier-Vignancour, ce qui ouvre une scission dans leur organisation.
DB. Et le débat truqué avec Tapie – épisode que vous dévoilez mais que personne ne commente…?
Ça, je l’ai vécu. Au début des années 1990, la gauche, qui a tout essayé contre Le Pen, croit avoir trouvé son sauveur en Bernard Tapie. Tapie est gouailleur, sait parler au peuple, traite en face les électeurs lepénistes de « salauds ». Il devient une espèce de champion de l’antifascisme. Mais notre enquête nous a permis de découvrir que le fameux débat télévisé Tapie-Le Pen était truqué. Les deux s’étaient mis d’accord pour taper sur les autres partis (PS, RPR, UDF) sans aborder leurs points faibles respectifs : l’antisémitisme pour Le Pen, les affaires pour Tapie. Voilà l’antifascisme des années 1990 ! Faut-il en être fier et le défendre, vingt ans après ?
DB. Et Mitterrand ? Fait-il la proportionnelle uniquement pour balancer des députés lepénistes dans les pattes de la droite, ou aussi par souci de démocratie ?
La proportionnelle faisait partie du programme du candidat Mitterrand. Mais personne ne s’attendait à une dose aussi massive de proportionnelle. Notre enquête montre, en tout cas, que l’instauration de cette proportionnelle était conçue, en 1985, comme une arme destinée à limiter la progression de la droite, tandis que la diabolisation, via la création de SOS-Racisme, visait, elle, à empêcher une alliance entre le FN et la droite. Mitterrand voulait donc un Front fort et une droite anti-FN, ce qui permettait de geler une partie des suffrages de la droite. Il a parfaitement réussi son pari.
ÉL. Au-delà de ces accointances occasionnelles, on observe une cécité manifeste : le refus total d’évaluer la politique du « cordon sanitaire » à l’aune de ses résultats. Mais le « cordon sanitaire » n’explique pas tout. Que signifie l’ascension du FN ? Révèle-t-elle une droitisation de la société, voire son extrême droitisation ?
Plusieurs éléments jouent. Le Pen a été, malheureusement, le premier ou l’un des premiers à mettre en avant des sujets qui sont aujourd’hui au centre du débat public. Dans les années 1980, avant même de s’attaquer à la mondialisation et alors qu’il voulait incarner le « Reagan français », Le Pen parle frontalement de sécurité et d’immigration. Dans les années 1990, il met assez vite en avant le thème de la mondialisation. Bien sûr, il n’est pas le seul. Il y a Chevènement, Marianne et d’autres, mais lui est écouté, notamment par cette partie de l’électorat qui quitte la gauche pour aller vers le Front national. Un électorat populaire que la gauche n’a pas réussi à récupérer. Résumant la thèse d’Orwell, Jean-Claude Michéa a écrit, dans Le Complexe d’Orphée : « Quand l’extrême droite progresse chez les gens ordinaires, c’est d’abord sur elle-même que la gauche devrait s’interroger. »
DB. Vous expliquez que la stratégie du « cordon sanitaire » a évité au Front national d’avoir un bilan, fût-il seulement local, donc des comptes à rendre…
Quand le Front national présente un bilan local, celui-ci est généralement assez catastrophique. La seule exception est la ville d’Orange, où Jacques Bompard est parvenu à se maintenir en quittant le FN. Le problème est que nous sommes pris en tenailles : si nous expliquons qu’il est impossible de prendre Le Pen en défaut parce qu’il n’a pas pu exercer de responsabilités et qu’il incarne une sorte de « parti aux mains blanches », puisque jamais dans le cambouis, on nous soupçonne de souhaiter qu’il arrive au pouvoir ! Nous ne nous situons pas comme militants, mais comme journalistes et notre question est : oui ou non, le fait que Le Pen n’ait jamais exercé de responsabilités politiques l’a-t-il aidé à consolider son électorat ? À ce sujet, nous rapportons un épisode significatif : en 1983, Le Pen se présente à La-Trinité-sur-Mer lors d’une législative partielle du Morbihan, d’ailleurs uniquement parce que son lieutenant Jean-Pierre Stirbois a obtenu un meilleur score que lui aux municipales et qu’il ne veut pas se laisser doubler. Le président du Front national obtient 12% dans la circonscription et 50% à La-Trinité-sur-Mer. Son directeur de cabinet, Jean-Marie Le Chevallier, atteste que le maire de La Trinité a alors fait à Le Pen une proposition qu’il ne pouvait pas refuser : le leader frontiste devenait maire, le maire actuel occupant le poste de maire-adjoint mais continuant à diriger la ville. Le Pen n’aurait rien eu d’autre à faire que de paraître. Il a décliné cette proposition.
ÉL. Manifestement, Le Pen n’a jamais voulu arriver au pouvoir. Ses dérapages antisémites correspondent d’ailleurs à des périodes d’ascension politique où il se rapprochait des responsabilités…
C’est vrai. Il existe cependant une exception à cette règle. Après une vague d’attentats terroristes à Paris, le gouvernement Chirac convoque tous les chefs de parti à Matignon pour consultations. En pleines journées parlementaires des députés FN, Le Pen, qui a toujours apprécié les honneurs et les ors de la République, réunit ses troupes et leur demande : « Et si Chirac me demande de devenir ministre de la Défense, que faire ? » Il aurait aimé obtenir un poste de cette nature, mais son ami Pascal Arrighi, vieux politicien passé par le RPR, le ramène immédiatement à la raison : cette éventualité n’avait absolument aucune chance de se produire ![/access]
La suite ici
Jean-Marie Le Pen, une histoire française, Philippe Cohen et Pierre Péan (Robert Laffont).
*Photo : Droits réservés.