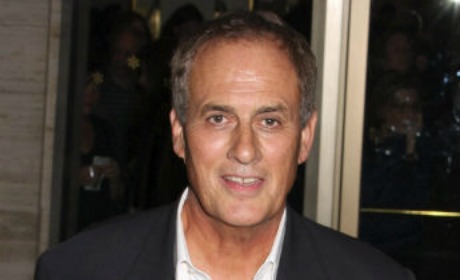Le visiteur arrivant dans le centre-ville de Béziers ne peut qu’être séduit par le cachet architectural. Il est même possible qu’il soit tenté de s’y installer. Avec leur standing haussmannien, les rangées de platanes en plus, les larges allées Paul-Riquet, du nom du bâtisseur du canal du Midi, sont à Béziers ce que les Ramblas sont à Barcelone. Les immeubles bourgeois y ont cet aspect un peu crémeux des décors d’opérette, façades légèrement décaties et charmantes qui rappellent l’âge d’or où l’on pouvait voir des excentriques promener des guépards et des notables sortir des bordels décrits dans un texte de Willy, le mari de Colette. Vision idyllique vite corrigée par celle des commerces désaffectés dont les vitrines empoussiérées jouxtent celles des marchands de kebabs et des magasins de vêtements affichant les mêmes enseignes que partout ailleurs. Le coeur de Béziers se meurt. Cette déchéance mal recouverte d’un vernis Potemkine nourrit depuis longtemps une grogne qui semble enfler à l’approche des municipales de mars.
C’est que la bataille électorale compte un invité surprise : Robert Ménard. Encouragé par son épouse, la journaliste catholique Emmanuelle Duverger, avec laquelle il forme un couple très soudé, soutenu par le Front national, dont il n’est pas membre, mais aussi par Debout la République, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, l’ancien dirigeant de Reporter sans frontières, ex-journaliste à i-Télé et cofondateur de Boulevard Voltaire, un site internet plutôt droitier, espère bien enlever la mairie à la droite[access capability= »lire_inedits »] (RPR puis UMP) qui la tient depuis dix-huit ans. Un sondage réalisé mi-novembre pour Midi Libre et Sud Radio le crédite de 35% des voix au premier tour, à un point de la liste UMP, mais largement devant le candidat socialiste qui ne récolte que 18% d’intentions de vote. « Oui, il y aura la flamme du FN sur mes affiches, dit-il, anticipant les remarques désobligeantessur ce compagnonnage. Ça mefera gagner la ville. »
Quoique son abord un brin austère ne témoigne pas d’un goût immodéré pour la fanfreluche, Ménard rêve de voir Béziers retrouver sa superbe d’antan. Enrichie au XIXe siècle par le commerce du vin, la localité héraultaise, 75 000 habitants, est aujourd’hui une banlieue morose et pauvre, une sorte de Détroit post-General Motors ouverte aux quatre vents. Les riches et les classes moyennes supérieures ont déserté le centre, tout en y restant propriétaires, pour des quartiers où le déclin et la désindustrialisation se font un peu moins sentir. La viticulture, qui pissait le vin et remplissait les poches, s’est peu à peu relevée, en misant sur la qualité, de sa longue crise entamée dans les années 1960, mais elle ne suffit plus à faire vivre la région. Alentour, pas d’industries, pas de pôles de recherche, rien qui puisse donner de l’air et du nerf à la ville plombée par un taux de chômage de 15 %. Ah si, il y a bien le Polygone, centre commercial « hors les murs » et surtout « zone franche » : grâce à cette balle fiscale que la municipalité s’est tirée dans le pied, plus de cent boutiques et restaurants, sans oublier les médecins et autres professions libérales, ont migré du centre-ville. Quant aux propositions des candidats pour sortir de la crise – implantation de nouvelles technologies, relance du tourisme, etc. –, elles ressemblent à un catalogue de voeux pieux et de slogans creux.
De toute façon, à Béziers, le déclin économique se conjugue au marasme identitaire et Ménard en a conclu que pour enrayer le premier, il fallait soigner le second. L’inéluctable, ou ce qui se présente comme tel, ne saurait être une fatalité. « Béziers va mal, reconnaît le socialiste Jean-Michel Du Plaa, déjà candidat en 2008, vice-président du Conseil général de l’Hérault, un homme au calme olympien. « Le centre est à l’abandon. Dans le quartier de la cathédrale, 42 % des habitants vivent des minimas sociaux. »
« Une immigration de centre-ville, typique du Midi », observe pour sa part Robert Ménard. On a là les Rmistes du soleil. » Ce sont en effet des familles modestes, voire démunies, pour une bonne part d’origine immigrée et de confession musulmane, qui se sont installées dans les demeures abandonnées par les Biterrois « de souche ». S’il y a là matière à roman fiévreux sur les rapports de domination et leurs évolutions, il y a surtout matière à politique, car ce « changement de population » passe d’autant moins qu’il ne s’est pas produit à la périphérie, mais dans le cœur historique de la ville. Mortifiée d’avoir perdu son rang social, Béziers redoute de voir disparaître les dernières traces de l’image d’Épinal d’un vivre-ensemble languedocien, fait de vin gai et d’heureuses civilités – qui ressuscite toujours au mois d’août, quand la féria remplit les rues et les gradins des arènes où se déroulent les courses de taureau.
Dans ce climat déprimé, les chances de Ménard sont réelles. « À condition qu’il soit capable de résister à son penchant pour la provocation », considère un proche. Il lui faut aussi justifier, ou faire oublier, la présence dans son équipe de campagne de deux membres du Bloc identitaire et du président du FNJ de l’Hérault, un étudiant dont le goût pour les jolies blondes l’avait « égaré » vers un site faisant par ailleurs l’apologie de Breivik, ce qu’il ignorait, dit-il. Mais son compte Facebook portait la trace de cette visite suspecte. « Pour moi, c’est du passé, assure le jeune homme. Aujourd’hui, je veux faire de la politiquesérieusement. »
Né à Oran, Robert Ménard se sent chez lui à Béziers, où il est arrivé enfant, à l’indépendance de l’Algérie. Son père, qui travailla à la base navale de Mers el-Kébir, a eu sa période OAS – et n’était pas franchement enthousiasmé par le précédent mariage de Robert avec une juive. Le fils a vécu à La Devèze, un quartier populaire construit à la périphérie biterroise pour accueillir les rapatriés. Son programme pour Béziers, décliné en mots clés : insécurité, incivilités, impôts, ghettos, propreté, laïcité. Ménard accuse l’équipe municipale du sénateur-maire UMP Raymond Couderc de clientélisme à large échelle. Et dénonce les dépenses inutiles, comme cet abribus facturé 66 000 euros, situé face à l’hôtel de ville, une sorte de hutte en fer élevée au rang d’œuvre puisque conçue par un artiste. « C’est cher et c’est horrible », tranche Ménard.
« Si clientéliste signifie proche des gens, alors je suis ultra-clientéliste », réplique le député et adjoint au maire Elie Aboud, l’homme qui conduira la liste de la majorité sortante. Sa priorité, c’est l’emploi : « J’irai chercher les investisseurs avec les dents. » Cardiologue, originaire du Liban, chemise rose et sourire éclatant, Aboud est pourtant bien obligé de s’engager sur le terrain sécuritaire et identitaire balisé par Robert Ménard. « Je suis profondément laïque, d’une laïcité positive, précise-t-il. Je serai intraitable avec le communautarisme, j’ai dit non aux drapeaux étrangers aux cérémonies de mariage en mairie. »
Symbole de la mutation, la multiplication des fameux « kebabs », source inépuisable de vannes chez les « rebeus » en mode drague fauchée et motif croissant d’irritation pour les Biterrois d’avant, électeurs ou non du Front national. Un, deux, trois, quatre, peut-être cinq kebabs le long ou aux abords des allées Paul-Riquet. Un autre encore, dont on annonce l’ouverture prochaine. « Même le McDoest parti, c’est dire… », relève Michel, un entrepreneur trentenaire qui a voté Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle de 2002 et donnera sa voix à Ménard en mars. Et puis il y a la « rue halal », l’avenue Gambetta, qui relie le bas de Béziers, où se trouve la gare SNCF, à ses hauteurs historiquement plus majestueuses. « Quatreboucheries halal, avenue Gambetta,c’est peut-être un peu trop », ose Claude Zemmour, secrétaire de la section socialiste de Béziers, conseiller régional du Languedoc-Roussillon et greffier à la cour d’appel de Montpellier. Un pied-noir, comme Ménard. Il ne souhaite pas, on s’en doute, la victoire de Robert Ménard en mars. « La ville de Jean Moulin [Biterrois de naissance, ndlr] méritemieux qu’un candidat élu avec lesoutien du Front national », dit-il. Mais passé cette génuflexion obligée, son diagnostic ne diffère quasiment pas de celui du candidat dont il réprouve l’accointance idéologique. « Il y a trois ans, dans le quartier de la gare, c’était bien, mais là, c’est devenu tentaculaire, c’est l’envahissement – voyez, je ne parle pas d’“invasion” comme le FN. Dans certaines classes du centre, le taux d’écoliers issus de l’immigration est passé de 20 % à 40 %. »
Ces considérations déplaisent à Nordine Abid, fils et petit-fils de harki, sans oublier un grand-oncle maternel enterré à Verdun : « On n’est pas en Union soviétique, la liberté du commerce, ça existe ! » Ex-UMP, Nordine Abid est l’un des probables futurs colistiers de Robert Ménard. Il tient à distinguer les thématiques nationales des « problématiques locales ». Ainsi pense-t-il que la maîtrise des flux migratoires n’est pas un enjeu de la campagne municipale biterroise. « L’essentiel, reprend-il, c’est de faire respecter la loi. » Le candidat Robert Ménard partage bien sûr ce très sage avis, mais il n’en démord pas : l’immigration, qui se poursuit au titre du regroupement familial, amenant chaque année de nouveaux arrivants qui rendent plus difficile l’intégration des vagues précédentes, est l’un des moteurs de son engagement pour Béziers. Ce samedi matin, Ménard, accompagné d’Abid et escorté de deux costauds de son équipe de campagne, est venu « tracter » sur le marché de La Devèze, dans les effluves de paëlla et de couscous. Le voilà qui ressort d’une épicerie dont le patron, justement, l’a « allumé » sur l’immigration. « Je lui ai demandé s’il était pour, et il m’arépondu que non », rapporte Ménard, démonstration faite, pour ainsi dire.
N’empêche, la dureté de la vie, ici, n’a pas d’origine ou de religion. Christophe et Sandra, parents de six enfants, en savent quelque chose. Elle est mère au foyer, lui ancien agent d’entretien à l’OPAC (Office public d’aménagement et de construction), mais à l’assurance invalidité en raison d’une maladie cardiovasculaire. « On habitait la barre Capendeguy, à La Devèze, raconte le mari. On est partis il y a cinq ans quand ils l’ont rasée. Nous, on n’a jamais eu de soucis ici. Le FN, c’est pas mes idées, on a besoin de tout le monde pour vivre. » Mimoun, 63 ans, père de cinq enfants, peintre en bâtiment d’origine marocaine, « dans deux ans la retraite », assimile Robert Ménard au Front national et enchaîne : « Le FN, dit-il, exagère avec les Roms et notre communauté [maghrébine], même s’il y a des jeunes qui font des conneries. Chez moi, ça bosse. J’ai un fils artisan dans une entreprise de terrassement et une fille caissière à Géant. »
L’obsession, comme partout ailleurs, c’est le chômage. Magdalena aimerait bien avoir un vrai boulot. Pour l’heure, elle vend des soutiens-gorges sur les marchés, 3 euros l’un, 5 euros les deux. « C’est ma grand-mère qui les achète à une usine. Je n’ai pas de diplôme, comme la plupart des gens à Béziers. Certains sont pistonnés pour travailler à la cantine, à l’hôpital ou pour la mairie. Mon mari a postulé pour nettoyer les rues. Sans succès. » Lydia et ses soeurs, la soixantaine et des poussières, ont quitté La Devèze pour des communes proches de Béziers, mais elles reviennent chaque samedi faire leur marché. Pour les prix et pour l’ambiance, qui leur rappelle un peu l’Algérie d’autrefois, qu’elles ont quittée en 1962, échappant de peu au massacre du 5 juillet à Oran. Elles étaient de Mascara, deux de leurs frères ont appartenu à l’OAS. « Il y en a marre de toute cette politique, de tous ces impôts, de tous ces immigrés, de Taubira qui relâche les récidivistes, se plaint l’une des sœurs. On avait de bonnes relations quand on était ensemble, là-bas. Parfois j’ai la nostalgie de cette époque. »
Sur cette terre de pieds-noirs et d’Arabes, où des enfants de harkis côtoient des descendants de fellaghas et d’activistes de l’OAS, on a parfois l’impression d’assister à la continuation de la guerre d’Algérie par d’autres moyens. C’est peut-être ça aussi, le fond des choses, à Béziers.
Les paraboles, tout un symbole…
« Honnêtement, je ne peux pas dire que Béziers est une ville dangereuse, réfléchit à haute voix un Biterrois. Il y a bien sûr les bagarres qui parfois finissent mal, mais généralement elles opposent des groupes bien définis. » Et pourtant, il affirme se sentir en « insécurité ». Et il n’est pas le seul. Tôt le soir, le centre-ville se vide. Les automobilistes, les femmes surtout, évitent alors de garer leur voiture dans le parking souterrain proche des allées Paul-Riquet. On n’a pas souvenir de viols qui s’y seraient produits et les vols à l’arraché y sont, paraît-il, peu fréquents. « À Béziers, l’insécurité, c’est peut-être un sentiment avant tout, mais l’imaginaire fait aussi partiedu réel », affirme Robert Ménard, qui projette d’armer les policiers municipaux et de faire passer leurs effectifs de 40 à 80. Ces pandores équipés d’armes à feu patrouilleraient après 23 heures, la limite horaire qui sonne aujourd’hui la fin du service. À cette insécurité qui monte à la tombée de la nuit, s’ajoute l’« insécurité culturelle », pointée par Patrick Buisson autant que par la Gauche populaire, qui naît de la concurrence des « normes identitaires ». Les kebabs du centre de Béziers, mais aussi les antennes paraboliques déployées aux fenêtres et sur les toits, dont Robert Ménard exigera qu’elles soient ôtées s’il est élu maire, participent de cette insécurité culturelle aux yeux de ces Biterrois, qui « ne reconnaissent plus [leur] ville ». Les incivilités forment le troisième cercle de l’insécurité, le plus tangible : les jeunes qui « crachent par terre » ; la vendeuse de la boulangerie qui ne dit pas « merci » ni même « au revoir » à la cliente ; les « gamins » qui parlent fort et ne cèdent pas leur siège à plus âgé qu’eux dans le bus reliant Béziers au bord de mer, un phénomène particulièrement pénible l’été, de l’avis d’adultes qui n’osent faire une remontrance de peur de s’en prendre une. Samedi 12 octobre, le pédopsychiatre Aldo Naouri, qui pâtit ou bénéficie, c’est selon, d’une réputation de « réac », donnait une conférence dans le beau théâtre municipal à l’italienne. Le thème en était « L’éducation précoce ». Sachez dire « non » à vos enfants qui vous martyrisent, professait-il en substance aux parents venus l’écouter. C’est promis ![/access]
*Photo : Bernard Rivière. Béziers.