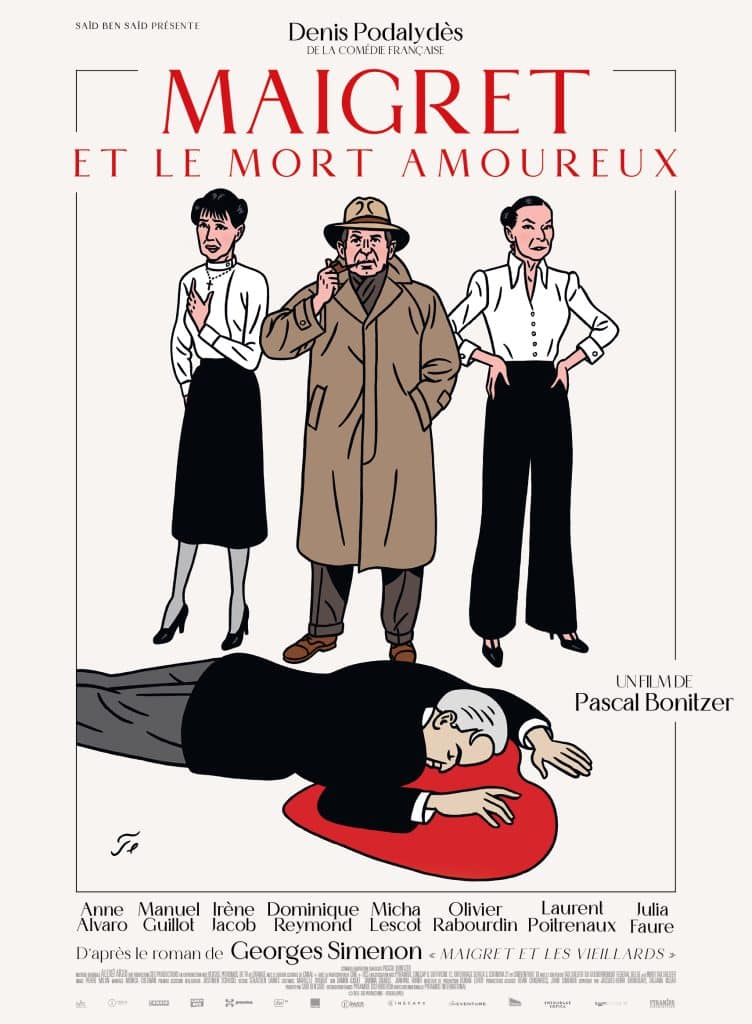L’affaire Epstein connaît ses effets les plus dévastateurs chez nos voisins britanniques. Le Premier ministre est en sursis. Grand récit.
Dans l’Ancien Testament, le livre de Daniel raconte l’histoire de Belschatsar roi de Babylone qui, un jour, donne un grand festin au cours duquel il profane les vases sacrés volés au sanctuaire de Jérusalem. « Soudain apparurent des doigts de main humaine qui se mirent à écrire, derrière le lampadaire, sur le plâtre du mur du palais royal ». Le monarque n’arrive pas à déchiffrer le sens de la formule énigmatique rédigée par la main mystérieuse, mais il comprend obscurément que son sort est scellé. Il meurt la nuit suivante.
En anglais, cet épisode biblique a donné lieu à une expression courante, « the writing is on the wall », pour indiquer qu’un certain dénouement négatif est devenu inévitable. Et que ce n’est plus qu’une question de temps… C’est ainsi que l’on peut dire, à propos de sir Keir Starmer, Premier ministre et chef du Parti travailliste, que « the writing is on the wall ». Car les ondes de choc successives provoquées par le véritable tremblement de terre politique et social qu’est l’affaire Epstein ont eu des effets plus dramatiques au Royaume Uni qu’ailleurs. Les révélations apportées, d’abord par les témoignages des femmes victimes du financier pédocriminel, ensuite par la publication échelonnée des innombrables documents recueillis au cours de l’enquête menée par les autorités américaines, entachent non seulement la famille royale en la personne de l’ex-prince Andrew, mais aussi le gouvernement à travers la nomination par Starmer de Peter Mandelson comme ambassadeur britannique à Washington. Cette décision, qui semble aujourd’hui incompréhensible, n’a pas encore provoqué la chute du Premier ministre, mais a tellement ébranlé son autorité dans le parti et au-delà, que tout le monde se demande, non pas s’il va démissionner, mais quand ?
Un revenant devenu encombrant
Le Premier ministre a annoncé la nomination de M. Mandelson à la fin de 2024, avant même que ne soit achevé le processus de vérification de l’aptitude pour le poste de l’ancien ministre de Tony Blair et de Gordon Brown. Starmer aurait été encouragé à le faire par son chef de cabinet et conseiller le plus proche, Morgan McSweeney. Ce dernier, qui a été l’architecte de la victoire électorale des travaillistes en juillet 2024, avait eu comme mentor politique Peter Mendelson. Le nouvel ambassadeur, en fonction à partir de février 2025, avait pour mission de faciliter les négociations commerciales entre le Royaume Uni et l’administration de Donald Trump. Mais en septembre, une première publication de documents concernant Jeffrey Epstein par le House Oversight Committee, une des commissions les plus puissantes de la Chambre des Représentants américaine, a focalisé l’attention générale sur les relations étroites entre l’ambassadeur et le multimillionnaire. Face au scandale, M. Mandelson a refusé de démissionner, obligeant M. Starmer à le limoger. Si, à ce moment-là, sa décision de le désigner comme ambassadeur a été vivement critiquée par l’opposition parlementaire et la presse, les attaques contre sa capacité de discernement ont explosé quand, le 30 janvier, le département de la Justice américain, contraint par le passage d’une loi, l’Epstein Files Transparency Act, le 19 novembre, a publié un ensemble de plus de 3 millions de pages de documents, 180 000 images et 2 000 enregistrements vidéo et audio. Le monde a ainsi appris que les liens entre MM. Mandelson et Epstein étaient encore plus proches qu’on ne croyait et ont persisté bien après la condamnation et le passage en prison d’Epstein entre 2008 et 2009. Plus choquant encore, on a appris que Mandelson, ministre à cette époque – époque qui est aussi celle de la crise financière – a partagé avec son ami américain des informations sensibles sur le plan financier.
A lire aussi, Elisabeth Lévy: Faut-il vraiment fouiller dans les poubelles d’Epstein?
Devant le tollé général, Starmer a contraint Mandelson à démissionner du Parti travailliste et de lquitter son statut de membre de la Chambre des Lords. On parle même de lui ôter son titre de « Lord », procédure inhabituelle et laborieuse.
De son côté, la police anglaise annonce l’ouverture d’une enquête pour déterminer si les actions de M. Mandelson sont criminelles.
Sommé de dire ce qu’il savait des relations Epstein-Mandelson avant la nomination, Keir Starmer a nié être au courant et a accusé les insuffisances du système de vérification par les services de renseignement. Pourtant, le Parlement a décidé qu’une commission devait avoir accès à tous les documents concernant le processus de nomination et de vérification. Ladite commission doit porter un jugement sur ce processus et rendre publics certains des documents – une sorte de mini-Epstein-files. Sera-ce le coup de grâce pour la carrière politique de Starmer ? Le Premier ministre est déjà impopulaire et faisait l’objet de différents complots ourdis par certains de ses collègues travaillistes qui voudraient le remplacer. Pour l’instant, il survit seulement à travers le sacrifice de son chef de cabinet, M. McSweeney, contraint de démissionner le 8 février. Le retour de Mandelson et le discrédit qu’il jette – à travers Epstein – sur le gouvernement travailliste actuel représente un étrange retour de bâton, par lequel le Labour de Starmer est comme sapé de l’intérieur par le New Labour de Blair et de Brown.
« Mandy » ou « Petie » : celui par qui le scandale arrive
Mandelson était une figure centrale du mouvement réformiste lancé au sein du parti travailliste par Tony Blair et Gordon Brown dans les années 1990. Arrivés au pouvoir après leur victoire aux élections de 1997, les hommes du New Labour ont gouverné jusqu’en 2010. Cette période peut être comprise aujourd’hui comme étant celle d’une certaine mondialisation naïve, fondée sur la croyance que, grâce aux progrès illimités de la technologie et à l’ouverture des frontières à la circulation des capitaux et des personnes, le monde allait connaître un âge de prospérité et de liberté sans parallèles dans l’histoire. Nommé ministre sans portefeuille en 1997, Mandelson devient secrétaire d’État aux Affaires et au Commerce pendant six mois en 1998, avant d’être nommé secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord en 1999, jusqu’en 2001. Entre 2004 et 2008, il est envoyé à Bruxelles comme commissaire européen au Commerce, l’époque de la grande ouverture aux exportations chinoises. De retour à Londres en 2008, il retrouve le poste de secrétaire d’État aux Affaires et au Commerce, maintenant dans le gouvernement de Gordon Brown dont il devient le numéro deux et l’homme à tout faire.
A lire aussi, Stéphane Germain: Socialisme façon Trump
Pourquoi tous ces changements de poste ? Au-delà des prétendues compétences de M. Mandelson, il ne cesse d’être poursuivi par des scandales de corruption. Il démissionne une première fois en 1998 pour un conflit d’intérêt : son département gouvernemental est censé enquêter sur les activités financières d’un collègue qui, en l’occurrence, a prêté de l’argent à M. Mandelson pour l’achat d’une maison, fait que celui qu’on surnomme « Mandy » avait caché. Il démissionne une deuxième fois en 2001, accusé d’avoir essayé d’utiliser son influence pour la délivrance d’un passeport britannique à un homme d’affaires indien. Une enquête officielle le blanchit, mais il est alors « grillé » comme ministre. Pendant son mandat comme commissaire européen, on l’accuse d’avoir des relations qui frôlent le conflit d’intérêt avec Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, et l’oligarque russe, Oleg Deripaska, mais rien n’est prouvé. Telle est sa réputation d’homme politique manipulateur adonné aux magouilles. Et son surnom gentillet de « Mandy » cède la place à celui, satanique, de « the Prince of Darkness », « le Prince de la nuit ».
Ce que révèlent les « Epstein files », c’est que pendant toute cette époque, Mandelson entretenait une complicité étroite avec le financier pédophile dont il partageait dans une certaine mesure, non les tendances sexuelles (M. Mandelson est homosexuel), mais la vénalité. Les deux hommes se rencontrent en 2001 et maintiennent des relations jusqu’en 2011, donc bien après la condamnation d’Epstein. Pendant tout ce temps, l’homme politique a reçu des dons d’argent de la part du financier. Par exemple, 75 000 dollars en trois versements entre 2003 et 2004. Son partenaire, un Brésilien, a également profité de la générosité d’Epstein, recevant des milliers de livres en 2009 et 2010, au moment où Mandy était secrétaire aux Affaires et au Commerce. En retour, Mandelson semble avoir fourni des informations et des mises en relations pour faciliter les affaires d’Epstein. C’est notamment au moment de la crise financière que le ministre a donné à son ami des tuyaux, l’avertissant de la vente par le gouvernement britannique de biens valant 20 milliards de livres, ou de l’opération de sauvetage de l’euro par l’UE pour un coût de 500 milliards d’euros. Outre leurs affaires véreuses, les deux hommes ont fait preuve d’une grande connivence sur le plan personnel. Mandelson a voyagé dans le jet privé d’Epstein, a visité son île de Little Saint James et a séjourné dans sa maison newyorkaise. Des photographies dans les archives d’Epstein montrent le Britannique debout en slip à côté d’une jeune femme. Dans un livre d’or pour l’anniversaire de l’Américain en 2003, M. Mandelson a écrit qu’il était son « meilleur pote ». Et celui que le financier appelait familièrement « Petie » (de Peter) se confiait à Epstein sur les difficultés de sa relation avec son compagnon (aujourd’hui mari) brésilien.
« Mene, mene, tekel, upharsin »
« Compté, compté, pesé, divisé » : tel était le texte énigmatique écrit par la main mystérieuse sur le mur du palais de Belschatsar. Les jours de Starmer comme Premier ministre sont désormais comptés. Survivra-t-il jusqu’aux élections locales du mois de mai, qui tombent le même jour que les élections pour les assemblées galloises et écossaises ? Si oui, la débâcle électorale qui attend inévitablement les travaillistes mettra fin à sa carrière de dirigeant à ce moment-là. Mais Starmer survivra-t-il même jusqu’à l’élection partielle de Gorton et Denton (dans la région de Manchester) qui aura lieu le 26 février ? Les sondages suggèrent que, dans cette circonscription jusqu’à présent travailliste, la victoire sera disputée par les Verts et Reform UK. Une défaite pourrait également provoquer la chute de l’actuel Premier ministre.
A lire aussi, Antoine Schmitt: Pourquoi les Français ont-ils le conservatisme si honteux?
Pourtant, si les conclusions de la commission parlementaire interviennent avant cette date et si elles montrent clairement que M. Starmer n’a pas dit toute la vérité sur ce qu’il savait à propos de M. Mandelson, la chute pourrait arriver encore plus vite.
Pour l’instant, le locataire du 10 Downing Street a reçu le soutien de ses élus. Mais il se pourrait bien que ces derniers prennent simplement le temps d’aiguiser leur couteau avant la mise à mort finale…