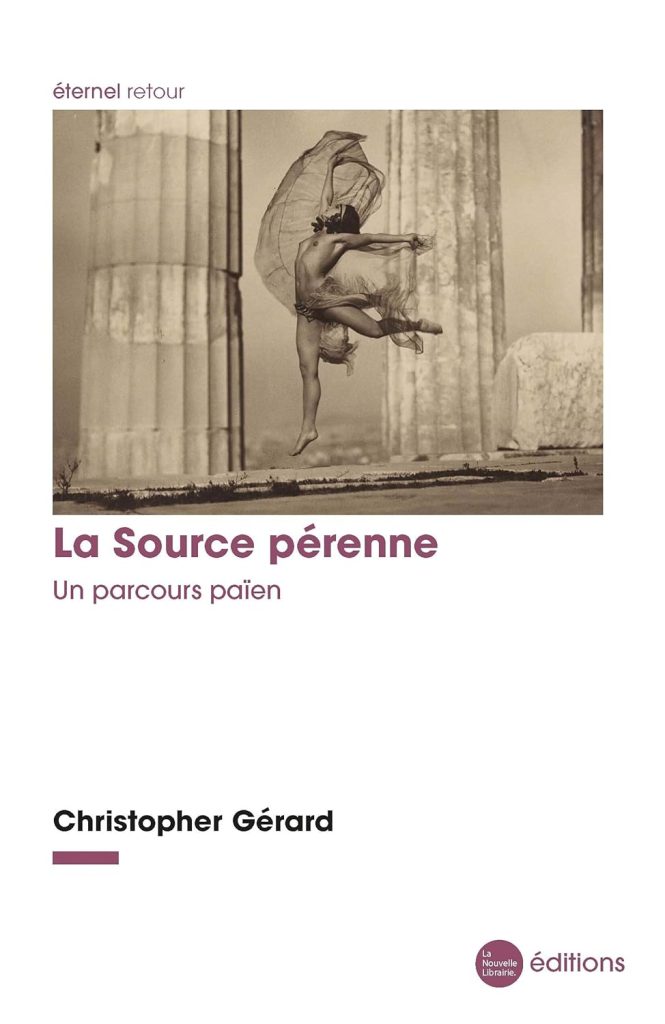Le 6 mai, 28 députés LFI ont voté contre une résolution demandant la libération de Boualem Sansal
Il est des situations politiques qui se répètent. Pour les repérer, il faut ajuster la focale de sa lunette de vue afin de percevoir la longue durée rappelle l’anthropologue. Le contraire du « nez dans le guidon » du chroniqueur de la radio « de service public ».
Regard en arrière : Il arrive que des trajectoires de deux météores se croisent. Ce fut le cas de la rencontre de Victor Serge – alias Victor Lvovitch Kibaltchiche – et de Paul Vaillant-Couturier. C’est en 1929 que ces deux hommes politiques et écrivains se sont rencontrés. Vaillant-Couturier était rédacteur en chef de l’Humanité depuis 1926 avant d’être « viré » en 1929. Il était entré au Comité Central du Parti Communiste en 1920 et il sera limogé en 1922, puis retour en 1924…. Victor Serge, révolutionnaire de la première heure est, lui, exclu du Parti Communiste d’URSS en 1928. Arrêté en 1933 par le Guépéou et gardé prisonnier jusqu’an 1936. Les deux hommes étaient « amis »[1].
Si des intellectuels de l’époque s’élevèrent devant l’arrestation de Victor Serge, on ne trouve pas la signature de son « ami » Vaillant au bas de l’appel des écrivains pour sa libération publié en 1933 dans la revue La critique sociale, pas plus qu’au bas de la lettre « L’appel aux hommes » publiée à l’initiative de Magdeleine Paz, ni dans l’appel publié en 1931 à l’initiative d’André Breton et portant notamment les signatures de Victor Margueritte, Charles Vildrac, Jean Guéhenno. Ils demandaient que Victor Serge, malade, puisse venir se faire soigner en France (comme n’importe quel dignitaire de la dictature algérienne peut le faire aujourd’hui dans nos hôpitaux du Service public). L’Humanité publia en 1933 un article condamnent Serge pour ses écrits, conformément aux directives de Moscou. Vaillant resta muet devant ce lâchage du PCF.
Victor Serge, un ami trahi
Serge écrit à ce propos : « Vaillant-Couturier signa le papier commandé à l’Humanité. À peu de jours de là, je le rencontrais à Moscou […] Nous étions amis depuis des années. Je repoussais la main qu’il me tendait. « Tu sais bien que tu viens de signer une infamie !». Sa grosse tête joufflue palissait et il bredouillait : « Viens ce soir, je t’expliquerais. J’ai reçu les renseignements officiels. Est-ce que je peux vérifier moi ? ». [.…]. Il eut plus volontiers risqué sa peau sur une barricade que sa carrière de tribun de cette façon-là. Or, il n’est que la première honte qui coûte »[2]. On dirait une déclaration d’Éric Coquerel ou de quelque autre commissaire politique de LFI devant le Parlement français un siècle plus tard.
Il n’est que la première honte qui coûte.
A lire aussi: Bayrou droit dans ses notes
Devant cette vilenie, comment ne pas penser à ces 28 parlementaires de L.F.I qui, le 6 mai 2025 ont voté contre une résolution du Parlement français demandant la libération de Boualem Sansal ? On ne peut certes pas demander à Mathilde Panot, à Louis Boyard, Manuel Bompard ou David Guiraud plus d’humanité que n’en avait eu l’extrême gauche un siècle auparavant à propos du sort d’un autre prisonnier… comment vous dites… Victor Serge ? Qui c’est ? … et Vaillant…. Vaillant comment… ? Quant aux députés communistes, leur témérité les a conduits à s’abstenir lors de ce vote demandant la libération de Boualem Sansal.
Ce n’était pas ici, hélas, la première honte.
Les justifications des députés LFI
La députée L.F.I de la Gironde Mathilde Feld a expliqué que ce vote courageux et empreint d’humanité de L.F.I contre le vœu de libération de l’écrivain algérien n’était en réalité qu’une « occasion pour la droite et l’extrême droite, etc… ». Elle rejoint les propos pleins d’humanité du député Bastien Lachaud, (futur « ministre végétarien » de la défense du futur président de la République Jean-Luc Mélenchon, parait-il…) qui dénonce en Boualem Sansal un individu « proche de l’extrême droite, xénophobe et islamophobe ». Traduire : « il a été invité à un salon du livre en Israël ». On ne peut pas demander à un aspirant futur ministre de la Défense du Lider maximo de lire les livres de l’écrivain que son parti veut maintenir en prison. Quelques jours après le vote des 28 contre la motion demandant la libération de l’écrivain algérien, Manon Aubry dans une diatribe à la saveur mélenchonienne pouvait déclarer sur Europe 1 : « Nous voulons la libération de Boualem Sansal »[3] !
Il n’y a que la première honte….
Quelle jubilation alors pour ces « 28 de la honte » que d’apprendre que le tribunal d’Oran lançait ce même jour un mandat d’arrêt international contre Kamel Daoud, qui, comme Boualem Sansal a le tort de déplaire à la dictature algérienne. On ne peut pas demander aux 28 de la honte de lire un Prix Goncourt, c’est déjà assez fatigant d’être député, si en plus il fallait lire des livres… !
Câlineries. Dans cet élan de léchage de bottes de la dictature algérienne, le 8 mai, la gauche déléguait des parlementaires à la cérémonie de commémoration en Algérie des répressions du 8 mai 1945. Cette visite était une façon d’honorer un pays qui venait d’expulser en avril 12 agents consulaires de l’ambassade d’Alger. Ces parlementaires de gauche ne voulaient sans doute pas laisser la prime de la honte au président de la République qui lui recevait à l’Élysée le « gentil jihadiste » Ahmad al-Chareh, président de la Syrie. La réception sous les ors de la république du « gentil jihadiste » fondateur et chef du groupe salafiste Al Nostra, rééquilibrait ainsi du côté de l’exécutif, la honte que les députés de La France Indigne avaient exhibé au Parlement français la veille en se désolidarisant de la demande de clémence à l’endroit de Boualem Sansal.
À lire aussi, Aurélien Marq : Mélenchon et la tentation théocratique
« Un boucher islamiste souille l’Élysée » déclarait Éric Ciotti devant le serrage de main du président français venu accueillir au bas des marches du perron de l’Élysée le responsable d’une organisation experte en formation d’auteurs d’attentats suicides, qui s’était réjouie des attentats du Bataclan et de l’Hyper Cacher.
Une gauche en déroute et en ignominie
Il devient de plus en plus difficile dans ce pays d’être de gauche pense le boomer nostalgique d’un autre temps. Si l’antisémitisme d’une extrême gauche auxquels les insoumis nous ont habitué ne laissait guère de doute sur son potentiel d’humanité, sa « bienveillance » pour la dictature algérienne marquait un progrès dans l’ignominie. Une ignominie qui culmine dans l’exfiltration par cette extrême gauche de députés, écrivains, intellectuels juifs qui se risquent à vouloir participer à des rassemblements… de gauche !
Les rictus de haine des cadres de LFI et de leur gourou admirateur de Robespierre couronnent magnifiquement ces parcours de la Honte.
Beaucoup de déçus devant cette dégringolade en indignité de la gauche française expriment leur désarroi aujourd’hui par la formulation suivante : « Je ne suis plus de gauche… parce que je suis de gauche ». Devant ces mots, je pense au roman de Victor Serge Les Derniers temps où l’auteur résume ainsi le sort fait aux victimes de la dérive stalinienne : à la question » êtes-vous communiste ? » son héros répond : « selon le manifeste de Karl Marx assurément, c’est précisément pourquoi j’ai été exclu du Parti Communiste ».[4]
[1] – Jean-Paul Loubes, Paul Vaillant-Couturier. Essai sur un écrivain qui s’est empêché de l’être, Ed.du Sextant, 2013.
[2] – Victor Serge, Mémoires d’un révolutionnaire. Seuil, 1957, p 218.
[3] – Europe 1, Émission Le Grand rendez-vous, le 11/05/25.
[4] – Victor Serge, Les derniers temps, Grasset, 1998, p 185