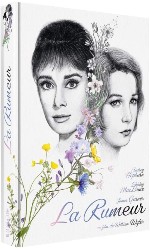Le 4 juillet 2020, à l’occasion du Jour de l’Indépendance, Donald Trump prononce un long discours face au mémorial du Mont Rushmore. Empreinte d’exceptionnalisme, son allocution met en avant la Destinée Manifeste, l’« histoire miraculeuse » des Etats-Unis. Le président américain condamne également les récents mouvements de dégradations des mémoriaux et statues dans le pays. La revue amie Conflits propose à ses lecteurs de lire l’intégralité du discours.
Ce long discours apparaît essentiel pour bien comprendre la pensée de Donald Trump, qui est également celle de bon nombre d’Américains.
Le premier élément qui ressort à la lecture de ce texte, c’est l’exceptionnalisme américain : « chacun d’entre vous vit dans le pays le plus magnifique de l’histoire du monde, et il sera bientôt plus grand que jamais. » Dans une leçon d’histoire passionnée, Trump raconte les vies des figures du Mont Rushmore : Georges Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et Theodore Roosevelt. Le président met en avant l’héritage fondamental de l’Indépendance : « 1776 a représenté le point culminant de milliers d’années de civilisation occidentale et le triomphe non seulement de l’esprit, mais aussi de la sagesse, de la philosophie et de la raison. »
Là où le discours prend toute sa profondeur, c’est dans l’actualisation de cet héritage. Donald Trump le déclare menacé par « un nouveau fascisme d’extrême gauche » qui utilise la méthode « totalitaire » de la « cancel culture ». En se positionnant devant le Mont Rushmore, le plus connu des mémoriaux du pays, le président américain adresse un message clair : il ne laissera pas l’histoire être bafouée, il entend bien fonder « la prochaine génération de patriotes américains ».
Revue Conflits
Le président : Merci beaucoup à vous ainsi qu’au gouverneur Noem, au secrétaire Bernhardt – que j’apprécie beaucoup – aux membres du Congrès, les invités de marque, et un bonjour très spécial au Dakota du Sud. (Applaudissements).
En ce début de week-end du 4 juillet, la Première Dame et moi-même souhaitons à chacun d’entre vous un très, très heureux Jour de l’Indépendance. Je vous remercie. (Applaudissements.)
Montrons notre reconnaissance à l’armée et à la garde nationale aérienne du Dakota du Sud, ainsi qu’à l’armée de l’air américaine, qui nous ont inspiré par cette magnifique démonstration de la puissance aérienne américaine et bien sûr, notre gratitude, comme toujours, aux légendaires et très talentueux Blue Angels. Merci beaucoup.
Envoyons également nos plus sincères remerciements à nos merveilleux vétérans, aux forces de l’ordre, ainsi qu’aux médecins, infirmières et scientifiques qui travaillent sans relâche pour tuer le virus. Ils travaillent dur. Je tiens à les remercier très, très sincèrement.
À lire aussi : Derrière les émeutes, une cible: l’Amérique de Trump
Nous sommes également reconnaissants à la délégation du Congrès de votre État : Sénateurs John Thune – John, merci beaucoup – Sénateur Mike Rounds – merci, Mike – et Dusty Johnson, membre du Congrès. Salut, Dusty. Merci, Dusty. Et tous les autres membres du Congrès qui sont avec nous ce soir, merci beaucoup d’être venus. Nous vous en sommes reconnaissants.
Il n’y a pas de meilleur endroit pour célébrer l’indépendance de l’Amérique que sous cette magnifique, incroyable, majestueuse montagne et monument aux plus grands Américains qui n’aient jamais vécu.
Aujourd’hui, nous rendons hommage à la vie exceptionnelle et à l’héritage extraordinaire de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et Teddy Roosevelt. Je suis ici en tant que votre président pour proclamer devant le pays et devant le monde : Ce monument ne sera jamais profané, ces héros ne seront jamais défigurés, leur héritage ne sera jamais, jamais détruit, leurs réalisations ne seront jamais oubliées, et le Mont Rushmore restera à jamais un hommage éternel à nos ancêtres et à notre liberté.
Public : USA ! USA ! USA !
Le président : Nous sommes réunis ce soir pour annoncer le jour le plus important de l’histoire des nations : le 4 juillet 1776. À ces mots, le cœur de chaque Américain devrait se gonfler de fierté. Chaque famille américaine devrait applaudir avec joie. Et chaque patriote américain devrait être rempli de joie, car chacun d’entre vous vit dans le pays le plus magnifique de l’histoire du monde, et il sera bientôt plus grand que jamais.
Nos fondateurs ont lancé non seulement une révolution dans le gouvernement, mais aussi une révolution dans la poursuite de la justice, de l’égalité, de la liberté et de la prospérité. Aucune nation n’a fait plus pour faire progresser la condition humaine que les États-Unis d’Amérique. Et aucun peuple n’a fait plus pour promouvoir le progrès humain que les citoyens de notre grande nation.
Tout cela a été rendu possible grâce au courage de 56 patriotes qui se sont réunis à Philadelphie il y a 244 ans et ont signé la Déclaration d’indépendance. Ils ont consacré une vérité divine qui a changé le monde à jamais lorsqu’ils ont dit « …tous les hommes sont créés égaux. »
À lire aussi : Donald Trump, le faiseur de miracle économique
Ces mots immortels ont mis en branle la marche imparable de la liberté. Nos fondateurs ont déclaré avec audace que nous sommes tous dotés des mêmes droits divins – qui nous ont été donnés par notre Créateur dans le ciel. Et ce que Dieu nous a donné, nous ne permettrons à personne de nous le retirer – jamais.
1776 a représenté le point culminant de milliers d’années de civilisation occidentale et le triomphe non seulement de l’esprit, mais aussi de la sagesse, de la philosophie et de la raison.
Et pourtant, alors que nous sommes réunis ici ce soir, il existe un danger croissant qui menace chaque bénédiction pour laquelle nos ancêtres se sont si durement battus, ont lutté, ont saigné pour s’en assurer.
Notre nation est le témoin d’une campagne impitoyable visant à effacer notre histoire, à diffamer nos héros, à effacer nos valeurs et à endoctriner nos enfants. (…)