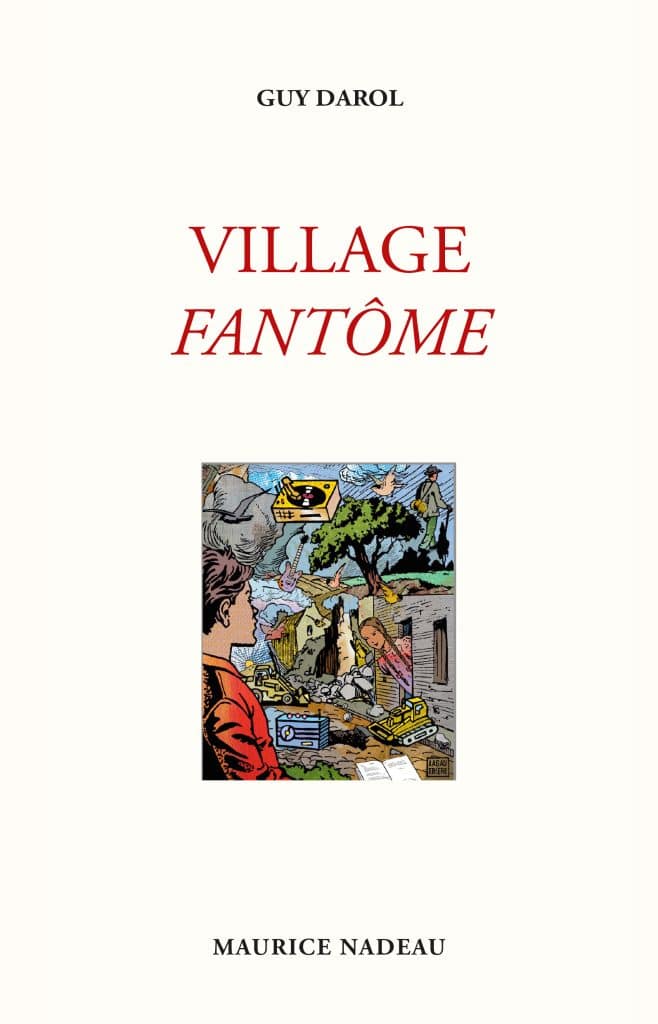Le pouvoir affaibli devient méchant. Plus il s’isole des Français et échoue à imposer son contrôle des réalités, plus il veut couper des langues. Il voit des « haineux » partout dans la populace. Le bon sens, qui assure que deux et deux font quatre, est vu comme un risque de déstabilisation d’un système qui a du mal à toucher terre.
La Macronie est dans « l’escalatoire ». Le chef de l’État, à qui l’on doit cet anglicisme à propos de la guerre mondiale qui vient, a aussi mobilisé ses concierges pour épier les médias mal-pensants, ce mot de la Novlangue. Vincent Bolloré, propriétaire notamment de CNews, est l’homme à museler. Les coupeurs de mots lui reprochent de polluer le récit officiel en accueillant des opinions indisciplinées, des journalistes parias. Dans Le Monde du 8 février, l’académicien et soutien du président, Erik Orsenna, a présenté l’acte d’accusation contre l’« homme à l’appétit insatiable ». Le procureur écrit : « Il met son pouvoir au service d’une parole de haine. […] Vincent Bolloré est dangereux pour la démocratie. » L’épurateur patelin l’affirme : « La liberté a reculé » sur CNews depuis son arrivée. Ce bobard labellisé par l’Élysée et sa cour fait partie de la duperie permanente des faussaires. En réalité, si des indésirables ont trouvé bon accueil sur la chaîne (j’en témoigne), ceux-ci y côtoient de solides contradicteurs. Mais ce pluralisme effraie les piliers de la pensée automatique, façon ChatGPT.
Les médias mis au service de l’idéologie diversitaire
Le Pouvoir affaibli devient méchant. Plus il s’isole des Français et échoue à imposer son contrôle des réalités, plus il veut couper des langues. Il voit des « haineux » partout dans la populace. Monsieur Thiers haïssait pareillement « la vile multitude ». Le bon sens, qui assure que deux et deux font quatre, est vu comme un risque de déstabilisation d’un système qui a du mal à toucher terre. Cette fois, c’est la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, qui a relancé l’offensive le 10 février, en menaçant CNews et C8 de ne plus retrouver leur autorisation de diffusion en 2025. En réalité, c’est à l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) que reviendra cette décision. Mais la ministre l’a avoué implicitement : cette instance « indépendante » est le gourdin de la politique, qui s’affranchit elle-même de son obligation de neutralité dans les médias. L’Arcom, gendarme de l’audiovisuel, sert la propagande d’État en assommant les déviants de ses amendes. Et c’est sur France Inter, radio de service public qui se calfeutre dans l’entre-soi « progressiste », que Rima Abdul Malak a accusé CNews de ne pas respecter le pluralisme et les débats contradictoires !
A lire aussi, Aurélien Marq: L’extrême-centre et le contrôle de la normalité
Ce n’est pas un hasard si Françoise Nyssen, ex-ministre de la Culture, a tout de suite fait connaître son soutien à Rima Abdul Malak et à ses menaces de censure. Elle-même, en mai 2018, avait donné comme mission aux télévisions et radios d’État de se mettre au service de l’idéologie diversitaire, en les sommant de devenir « un miroir de nos différences ». Elle avait jugé les « mâles blancs » trop nombreux à l’antenne, ce qui avait ouvert la voie à une mise à l’écart de figures médiatiques n’ayant pas la bonne couleur. Taxant certains Français de « hautement réactionnaires », l’ancienne éditrice avait aussi enjoint le service public de l’audiovisuel de « changer les mentalités sur le terrain ». Mais que diraient les donneurs de leçons d’un pays d’Europe, la Hongrie au hasard, qui mobiliserait ses médias publics à des fins de rééducation et menacerait de faire taire des télévisions d’opposition ? En réalité, la plupart des médias ont renoncé à s’alarmer des atteintes portées à la liberté d’expression sous les encouragements d’Emmanuel Macron. Une mentalité de garde-chiourme s’accroche à la caste des parvenus prolophobes. À peine élus en 2017, les députés LREM avaient, le 24 juillet, complété l’article 1 de la loi sur la moralisation de la vie politique en y ajoutant un amendement « antiraciste » inspiré de la Licra et destiné à accentuer l’arsenal contre les délits d’opinion. Cette disposition avait été heureusement supprimée par le Conseil constitutionnel, qui y avait vu « une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ».
Les promoteurs de la pensée propre rêvent d’une purification
La surveillance des pensées est l’obsession du pouvoir paranoïaque. Certes, le gouvernement a semble-t-il abandonné son idée d’instituer un « conseil de déontologie de la presse », qui l’aurait mise sous tutelle du politiquement correct. En revanche, la chasse aux « fake news » et aux « propos haineux », lancée par le législateur sans définition des incriminations, a élargi le périmètre des opinions délictueuses sur les trop libres réseaux sociaux. Dans cette œuvre de purification, les sycophantes se bousculent. C’est en se prévalant de la traque contre les déviances qu’un « collectif citoyen de lutte contre le financement du discours de haine », Sleeping Giants, incite depuis 2017 les annonceurs à retirer leurs publicités de supports jugés « nauséabonds » : CNews, Valeurs actuelles, Boulevard Voltaire sont parmi les cibles de ce Comité de salut public. Quand le site France Soir s’est vu retirer son agrément de presse, en riposte à ses critiques contre la politique anti-Covid, Libération a jugé la sanction « plus que légitime » contre ce « blog conspirationniste et covido-sceptique ».
À lire aussi : Sur France culture, Aurélien Bellanger mitraille Finkielkraut, Zemmour et Bruckner
Depuis, le tribunal administratif de Paris a rétabli, le 13 janvier, le titre dans ses droits. Mais RT France, chaîne russe employant 77 journalistes professionnels, n’a pas eu ce sursis : elle a dû définitivement fermer son antenne, pourtant ouverte à tous, après la décision du Trésor de geler ses comptes bancaires. Sud Radio et Causeur font également partie de ces empêcheurs de tourner en rond que les promoteurs de la « pensée propre » aimeraient faire taire.
Et tout ceci se passe en France, dans la révoltante indifférence des prétendus défenseurs de la démocratie. La droite, plus timorée que jamais, se fait attendre pour protester contre les atteintes du pouvoir à la libre parole. Faut-il ici rappeler l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ». Marche après marche, une macrocrature s’installe, protégée par l’esprit d’escalier des vigies somnolentes. Urgent de balayer tout çà !