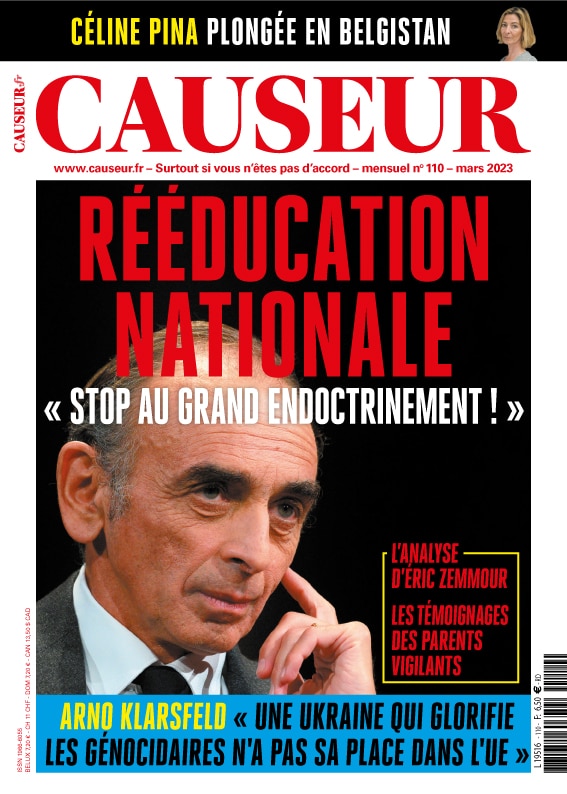Au-delà de la légende de la femme aux amours tumultueuses, de la star de son temps, Colette, dont on fête le 150e anniversaire de la naissance, est d’abord un écrivain de premier ordre. Un tirage spécial de la Pléiade nous le rappelle.
« Colette, c’est de l’eau de bidet ! » Ce jugement d’une grande élégance n’est pas celui d’un des contemporains de Colette, d’un de ces hommes incarnant dans la République des Lettres toute l’horreur de la domination masculine face au succès public de cette femme. Non, on le doit à Marguerite Duras. Comme quoi, on n’est jamais aussi bien haï que par ses pair(e)s. Duras, c’est l’écrivain préféré des professeurs de français, des intellectuels pour qui la littérature est une chose tellement sérieuse qu’elle se doit de refuser au lecteur la jouissance pure, innocente, de l’oubli de soi. Duras, c’est l’écrivain qui instaure une distance permanente et demande sans cesse à être commenté, analysé, célébré. Duras, c’est l’écrivain qui se regarde écrire de manière si ostentatoire qu’elle en devient presque trop facile à pasticher. On se souvient de Patrick Rambaud et de son hilarant Virginie Q. par Marguerite Duraille.
Pasticher Colette, en revanche, c’est beaucoup plus difficile. En 1925, deux ans après la parution du Blé en herbe, alors qu’elle est au faîte de sa gloire, Paul Reboux, pasticheur célèbre à l’époque, préfère, plutôt que s’y risquer, publier la première étude de fond sur son œuvre, Colette ou le Génie du style, lui donnant une légitimité littéraire très précoce, car Colette aborde à peine la seconde partie de son œuvre, celle qu’elle publie enfin sous son nom.
Subversion naturelle
Bref, Duras, c’est l’anti-Colette et ce mépris de Duras est une bonne manière de comprendre, en négatif, pourquoi Colette est une figure majeure de la littérature française de la première moitié du vingtième siècle. Colette, c’est un style qui ne se donne jamais comme style, un style dont le naturel est incroyablement travaillé, mais dont le travail ne se voit jamais, ce qui pourrait être une assez bonne définition du classicisme à la française. Colette est une classique, et une classique réellement subversive, comme tous les classiques. On entend par subversion cette manière de changer notre façon de percevoir, de nous proposer d’autres angles de vision sur un paysage que l’on croyait connu.
A lire aussi, du même auteur: Maigret et Zazie pour la réforme des retraites
La « subversion Colette », c’est une manière inédite d’approcher la réalité par la sensualité, par le plaisir qu’elle est prête à nous donner pour peu qu’on fasse tomber de nos yeux des écailles qui doivent autant à la morale qu’au manque d’imagination. La « subversion Colette », c’est agir en primitif, c’est-à-dire retrouver l’innocence animale de l’enfance : « Mon enfance, ma libre et solitaire adolescence toutes deux préservées du souci de m’exprimer furent toutes deux occupées uniquement de diriger leurs subtiles antennes vers ce qui se contemple, s’écoute, se palpe et se respire. »
Colette passe le bac
Alors qu’on célèbre cette année le 150e anniversaire de sa naissance, Colette va connaître la consécration des classiques qui sont aussi, par définition, ceux qu’on étudie en classe. Pour les épreuves du bac de Français, les lycéens de 2023 ne plancheront pas, exceptionnellement, sur un ouvrage de Duras mais sur Sido, le livre que Colette a consacré à sa mère, qu’on retrouve dans le tirage spécial que la Pléiade sort pour cet anniversaire.
Cette lecture permettra à nos chères têtes blondes de se confronter à des réalités bien concrètes, à une époque où le dédoublement numérique de tout ce qui existe en a fini avec la réalité, où les saisons deviennent des mots sans consistance, de simples périodisations d’une nature occultée, déréglée : « Elle obtint, du vent d’été qu’enfante l’approche du soleil, sa primeur en parfums d’acacia et de fumée de bois ; elle répondit avant tout au grattement de pied et au hennissement à mi-voix d’un cheval, dans l’écurie voisine ; de l’ongle, elle fendit sur le seau du puits le premier disque de glace éphémère où elle fut seule à se mirer, un matin d’automne. »

Fond, ombre, mouvement, éclat, couleur, tout est là : un bouleversant retour d’une enfance bourguignonne, dans les années 1880. Répétons-le, Colette a eu beau vouloir être, selon ses propres mots, « apolitique », il n’y a pas plus révolutionnaire comme projet que de rendre à nouveau visible, par la magie du verbe, la figure du monde à ceux qui l’habitent mais qui l’ont perdue en route.
Outre Sido, Antoine Compagnon, maître d’œuvre de cette édition, a choisi dix titres. Dans sa remarquable préface, il est bien conscient que ce choix, effectué parmi les quatre volumes de l’édition des Œuvres complètes, a été difficile : « On aurait aimé en retenir beaucoup plus, en particulier parmi ses articles, car Colette inventa un nouveau style de journalisme, Dans la foule, comme elle intitula l’un de ses recueils en 1918, pour dire le reportage vu du bas, du point de vue des spectateurs et non des acteurs dans les salons ministériels où elle s’ennuyait. »
À lire aussi : “Colette”, le film parfait que les Français n’ont pas su faire
Qu’importe, pour l’amateur de Colette comme pour celui qui s’apprêterait à la découvrir à cette occasion, cette anthologie a le mérite de couvrir une vie d’écriture dont la palette est bien plus large qu’il n’y paraît, qui va de Claudine à l’école, son premier roman paru en 1900 à L’Étoile Vesper, une chronique autobiographique de 1947. On connaît peu L’Étoile Vesper, c’est dommage. Ce livre n’a rien de crépusculaire malgré son titre. Colette est au soir de sa vie, elle le sait, elle n’en fait pas un drame. Il lui reste une bonne demi-douzaine d’années à vivre avant de mourir en 1954 et d’être la première femme à bénéficier de funérailles nationales.
L’excommunication ou le Panthéon
La République est bonne fille, plus que l’Église qui ne veut pas d’obsèques religieuses à cause des seins nus, de la célébration du saphisme, du travestissement, des maris à répétition, des liaisons « cougar » avec les beaux-fils des maris. Peut-être faudrait-il d’ailleurs fouiller un peu les vraies raisons de ce refus de l’Église catholique qui en a connu pourtant d’autres, en matière d’écrivains scandaleux, et dans son propre giron : Léon Bloy qui voulait mitrailler les riches et se réjouissait de l’incendie du Bazar de la Charité ou Baudelaire et ses versets sataniques pour n’en citer que deux.
Avançons une hypothèse : Colette n’est certes pas religieuse, mais elle n’est pas non plus spécialement anticléricale comme cela pouvait être la mode à son époque. Simplement, c’est une païenne, une vraie : elle célèbre le vivant partout où elle le voit, c’est une panthéiste comme l’a été son contemporain Giono. Ces deux-là se connaissaient et s’appréciaient : « La source de Jean Giono est peut-être la plus réelle de toutes. », écrit-elle joliment à son propos alors qu’il est présent à son 72e anniversaire.
Dans L’Étoile Vesper, comme dans tant d’autres de ses livres, elle entrelace en toute liberté, dans une radieuse désinvolture, le passé, le présent, l’avenir, la Belle Époque, les Années folles, deux guerres mondiales, une occupation étrangère, l’étonnement d’avoir traversé tout cela et d’être encore là. On trouve une réflexion sur l’âge, aussi, puisqu’elle est, dans ces années d’après-guerre, pratiquement immobilisée par l’arthrose qui s’est déclenchée depuis la fin des années 1930 et qui la handicape de plus en plus : « Une infirmité se fait affligeante pendant sa première année. Que le mal nous façonne, il faut bien l’accepter. Le mieux est de façonner le mal à notre usage, et même à notre commodité. » On dirait du Montaigne, et Colette toute sa vie, dans son refus du dogmatisme, sa méfiance pour les idées générales, sa volonté d’appuyer sa connaissance du monde sur une expérience sensible, tout comme son art de la digression, sa manière de ne jamais se renier tout en se corrigeant en permanence, n’est pas sans rappeler l’auteur des Essais. On trouve aussi, dans L’Étoile Vesper, des réflexions sur l’art d’écrire qui sont tout sauf de la théorisation parce que Colette a toujours préféré l’instinct, tout ce qui la rapproche du règne animal, tout ce qui la renvoie à une nature vivante, soyeuse comme la fourrure des chats qui ont été la passion de sa vie.
On lit d’ailleurs, dans cette édition de la Pléiade, La Chatte, ce roman de 1933, trésor subtil et vénéneux de psychologie : un jeune couple dont le mari entretient depuis toujours une relation presque amoureuse avec une chatte, finit par se séparer tant la jalousie de l’épouse prend des proportions étouffantes. On retrouve aussi les Dialogues de bêtes, où dans une tradition qui va du Roman de Renart à La Fontaine, Colette fait du règne animal un moyen de voir l’humanité de manière différente, de la remettre à sa place, qui n’est pas forcément la meilleure.
« N’importe, je me serai bien amusée en chemin », écrit-elle aussi dans L’Étoile Vesper. Et c’est vrai qu’elle s’est amusée. Cela n’a pas contribué pour rien à sa légende qui parfois occulte son œuvre. C’était une star, au sens moderne. Elle a tout fait, du journalisme, du théâtre, de la danse, elle a même, dans une période de vaches maigres, lancé un institut de beauté et une ligne de maquillage.
La théorie du genre avant l’heure
Aujourd’hui, on pourrait vouloir, de manière plus subtile, la récupérer en montrant sa « modernité ». Dans la réédition d’un Cahier de l’Herne datant de 2011, on en fait ainsi une annonciatrice des gender studies. Quand on lit dans Le Pur et l’Impur, une manière d’essai sur la sexualité, « Qu’il me déplaît de palper froidement une création aussi fragile, et de tout menacée : un couple amoureux de femmes », il est évident qu’elle met en question l’ordre sexuel de son temps.
À lire aussi : Colette, le vrai génie lesbien
Mais elle n’en tire aucune conclusion politique et elle n’est pas du genre à systématiser la chose avec un acronyme interminable du genre LGBTQUIA+. La taxinomie des sexualités, très peu pour elle, parce que cela figerait de manière artificielle, anti-érotique au possible, des comportements vécus dans une forme d’innocence première. Innocence merveilleuse des amours adolescentes et balnéaires du Blé en herbe, par exemple, ce roman qui sent l’algue, le sel et les peaux bronzées. Quand elle détruit les stéréotypes de genre, dirait-on aujourd’hui, elle le fait en s’amusant. Dans Chéri, où une ancienne danseuse fait l’éducation sexuelle d’un jeune homme avec la complicité de sa mère, elle invente la figure du « ravissant idiot » plutôt que celle, trop convenue, de la « ravissante idiote ».
Oui, les hommes l’amusent, même ceux qui se sont amusés d’elle comme Willy qui a été à la fois son vieux mari, son mentor, son accoucheur et son voleur. Il a signé à sa place, on le sait, la série des Claudine. Après tout, l’histoire s’est bien terminée. Willy avait la tolérance des paresseux et des libertins, il a laissé l’adolescente s’émanciper. De nos jours, on parlerait pourtant d’emprise, on les comparerait au Humbert Humbert de Nabokov et à sa Lolita. Et il est vrai qu’il y a déjà dans sa Claudine une annonce de ce que sera Lolita et sa perversité candide.
Mais Willy n’a pas détruit Colette. Il en a fait, sans doute un peu malgré lui, un de nos plus grands écrivains. C’est l’hommage du vice à la vertu. Encore que pour savoir qui est le vice et qui est la vertu dans cette histoire, c’est compliqué.
Sans doute parce que pour Colette, et c’est ce qui fait d’elle une très grande, le vice et la vertu, ça n’existe pas.
À lire :
Colette, Le Blé en herbe et autres écrits (préf. Antoine Compagnon), « La Pléiade », Gallimard, 2023.
On signale également le très beau livre d’Emmanuelle Lambert, Sidonie Gabrielle Colette (Gallimard, 2023), un essai biographique avec comme fil conducteur les nombreuses photographies de Colette réalisée par les plus grands photographes, de Beaton à Cartier-Bresson, en passant par Doisneau et Gisèle Freund.