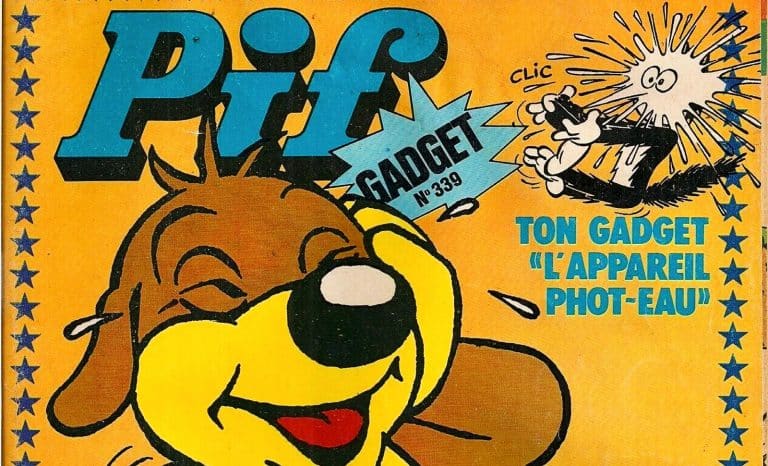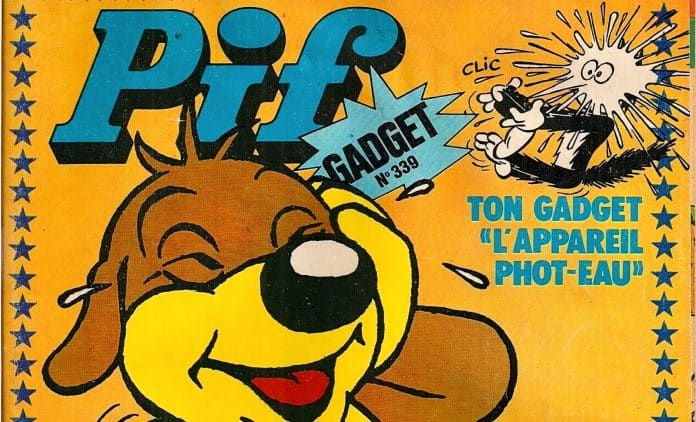Au cœur de la crise politique que nous traversons, un sentiment profond: à tort ou à raison, les citoyens français pensent que la démocratie véritable leur a été confisquée avec le 49-3. Analyses.
La constitution de la Vème République fut adoptée par référendum, sur les décombres de la IVème dont l’instabilité gouvernementale (24 gouvernements en 12 ans) avait décrédibilisé son régime et précipité sa disgrâce face à son incapacité à trouver une issue à la guerre d’Algérie.
Modèle singulier de rationalisation du parlementarisme, la Constitution du 4 octobre 1958 restaure le pouvoir exécutif au moyen d’une promotion fonctionnelle du chef de d’Etat qui, placé au sommet de l’édifice institutionnel, est dotée d’une légitimité nouvelle et investi de prérogatives personnelles. L’instabilité gouvernementale est jugulée en raison des règles strictes qui limitent les possibilités de mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement. La délimitation du domaine de loi (art. 34) et les procédures législatives qui limitent les marges de manœuvre du parlement (Assemblée nationale et Sénat), viennent affaiblir la fonction législative. Ces caractères généraux seraient à l’origine de l’actuelle crise politique, et d’aucuns appellent à un « changement de régime ». Rien ne serait plus désastreux ! En revanche, l’évolution du régime n’est pas exempt de critique.
A lire aussi, Gabriel Robin: Retraites: la France peut-elle encore se payer le luxe de ce faux débat?
Abandon du septennat: une erreur
L’adoption du quinquennat en 2000 a précipité le régime sur sa pente actuelle. Pourquoi ? Dans les régimes parlementaires le pouvoir exécutif est toujours bicéphale. Le président ne peut donc, sans créer de confusion, et sans abaisser sa fonction, être un « super Premier ministre » en reléguant ce dernier au rang des collaborateurs. Le président devient alors le chef de la majorité et n’est plus le garant de l’unité nationale et de la continuité de l’Etat, qui donne les « impulsions fondamentales » et les « directions essentielles » (Pompidou, conf. de presse 10 juillet 1969). Son action n’est plus circonscrite au « domaine réservé » qui donne de la hauteur nécessaire à une vision à long terme. Le quinquennat, voulu par Lionel Jospin alors Premier ministre, et auquel le président Chirac s’est résolu, était perçu comme un progrès démocratique permettant en outre d’éviter les cohabitations. Mais, en descendant dans l’arène politique, le président a perdu de son éloignement et, ce faisant, comme le prévenait le Général de Gaulle, de son prestige et de son autorité (“L’autorité ne va pas sans prestige, ni le prestige sans l’éloignement”). Le président abîme la fonction en sacrifiant, par exemple, la filière nucléaire sur l’autel des accords électoraux ! Ainsi le quinquennat conjugué au « fait majoritaire » voulu pour immuniser le régime contre le « multipartisme anarchique » accroit la présidentialisation du régime. En charge de tout, le président est devenu un paratonnerre que ne préserve pas le Premier ministre simple fusible ! La majorité relative à l’Assemblée nationale crée donc la condition d’une crise politique que vient précipiter l’usage de l’article 49 alinéa 3 (49.3).
Une crise de légitimité
Les crises politiques se cristallisent et se dissolvent autour d’une question de légitimité plus que de légalité. Les idéaux-types de Max Weber (les trois types purs de la domination légitime) offrent une grille de lecture toujours opérationnelle. Le modèle rationnel-légal fonde la légitimité sur le respect de la loi et des procédures de dévolution, d’organisation et d’exercice du pouvoir fixées par les règles objectives. Le modèle traditionnel repose sur le caractère obligatoire de la coutume qui opère une continuité séculaire dont relève la monarchie héréditaire. Le modèle charismatique fait référence à l’autorité personnelle du chef que lui octroient des circonstances historiques particulières, dont était par exemple investi « l’homme du 18 juin ». L’épisode du 49.3 montre que la légitimité rationnelle légale n’est pas une étape ultime de l’évolution, mais se trouve en concurrence avec d’autres formes de légitimité. Celle du président de la République réside dans son élection au suffrage universel direct. On entend que le président Macron a été élu par défaut, sans considération pour son programme dans lequel figurait le report de l’âge légal de départ à la retraite, mais pour faire barrage à la candidate du Rassemblement national. Dans ce contexte, la procédure électorale ne suffirait pas à conférer une légitimité pleine et entière. Il manquerait la composante charismatique que seuls les rendez-vous avec l’histoire sont susceptibles de conférer ou que l’équation personnelle est de nature à générer. L’article 49.3 permet de résoudre, dans la légalité constitutionnelle, un conflit de légitimité, opposant la volonté présidentielle exprimée par le gouvernement, à celle de l’Assemblée nationale. Dans le contexte de légitimité évanescente de part et d’autre, l’engagement de la responsabilité du gouvernement sur le vote du texte en cause n’était certainement pas le mode le plus approprié, et fait courir le risque d’un affaiblissement du parlementarisme rationnalisé.
A lire aussi, Elisabeth Lévy: Pour le «Times» de Londres, Marine Le Pen pourrait être la prochaine présidente
Où est passé le référendum ?
Le texte qui cristallise les passions aurait sans doute dû être présenté d’une autre façon en étant par exemple discuté dans le cadre d’une grande loi sur les conditions de travail en réservant la possibilité d’un référendum. L’enjeu n’aurait donc pas uniquement été celui de l’âge légal de départ à la retraite. Faut-il rappeler que l’article 3 de la Constitution énonce que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum… Cette disposition appelle 2 remarques :
En premier lieu le référendum focalise la suspicion des élites à l’endroit des « gaulois réfractaires » dont il conviendrait de forcer le destin (sur la nature des contestations de la classe moyenne, voir Christophe Guilluy, Les dépossédés, Flammarion, 2022). Prévu par les l’articles 11 et 89 de la Constitution, le référendum verserait dans le césarisme démocratique, détournerait l’objet de la question posée en raison de sa dérive plébiscitaire. Il n’en demeure pas moins un outil de démocratie directe, ou semi-directe puisque le peuple n’en a pas l’initiative qui, au-delà des formes légales, permet de charger la décision référendaire d’un surcroit de légitimité politique. En effet, qui oserait contester utilement l’élection du président de la République au suffrage universel direct au motif que ce mode d’élection résulte de la révision constitutionnelle adoptée par le référendum (législatif) de l’article 11 au lieu de celui prévu à l’article 89 consacré à la révision ? Le choix de l’article 11 visait à éviter la censure du Sénat opposé au projet. La légitimité conférée par le suffrage universel direct octroie une immunité à la loi du 6 novembre 1962 dont la contestation formelle est de nul effet. L’innocuité de la charge montre que, même dans un Etat de droit, la légitimité politique l’emporte sur la légitimité juridique.
A lire aussi, Jérôme Leroy: Elisabeth Borne ou les dangers de se mentir à soi-même
Reste en second lieu la question du Référendum d’Initiative Partagée (RIP) prévu par l’article 11 issu de la révision constitutionnelle de 2008. Il peut être organisé à l’initiative d’1/5ème des parlementaires. C’est chose faite puisque 252 parlementaires ont, le 20 mars 2023, saisi le Conseil constitutionnel d’une proposition de loi interdisant de fixer au-delà de 62 ans l’âge de liquidation des droits à la retraite. Le Conseil est donc saisi de cette question en même temps qu’il doit opérer le contrôle de constitutionnalité de la loi reculant l’âge de départ à la retraite. Problème, le RIP ne peut abroger une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. Cependant, le Conseil devrait préalablement vider la question du RIP avant de statuer sur la constitutionnalité de la loi litigieuse, de sorte que cette dernière ne devrait pas être promulguée (c’est-à-dire signée par le président de la République en vertu d’une compétence liée) avant une éventuelle validation du RIP par le Conseil. Dans cette hypothèse, le RIP pourra être soutenu par 1/10ème du corps électoral (soit + de 4 800 000 électeurs inscrits), seuil réputé infranchissable, sauf peut-être pour cette proposition de loi référendaire en raison du niveau d’impopularité de la réforme. S’ouvre alors la dernière phase : si la proposition de loi franchit le seuil, et que le parlement ne l’adopte pas, elle devra être soumise à référendum (voir Jean-Eric Schoettl et Jean-Pierre Camby, Retraites : « Pourquoi le RIP a des chances d’aboutir », Le Figaro 29 mars 2023). L’Assemblée nationale pourrait alors être tentée de ne pas adopter le texte afin de provoquer le référendum et lancer une défiance au président.
L’opération est à haut risque pour ce dernier qui serait contraint de se soumettre ou de se démettre…
Les dépossédés: L'instinct de survie des classes populaires
Price: 19,00 €
20 used & new available from 2,25 €