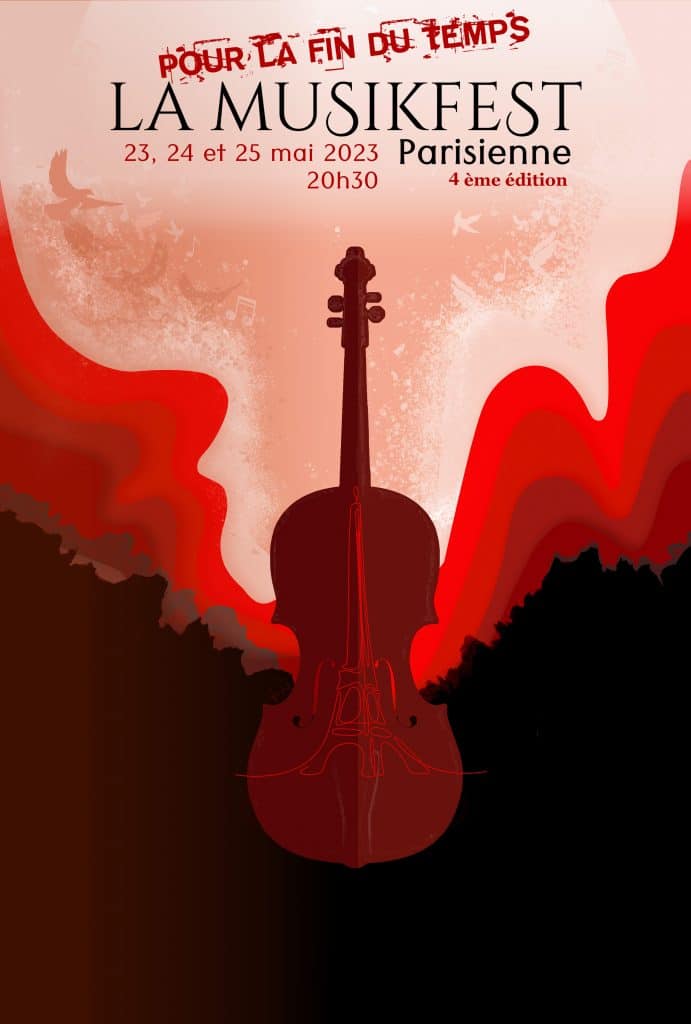Notre chroniqueur, anticipant sans doute les futures échéances électorales, semble enthousiasmé par Marine. Mais de qui parle-t-il exactement?
Je vais voter Marine.
Pensez. Elle est décidée à juguler l’inflation de milliardaires en France — tous des vampires. Domiciliés en Belgique de surcroît. L’anti-France. Moi, homme de peu, je me reconnais dans ce désir de tirer un trait sur Bernard Arnault et ses semblables. Haro sur le capitalisme mondialisé ! Avec moins de riches, les pauvres le seront moins. Mandeville, qui racontait dans La Fable des abeilles (1714 — un petit essai fondamental) que le vice, l’excès, le luxe, génèrent le bonheur des pauvres se fichait de nous. Les milliardaires au pain sec !
Je vais forcément voter Marine.
J’ai la fibre écolo, moi. Je me souviens de Tchernobyl. Et comme Marine, j’ai pensé que la catastrophe de Fukushima — 20 000 morts bien utiles à la cause — était l’argument sans réplique qui ferait passer les nucléo-enthousiastes dans le camp des nucléo-sceptiques. Encore deux ou trois événements du même type, quelques dizaines de milliers de morts de plus, et nous pourrons, comme les Allemands, rouvrir les centrales à charbon. Fukushima, j’adore !
A lire aussi, Philippe Bilger: Marine Tondelier : on ne doit pas dire ça !
Je vais certainement voter Marine.
Elle envisage de juguler la presse et les médias mal pensants. Une idée que seuls jusqu’ici Staline, Hitler, Xi Jinping et Edouard Louis avaient eue. Imaginez un monde sans Libé, sans Le Monde, sans France-Inter ni Médiapart… Enthousiasme ! Bénédiction ! Extase !
Heu… Celle qui relit par-dessus mon épaule me signale que Marine a plutôt envisagé de couper le robinet à subventions de Valeurs actuelles — qui d’ailleurs n’en reçoit pas. Et revenir sur l’autorisation de diffuser de CNews. Me serais-je trompé ?
C’est que, m’explique-t-elle avec patience, ce n’est pas Marine Le Pen qui a émis toutes ces belles idées. C’est Marine Tondelier, l’éminence d’EELV.
Fatalitas ! comme disait Chéri-Bibi. Pour une fois que je trouvais une femme politique selon mon goût !
PS. Ça doit sérieusement la faire marronner, la Tondelier, de porter le même prénom que la présidente du Rassemblement national. D’autant que MLP étant arrivée bien avant elle, lorsque les médias disent « Marine », c’est forcément d’elle qu’il s’agit, ce qui refoule Tondelier dans les bas-fonds des classements. Je serais elle, j’en changerais, je me ferais rebaptiser Camille ou Claude, de façon à faire un clin d’œil aux transgenres : quand on est un petit parti, il ne faut négliger aucun sous-groupe.
PPS. Marine Tondelier a bien suggéré d’éliminer les milliardaires français. Elle s’est bien réjouie de Fukushima. Et elle a sérieusement envisagé d’interdire de fait les médias qui la défrisent. Une personnalité toute en exquises délicatesses.