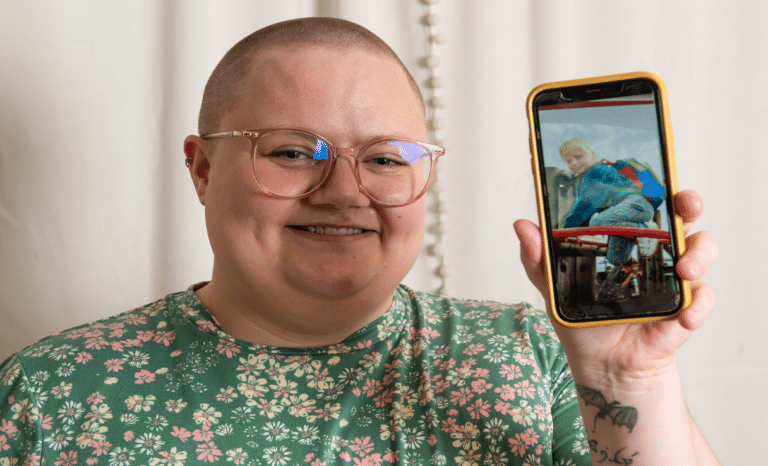Des traitements hormonaux sont prescrits pour les jeunes convaincus d’être nés « dans le mauvais corps » sans considération sérieuse des bénéfices/risques et de la proportionnalité des soins. Résultat: leur corps est pathologisé pour le reste de leur vie. Ceux qui tentent de tirer la sonnette d’alarme sur les dangers de ce phénomène rencontrent une résistance acharnée de la part des transactivistes. Ces lanceurs d’alerte attendent la publication d’un rapport de la Haute Autorité de Santé qu’ils espèrent impartial.
La « dysphorie de genre » chez les enfants et adolescents fait couler beaucoup d’encre. Et il y a de quoi ! Très rares il y a encore quelques années, les demandes de transition ont littéralement explosé chez les mineurs : +5000% en vingt ans, selon certains observateurs. Il s’agit d’une véritable épidémie qui affecte enfants et adolescents, garçons et désormais majoritairement filles. Ces troubles sont les probables témoins du malaise croissant d’une jeunesse coincée entre des injonctions paradoxales, accablée par un environnement anxiogène, exposée aux violences et à la pornographie, déstabilisée par les confinements successifs, sursollicitée par les réseaux sociaux, abandonnée aux influenceurs et aux faux amis, privée d’accès à des soins psychothérapeutiques dignes de ce nom. L’emprise des réseaux sociaux dans les identifications trans explique sans doute en partie l’accroissement exponentiel de ces demandes par un effet de « contagion sociale ».
Devant un tel tableau, les réactions sont variées. Certains interprètent ces phénomènes comme une « libération de la parole » d’enfants « nés dans le mauvais corps ». Ils veulent déconstruire la binarité de la condition humaine et abolir l’assignation sexuelle au profit de la fluidité du genre. Ils font confiance à « l’autoidentification », un processus qui dépend uniquement du jugement de l’individu qui veut changer de genre. Ils appellent à organiser les demandes de transition, socialement et médicalement, avec une prise en charge psychologique réduite à un coaching de transition. Persuadés d’incarner la tolérance et le progrès, ils se nomment eux-mêmes « Transaffirmatifs ». D’autres contestent la naïveté de cette vision dualiste corps-esprit. Ils pensent que le déni de l’existence de deux sexes dans l’espèce humaine relève plus de la toute-puissance de la pensée que de la rationalité scientifique. Ils interrogent les nouveaux stéréotypes et enfermements sociaux sur lesquels débouche cette prétendue libération vis-à-vis du destin biologique. Soulignant la mobilité des identifications de genre dans l’enfant et l’adolescence, ils critiquent les prises en charge somatiques, axées sur les corps et non sur les esprits. Devant un malaise adolescent temporaire, ils ne veulent pas risquer des effets corporels définitifs. Ils se considèrent comme « Prudents ». Mais leurs détracteurs ne tarissent pas d’insultes à leur égard : « réacs », « fachos », « transphobes »… Devant un tel déluge de noms d’oiseaux, on ne sait où donner de la tête ! Essayons de la garder froide pour y voir un peu plus clair dans ce sujet difficile, qui est en train de devenir un véritable problème de santé publique.
Qu’il s’adresse à des enfants, des adolescents ou des adultes, le traitement « transaffirmatif » vise à valider le « ressenti » du patient qui souhaite changer de genre. Pour les enfants, le « Dutch protocol » (« protocole hollandais » en référence au pays où il a été mis au point) repose d’abord sur la prescription d’hormones : chez les 10-15 ans, des bloqueurs de puberté (des analogues de la LHRH) pour permettre une « pause » et éviter « l’agonie de la puberté » ; à partir de 15-16 ans, des hormones sexuelles « croisées » : testostérone pour une transition FtM (female to male), antiandrogène plus œstrogène pour une transition MtF (male to female). Dans notre pays la chirurgie de réassignation sexuelle est réservée aux adultes. À titre exceptionnel, des mastectomies peuvent cependant être pratiquées chez des jeunes filles mineures.
Préconisée par l’autre parti (les Prudents), la psychothérapie cherche à expliciter le malaise du patient, à le situer dans sa dimension familiale, à traiter des co-mordibités sous-jacentes qui sont très fréquentes (jusqu’à 80% des jeunes) : troubles anxio-dépressifs, autisme et troubles du spectre autistique, schizophrénie, troubles obsessionnels compulsifs, anorexie, antécédents d’exposition à des violences physiques, morales et sexuelles, harcèlement… Elle vise une certaine réconciliation avec soi-même sans préjuger du genre que le jeune investira, tout en respectant le développement normal d’un être en devenir. Il n’y a donc aucune comparaison avec les funestes « thérapies de conversion » qui ont pu être imposées à certains homosexuels dans le but de « normaliser » leur orientation sexuelle.
Comment choisir entre ces deux approches ? La question ici n’est pas de s’opposer tout de go à un traitement et de se confier entièrement à l’autre, mais de peser avec soin le pour et le contre de chacun, en respectant deux principes : 1) apprécier le rapport bénéfice/risque, 2) évaluer la proportionnalité des soins. En matière de prescription thérapeutique (médicaments, interventions chirurgicales, psychothérapies, etc.), tout est une question « d’indication » : la raison pour laquelle on recommande telle ou telle technique. Par exemple, la mastectomie est l’ablation chirurgicale du sein. La technique est à peu près la même pour un sein cancéreux ou un sein normal chez une jeune fille s’identifiant comme garçon… Mais l’indication fait toute la différence : amputer un organe malade ou un organe sain, ce n’est pas la même chose ! Dans un cas, la mutilation, quoique regrettable, est nécessaire pour sauver la vie ; dans l’autre, elle apparaît comme au minimum disproportionnée par rapport au bénéfice attendu. Il faut donc juger le geste technique dans sa globalité, en rapportant les risques et séquelles du traitement aux risques et séquelles de la maladie sous-jacente. Comparer l’évolution (le devenir) avec et sans traitement, telle est la base de l’indication proportionnée du traitement en fonction de la maladie. Dans les cas où il n’y a pas de maladie objectivée, l’exigence d’innocuité du traitement est très grande. C’est ce qui se passe avec la chirurgie esthétique : s’adressant à des patients qui ne sont pas malades mais simplement insatisfaits de leur apparence corporelle, elle suppose non seulement une obligation de moyens mais aussi de résultats. Elle s’interdit de faire courir des risques – même si le patient, trop optimiste ou trop insouciant, le demande expressément. À l’opposé, il y a la cancérologie : face à des affections très graves, on y tolère des traitements aux nombreux effets secondaires. Ce n’est pas que le corps médical soit heureux d’imposer ces dangers et désagréments aux malades – il y a d’ailleurs une tendance en cancérologie à la « désescalade » pour s’adapter au mieux à la réalité des situations individuelles. Simplement, les risques thérapeutiques encourus paraissent proportionnés à la gravité de la maladie à traiter.
À noter qu’il ne suffit pas que le patient soit « demandeur » d’une thérapeutique pour que celle-ci soit effectivement indiquée. Même pour des adultes, il n’est pas facile d’évaluer pour soi-même le rapport bénéfice/risque. D’une part les connaissances scientifiques font défaut à la plupart des patients ; d’autre part, obnubilés par leurs problèmes présents, beaucoup négligent les évolutions à venir. Même correctement informés des bénéfices et risques des traitements, les patients ont souvent du mal à arbitrer entre bénéfices immédiats et risques futurs. Cette difficulté est encore plus grande s’agissant d’enfants, êtres en devenir à qui on ne peut pas reprocher de ne pas se projeter dans un destin d’adulte. « L’être adulte » est essentiellement différent de « l’être enfant », qui en est réduit à imaginer « ce que c’est d’être grand ». La vie sexuelle adulte en particulier, reste un mystère pour les enfants – et c’est heureux. Comment donc pourraient-ils engager en toute conscience des modifications irréversibles de leurs organes sexuels immatures ? Et ce, avant même d’avoir pu expérimenter les possibilités offertes par ces organes pleinement développés ?
Il faut ici décrire crûment la réalité : la prescription d’hormones dans un but de transition de genre expose à de nombreux risques et effets secondaires.
Pour les bloqueurs de puberté : perte de densité osseuse (ostéoporose), prise de poids, et bien sûr atrophie des organes génitaux restés au stade enfantin – ce qui est l’effet recherché, mais qui n’en est pas moins une mutilation aboutissant à un dysfonctionnement génital pouvant être définitif. Du fait du rôle des hormones sexuelles dans la maturation cérébrale, un risque cognitif est fortement suspecté. Le retentissement psychologique constitue aussi une importante prise de risque. Car il s’agit de priver un être humain d’une des phases les plus importantes de son évolution psychique : l’adolescence, phase de transformations et de maturation qui se produit sous l’impulsion du phénomène physiologique pubertaire. Enfin, il y a des effets sociaux : bloqué dans son développement physique et psychologique, le jeune se met peu à peu en décalage avec ses pairs, ce qui aggrave encore sa vulnérabilité. Alors qu’elle était censée être réversible à tout moment, la pause devient de fait une « voie à sens unique ». En témoignent les chiffres élevés de prescription d’hormones sexuelles croisées qui font suite aux bloqueurs de puberté (près de 95%).
Pour les hormones sexuelles croisées, prescrites à partir de l’adolescence et potentiellement au très long cours : prise de poids, hépatite, calculs biliaires, alopécie, acné ou sécheresse cutanée, risque cardiovasculaires, HTA, hypercoagulation (phlébite et embolie pulmonaire), agressivité, instabilité thymique, dépression, tumeurs bénignes et malignes ; atrophie vaginale, douleurs utérines, modification irréversible de la voix pour les FtM, atrophie testiculaire et impuissance pour les MtF et risques cardio-vasculaires accrus ; et bien sûr pour toutes et tous, dysfonctionnement génital et stérilité.
Quant aux interventions chirurgicales, elles s’apparentent à de véritables mutilations qui impliquent, entre autres, la suppression des zones corporelles les plus érogènes. Nous ne parlerons pas ici de la chirurgie « du bas » (castration et reconstruction), interventions lourdes dont les résultats fonctionnels sont peu probants. Dans notre pays, ces interventions ne sont pas pratiquées chez les mineurs et sortent donc de notre sujet. Mais même la chirurgie « du haut » (mastectomie rebaptisée « torsoplastie ») est une amputation qui laisse cicatrices, douleurs, insensibilité et perte de fonction définitives.
Devant une telle liste de risques et d’effets secondaires, comment ne pas juger que chez les enfants et adolescents, le traitement transaffirmatif va à l’encontre des principes de rapport bénéfice/risque et de proportionnalité des soins ? Ce n’est pas que les jeunes présentant une véritable dysphorie de genre ne souffrent pas, de leur corps comme dans leuresprit. Mais l’hormonothérapie les expose à des risques importants pour des bénéfices douteux. Les bénéfices sociaux notamment (réduction de la suicidalité et intégration sociale harmonieuse) sont loin d’être prouvés. D’autre part, le très jeune âge des patients implique que le traitement, et les risques qui vont avec, sera poursuivi pendant très longtemps. Il s’agit en fait d’une médicalisation à vie, transformant un corps sain et autonome en un corps dysfonctionnel et dépendant, un corps que le traitement pathologise… pour toute la vie !
Dans l’indication très particulière de la dysphorie de genre de l’enfant, l’hormonothérapie est prescrite hors Autorisation de mise sur le marché. Les Prudents pensent que ce traitement expérimental ne devrait être envisagé que dans le cadre de protocoles de recherche stricts, avec toutes les précautions d’usage – notamment un diagnostic soigneusement élaboré au fil de nombreuses rencontres avec le patient et sa famille. La prescription d’hormones devrait rester exceptionnelle, envisagée seulement après épuisement de toutes les ressources non médicamenteuses. Le traitement non médicamenteux – pour parler clair, la psychothérapie, thérapie familiale comprise – étant à l’évidence bien moins dangereux que le traitement médicamenteux et chirurgical. Ce d’autant que les études les plus sérieuses montrent que la majorité de ces jeunes présentent des troubles psychiques sous-jacents. D’autre part, l’expérience prouve que la psychothérapie permet souvent aux enfants de passer ce cap difficile et de se réconcilier avec leur sexe de naissance : plus de 70% des cas se résolvent spontanément ou avec l’aide d’une prise en charge purement psychologique, ce qui évite la médicalisation à vie qui attend un grand nombre des jeunes soumis au traitement transaffirmatif.
Par ailleurs, il faut souligner la fréquence croissante des « détransitions ». De plus en plus de jeunes adultes traités médicalement depuis l’enfance regrettent leur changement de genre. Ils expliquent alors que leur problème n’était pas lié à leur genre, mais à des pathologies psychiques qui n’ont pas été prises en charge correctement. Ces situations commencent à faire l’objet de procès, intentés contre les médecins et institutions accusés d’avoir précipité des transitions médicales voire chirurgicales.
Déjà plusieurs pays (Suède, Finlande, Grande-Bretagne, douze états des USA…), constatant les dangers et les limites de ces médicaments, font demi-tour dans le traitement de la dysphorie de genre de l’enfant et l’adolescent. Abandonnant le Dutch protocol, ils réglementent sévèrement la prescription d’hormones aux mineurs… quand ils ne les interdisent pas complètement, au nom d’un salutaire principe de précaution.
On l’a compris, les lignes ci-dessus ont été écrites du point de vue des Prudents. Des Prudents qui sont aussi des lanceurs d’alerte. Voici ce que nous voulons révéler au public : la prescription d’hormones à des enfants et des adolescents toujours plus nombreux, avant toute prise en charge psychologique approfondie, hors de toute Autorisation de mise sur le marché et de toute mesure, c’est le prochain scandale sanitaire qui plane sur notre pays. C’est une bombe prête à exploser, qui fera bientôt plus de bruit que l’affaire du Médiator !
Or, face à cette situation explosive, que constatent les lanceurs d’alerte, sidérés ? Que la résistance acharnée à leurs conseils de prudence émane d’associations censées représenter et défendre ceux-là même qui font l’objet de leur préoccupation – les personnes transgenres ! Nous sommes accusés de « transphobie », de « haine », de « thérapies de conversion »… Nos interventions dans les médias sont censurées… Nos conférences sont perturbées par des militants agressifs… Ceux parmi nous qui sont médecins sont traînés devant le Conseil de l’Ordre au prétexte de « charlatanisme » et de « désinformation médicale »…
Car en effet, dans l’affaire Médiator, les personnes en surpoids étaient bien « demandeurs » d’un traitement efficace. Certains poussaient pour que le benfluorex bénéficie d’une extension d’Autorisation de mise sur le marché depuis le diabète, son indication d’origine, vers l’obésité et même la simple surcharge pondérale. Comment pouvaient-ils savoir, les malheureux, que ce coupe-faim prétendument miracle était en fait un produit dangereux et même parfois mortel (entre 1000 et 2000 morts en France avant son interdiction en 2009) ? Cependant, quand les révélations sur la toxicité du médicament ont commencé à percer, ils ne s’en sont pas pris aux lanceurs d’alerte. C’est au laboratoire qui commercialisait le poison qu’ils ont adressé leurs griefs, et à juste raison.
Il en va de la santé de milliers de jeunes en souffrance.
En vérité, les transactivistes qui nous attaquent ne représentent qu’eux-mêmes Par idéologie, ils étouffent la rationalité scientifique et tentent d’empêcher tout débat. Et en définitive, ils sacrifient des enfants fragiles à leur cause intransigeante.
La défense des plus vulnérables exige une vision plus élevée et plus désintéressée. Nous, lanceurs d’alerte sur le scandale de la médicalisation abusive d’enfants et adolescents s’interrogeant sur leur genre, demandons que les pouvoirs publics se saisissent de ce grave sujet.Nous attendons avec impatience le rapport de la Haute Autorité de Santé. Nous serons vigilants sur l’impartialité de ce rapport, que nous espérons libre de toute soumission à des groupes de pression. Il en va de la santé de milliers de jeunes en souffrance.