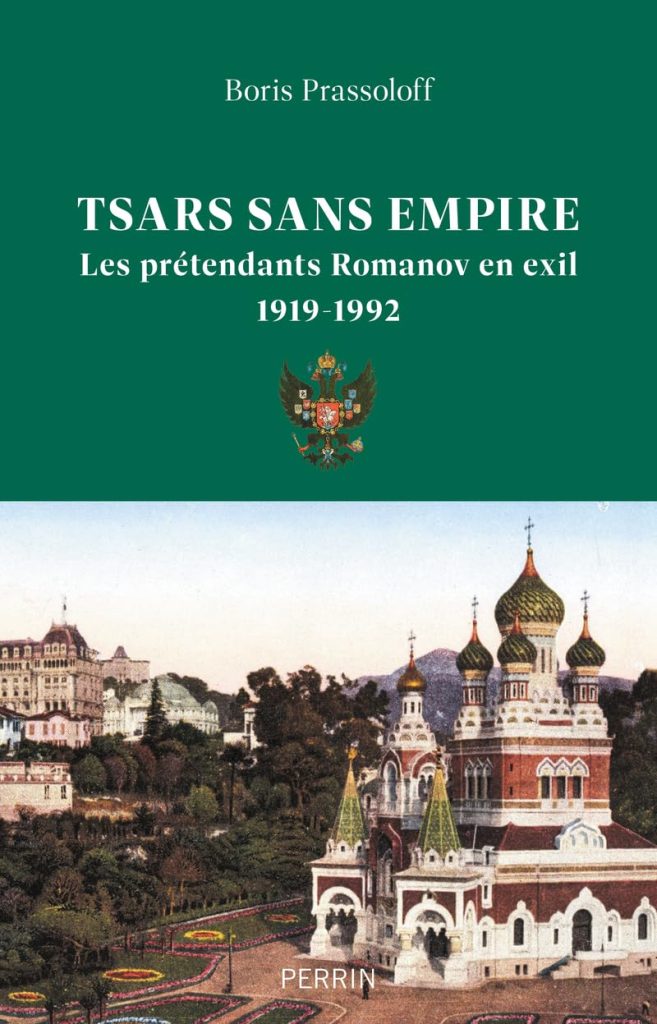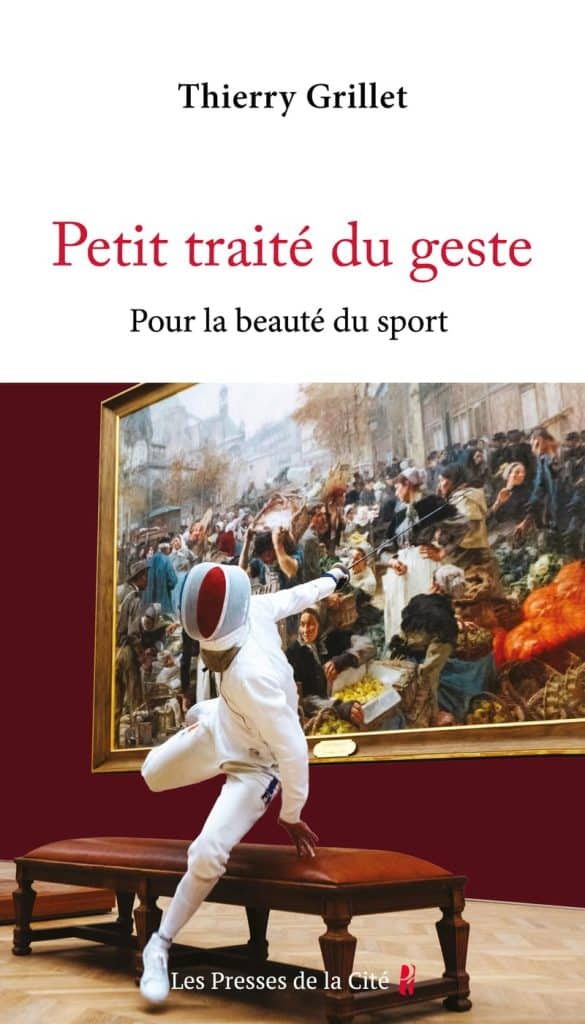Les députés entendent bien enfin trouver une « solution » à la mort ! Le projet de loi euthanasie est sous la coupe d’experts qui se targuent de mobiliser toutes sortes de compétences techniques. Et ainsi, il échappe au commun des mortels… C’est le cas de le dire !
Quand on se réclame aujourd’hui de l’esprit des Lumières, c’est pour vanter la tolérance et le progrès. Rarement pour revendiquer l’esprit d’examen, contester l’argument d’autorité, interroger le dogme, débusquer les présupposés arbitraires des pouvoirs en place. Cette salubre méthode critique serait très utile, sous le règne des « sachants », des experts spécialisés et autres idéologues. Leur domination est par excellence celle de l’argument d’autorité : ici la raison éclairée, ailleurs l’obscurantisme rétrograde. Ce partage sans question, cette assurance sans partage sont particulièrement à l’œuvre dans le projet de loi sur l’euthanasie.
Vocabulaire choisi
Ce projet d’experts mobilise toutes sortes de compétences techniques, et comme tel échappe au commun des mortels, c’est le cas de le dire. Et c’est un projet « sociétal » porté par des groupes de pression, eux-mêmes portés par des courants et des tendances actuelles. Cela donne un objet à la fois hermétique et populaire. La vie, la mort tiennent dans quelques articles de loi enrubannés de faveurs, car on a pris soin de toiletter le vocabulaire pour qu’il soit doux, attrayant, et surtout inoffensif. Tout semble droit et liberté, confort, calme et compassion.
Un médecin décidera de manier une seringue et dosera le produit létal. C’est aussi simple que cela d’effacer le visage humain. On n’est pas plus tranquillement dogmatique : le projet de loi instaure, sans le dire évidemment, comme religion d’État le scientisme pour lequel l’être humain est un ouvrage matériel et conceptuel.
Occulter ce qu’on impose n’est pas une méthode rationnelle, et il a fallu pas mal de contorsions et de manipulations intellectuelles pour arriver au texte qui sera soumis au Parlement. Ainsi n’est-il jamais dit que ce nouveau droit individuel à mourir implique un droit de tuer qui n’a rien d’individuel. Ceux qui le revendiquent pour eux devraient au minimum être conscients qu’ils font prévaloir un privilège (une loi privée) sur la loi fondamentale interdisant de tuer, qui garde l’humanité. Mais y pensent-ils ?
Rien n’est fait pour les y inciter. Ce projet de loi a dès le début suivi une logique partisane précise et traçable. Cela va de la « promesse » d’Emmanuel Macron à Line Renaud et à l’ADMD de leur faire cadeau de l’euthanasie, à la prise de position d’experts institutionnels, aux sondages d’opinion majoritairement favorables, et à la convention citoyenne, artefact démocratique combinant la raison des uns et l’émotion des autres. Un échantillon de quelque 200 mortels, sortis de la poussière voilà environ un demi-siècle et qui y retourneront bientôt, a travaillé avec toutes les garanties de sérieux sur le sujet implicite, maquillé de mots plus bénins : Faut-il ouvrir le droit de tuer son semblable ? La réponse est oui, dans les conditions que la loi définira. Conclusion tautologique du président de la République : la loi sera une « co-construction » établie sur « la base de cette référence solide qui est celle de la convention citoyenne ».

N’importe quel esprit un brin rationnel peut s’étonner que la « base » de la vie et de la mort soit établie par quelques citoyens de ce siècle hâtivement réunis, et apparaisse comme une « référence solide ». Est-ce bien là l’héritage de ces nobles Lumières si vantées par les intelligences éclairées ? Le curieux sophisme qui consiste à prendre pour fondation d’une « co-construction » un discours en cours de construction se traduit en langage populaire : appuyez-vous sur le jus de crâne que vous concoctez et tenez-vous à vos chapeaux.
Il n’y a pas de solution à la mort
La simple logique oblige à s’interroger sur ce discours qui impose autoritairement une conception arbitraire de l’humanité. Comme l’a reconnu avec un certain réalisme Mme Firmin-Le Bodo, « il n’y a pas de solution à la mort ». C’est un fait universel, non seulement humain mais cosmique, qui ne relève ni du droit ni de la politique. Il ne revient pas à la loi civile de l’interpréter en imposant une doxa particulière, mais de donner un cadre commun, un espace juste où chacun puisse exercer librement « le métier de vivre », selon sa conscience et son cœur. Restons dans les catégories logiques, en dehors du bien et du mal, du bonheur et du malheur. Le plus large contient le plus étroit, le plus grand le plus petit ; l’inverse n’est pas vrai. Lorsque Brueghel peint La Chute d’Icare, il l’inscrit dans un plan de grand ensemble. L’attention peut se fixer sur Icare disparaissant, s’étendre au paysage, s’intéresser aux rapports entre la nature et les destins humains, multiplier les approches. Toute la réalité s’offre à la pensée vivante. La condition humaine comprend les plus diverses options intellectuelles, existentielles, militantes. Prendre un parti fait partie de la vie. Mais il faut questionner le despotisme légal qui se base sur une étroite société pour imposer un point de vue unique sur l’humanité, en supprimant la vision d’ensemble.
L’esprit d’examen a été remarquablement exercé par les très nombreux médecins et soignants opposés à ce projet de loi pour de profondes raisons humaines. Ils ont la rationalité du savoir, la compétence professionnelle, et tout autant l’expérience sensible de la douleur, de la complexité des êtres et des relations. La raison et le cœur. En vain : leur parole n’a pas été entendue. Pire, elle a été exclue, répudiée. Le projet de loi ne retient ni leur exigence de dissocier l’acte de soigner de l’acte de tuer (il inscrit l’euthanasie dans la suite des soins, sans marquer aucune rupture morale), ni leur insistance sur l’accompagnement personnel et collégial d’une personne en fin de vie, en quête de consolation, de sens et d’amour. « Quand on ne peut plus guérir, il faut aimer », dit le docteur Claude Grange. Quand on ne peut plus guérir, on peut supprimer, répond le projet de loi. Quand le savoir médical atteint ses limites, il reste la présence fraternelle, et la seule compétence « du métier d’être humain », dit le docteur Xavier Emmanuelli. Quand le savoir professionnel atteint ses limites, le dernier mot revient à la technique.
Tant que le visage humain reste un absolu, intangible, irréductible, la science et la technique ont leur place, légitime et seconde, dans l’édifice politique. Mais ce « secourisme à l’envers » (!) renverse l’édifice et révèle la glaciale et sévère doxa promulguée unilatéralement. Si c’est là le « modèle français » annoncé par le président de la République, il offense la raison par son mensonge sémantique et la sensibilité par son nihilisme cynique.