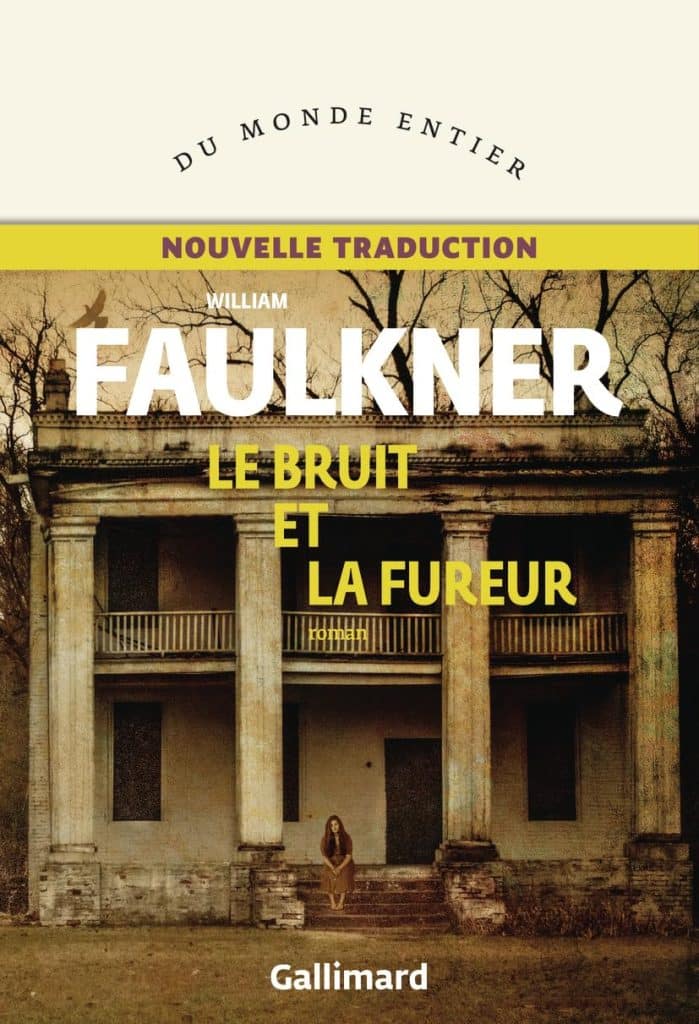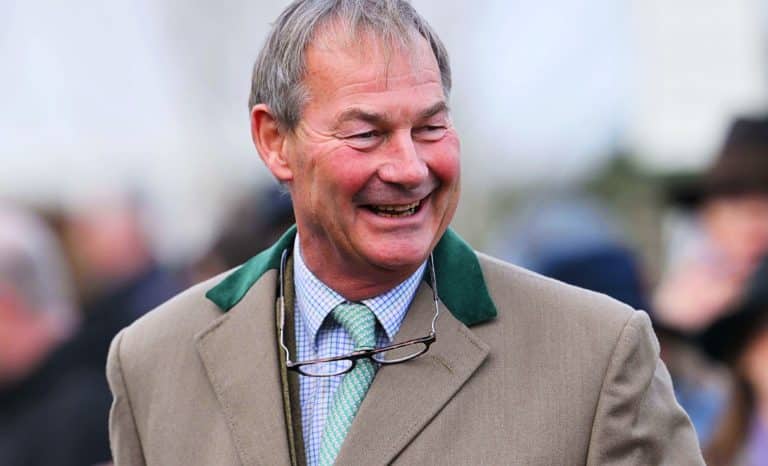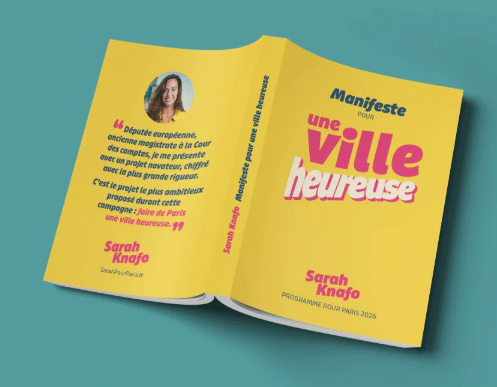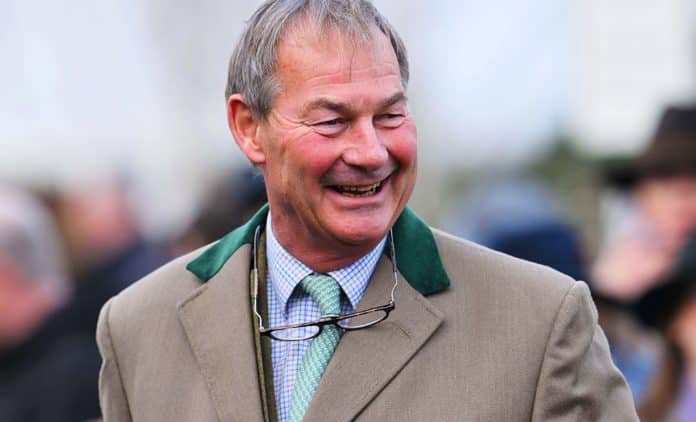Si le Rassemblement national monte encore dans les sondages la semaine prochaine, ce ne sera ni à cause de la pluie ni à cause des bars-tabac fermés, mais juste à cause de cette découverte renversante – de Néandertal à Charles III – que personne n’aime être remplacé. Grande enquête.
Beaucoup de journalistes, d’essayistes et d’hommes politiques s’interrogent sur la montée irrésistible du Rassemblement national. Ou plutôt ils miment la perplexité, surtout s’ils sont de gauche. Tous connaissent la vraie raison, mais l’exprimer relève d’un tabou absolu. Ça monte, ça monte, on s’inquiète, et c’est comme si la Charente à Saintes ou la Garonne à Langon grimpaient imperturbablement et qu’il était interdit d’accuser la pluie. Quoi, ça déborde et vous rendez ce déluge responsable ? Vous êtes un fasciste, un nazillon, un ennemi du genre humain !
Subtil
Par bonheur, une explication acceptable a été découverte en ce début de février 2026 par un chercheur en science politique à l’Université de Zurich nommé Hugo Subtil (non, non, lèvres mordues, pas d’ironie facile). La montée de ce parti rituellement qualifié d’extrême-droite est due à la disparition des bars-tabac dans la France profonde. Due en partie, mais en partie significative. La fermeture d’un bar-tabac de village renforce l’isolement social des citoyens et cette solitude les pousse à se jeter dans les bras de Marine ou Jordan… Cette trouvaille capillotractée qui confond corrélation et causalité, qui utilise Guilluy sans le nommer et en le subvertissant, a été largement relayée par les médias. Le Monde, le Nouvel Obs, Public Sénat, la Croix, le Huff post, France 3 Pays de Loire, entre autres, l’ont répercutée. Rien n’était drôle comme les têtes que faisaient les participants au plateau de Public Sénat, béats de surprise heureuse. “Bon sang, by Jove, mais c’est bien sûr !” comme disaient Blake et Mortimer quand ils découvraient la clé d’une énigme. S’il y avait eu deux doigts de pluralisme sur le service public, quelqu’un aurait forcément éclaté de rire.
Causeur mène l’enquête
J’ai voulu en avoir le cœur net. Et surtout éliminer l’explication ethnique, l’odieuse explication que tous ont sur le bout des lèvres mais que peu osent formuler. J’ai donc été interroger mes amis les Navajos de Tuba City, capitale de ce peuple autochtone en Arizona. Je me suis rendu en Arménie pour parler aux réfugiés chassés l’an dernier de l’Artsakh ou Haut-Karabakh par l’armée de l’Azerbaïdjan. En Finlande, j’ai compati à la nostalgie encore vivace des Caréliens finnois dont les grands-parents ont été expulsés de leur terre et de leurs maisons par les Russes en 1940. Et j’ai découvert, à ma stupéfaction, cette déroutante réalité : personne n’aime être remplacé !
La géographie ne me suffisait pas, j’ai étendu mon enquête à l’histoire et même à la préhistoire. J’ai été interroger Jean-Jacques Hublin. Ce grand paléoanthropologue qui allie une extrême rigueur scientifique à beaucoup d’humour, vient de terminer une série de cours au Collège de France intitulée Sapiens remplace Néandertal (toutes les vidéos sont sur YouTube, chaîne du Collège de France). Je lui ai posé la question cruciale : les Néandertals ont-ils été satisfaits d’être remplacés par les Sapiens, nos ancêtres ? Là aussi, réponse sidérante : “Pas du tout !” Ils ont sans doute fini dans l’estomac de leurs remplaçants, mais ça, c’est moi qui l’imagine, le grand savant n’avancerait jamais une supposition aussi improuvable.
A lire aussi: Jordan Bardella: «Je suis l’enfant de la génération 2005-2015»
C’est bien beau la science, mais il faut aussi s’intéresser à la vie quotidienne, aux vrais gens comme on dit. Me faisant sociologue de terrain, j’ai voulu savoir si, parmi mes connaissances, les femmes abandonnées par leur petit ami, amant, ou mari, approuvaient leur remplacement par une jeune et jolie rivale. Et à l’envers, même question aux hommes plaqués. Je me suis rendu à Londres pour m’entretenir avec Charles III quitté il y a longtemps par sa femme Diana qui lui a préféré un play-boy fou du volant. Dans tous les cas même réponse, si incorrecte humainement et philosophiquement : je n’ai pas du tout aimé être remplacé(e) !
Bye bye Schengen
Je conseille donc aux femmes et hommes politiques de faire comme moi, d’en prendre leur parti et de se plier à cette triste évidence : les Français n’aiment pas être remplacés. Donc il faut reprendre le contrôle des frontières nationales et rouvrir même la jolie cabane de la douane entre Ainhoa la française et Dantxarinea l’espagnole, en plein Pays basque. Quel dommage ! Nous aimions beaucoup Schengen, nous sautions allègrement chez nos frères latins d’au-delà des Alpes ou des Pyrénées, nous passions joyeusement le Pont du Rhin entre Strasbourg et Kehl, sa banlieue allemande, comme s’il n’y avait jamais eu ces terribles guerres entre les deux rives. Même au-delà de Schengen, je me sens charnellement Européen juste après Français. Je me suis trouvé en juillet 2001 sur le Khrechtchatyk, les Champs-Elysées de Kiev. C’était un dimanche à 13h, et personne, j’étais seul, le boulevard était complétement vidé par le déjeuner et la baignade dans le Dniepr. Soudain, un violoneux, il se met à jouer du Vivaldi ! La France, Venise et Kiev se rapprochent, je pleure, je pense à l’Europe kidnappée de Kundera, à tous ces pays qu’on nous a volés et qu’a si longtemps écrasés la botte soviétique…
Mais à partir du moment où le pronostic vital de la France est engagé, finis tous ces trémolos, les odes d’amour à Barcelone, Dublin ou Varsovie. On boucle les frontières, on dit à nos gentils visiteurs d’aller se faire soigner à Dubaï ou nourrir à Moscou. Et le lundi suivant, les sondages du Rassemblement national patinent, et le locataire de l’Elysée cesse d’avoir ce cauchemar récurrent de l’arrivée du nouvel occupant Jordan dans les lieux.
Bien sûr, rien de tout cela n’arrivera. Quand on se trompe depuis cinquante ans, on préfère persister dans l’erreur que l’avouer. L’eau continuera à monter irrésistiblement sous les ponts, mais par pitié, que tous les hydrologues incompétents cessent de dire que ce n’est pas la faute de la pluie.