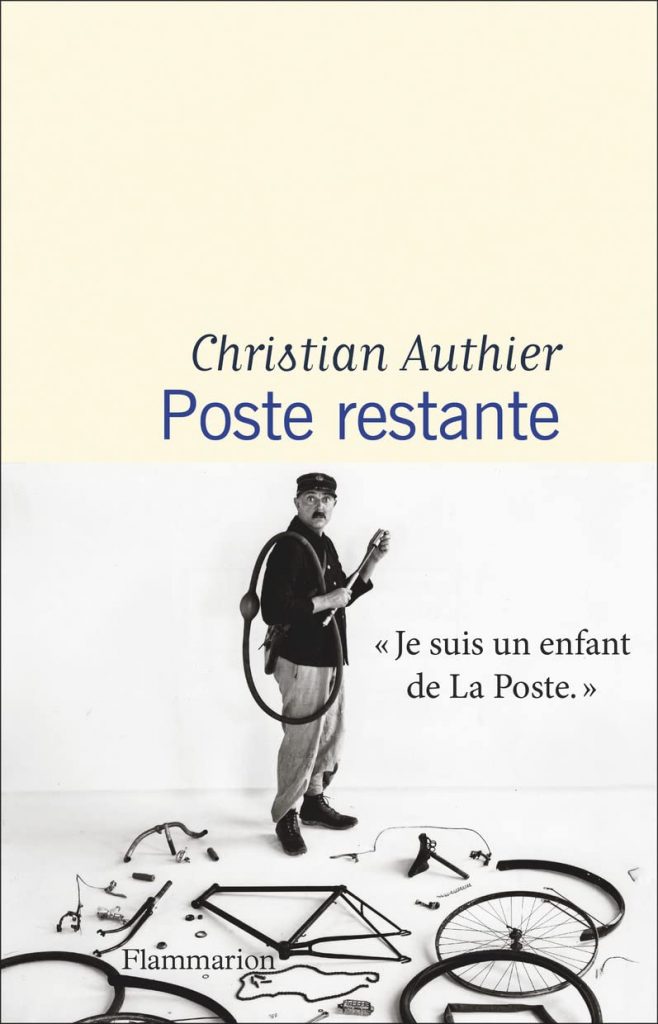Notre « modèle social » conduit la France à la ruine. Et la réforme des retraites est une mesurette qui ne résout rien au problème abyssal de la dette publique. Quant à ceux qui prônent toujours plus de mesures sociales, ils nous mènent sur le chemin de la Grèce, forcée par les marchés financiers à suivre une véritable cure d’austérité.
Occupés à jucher leur sac poubelle sur un tas d’immondices ou à y mettre le feu, les Français nombrilistes peinent à réaliser le profond mépris qu’ils inspirent à l’étranger. Dans une zone euro solidaire par construction, les salariés du reste de l’Europe ont bien compris que les Gaulois entendaient les faire marner jusqu’à 67 ans pour permettre aux mangeurs de grenouilles de partir à 62.
Ces étrangers – dont la culture est pourtant révérée en d’autres circonstances – ne manquent pas d’arguments pour ridiculiser l’Hexagone. Partout en Europe (et ailleurs évidemment) on travaille, par an et sur une vie, plus que les Français. Les syndicats qui défilent contre la réforme des retraites ont par ailleurs appelé à voter pour le candidat qui proposait de repousser l’âge de départ à 65 ans, contre celle qui promettait de le ramener à 60 ans – tout en s’indignant désormais d’un report à 64 ans par leur président démocratiquement élu. Aucun manifestant ne semble non plus se soucier que la richesse par habitant ait dévissé de 16 % entre la France et l’Allemagne depuis 2005. S’appauvrir, mais continuer à dépenser toujours plus paraît pourtant impossible – mais impossible n’est pas Français. Quant au changement de paradigme induit par la remontée des taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation, autant leur expliquer la fin de l’argent magique en dialecte pachtoun. Vu de l’étranger, rien ne peut excuser notre peuple rétif à cette réformette – tellement bâclée qu’il faudra y revenir en 2030 (perspective enthousiasmante pour le futur président de la République). Aucune excuse donc, si ce n’est l’addiction à la gabegie publique. Les pensions versées aux retraités Français sont ainsi supérieures de 69 milliards par an à la moyenne européenne, un avantage, à leurs yeux, éternellement acquis. Mais un avantage financé à crédit, par les horribles marchés financiers auprès desquels nous faisons la manche depuis quarante ans – et qui nous ont dépannés de 206 milliards en 2022.
L’état du pays dressé par les élites fait douter les Français
Et pourtant, on peut trouver quelques circonstances atténuantes à ce peuple dont la comptabilité publique défie les lois de la gravitation universelle. Les Français se voient gouvernés depuis 1981 par des gens bien élevés qui mènent tous exactement la même politique – plus d’Europe, plus de dettes, plus d’allocs, plus d’immigration, plus d’impôts, moins de services publics. Avec les résultats que l’on sait en matière d’éducation, de santé ou de sécurité, un palmarès déjà consternant auquel il convient d’ajouter désormais le démantèlement de la filière nucléaire de Jospin (arrêt de Superphénix en 1997) à Macron (fermeture de Fessenheim en 2020). Quelles élites, dans l’histoire de France, laisseront une trace aussi infamante ?
Avec un tel bilan, entaché d’énormes mensonges sur l’état réel de ce pays, difficile de demander au simple citoyen de croire sur parole Emmanuel Macron lorsqu’il affirme que la réforme des retraites est indispensable. Ils les ont trompés depuis tellement longtemps – Valls vient par exemple de déclarer que la France ne pouvait plus accueillir d’immigrés, on n’a pas le souvenir que ce constat guidait la politique du gouvernement qu’il dirigeait.
Les Français concernés par l’allongement de la vie active sont par définition ceux qui ne vivent pas des allocations de l’État-providence le plus généreux de la planète – 33 % du PIB y est consacré à la « protection sociale », 834 milliards d’Euros par an. Le salaire de ceux qui se lèvent tôt est amputé de charges et d’impôts destinés à financer un assistanat hors de tout contrôle. Ces rémunérations nettes, trop faibles de l’aveu général – mais qu’une réduction des prélèvements obligatoires revaloriserait instantanément – sont désormais grevées d’une inflation galopante, conséquence d’un « quoi qu’il en coûte » irresponsable. Pour peu que ces salariés habitent une ville moyenne désertée par les services publics, le sentiment que « c’est toujours aux mêmes que l’on demande des efforts » paraît en réalité légitime.
A lire aussi : Mélenchon/Le Pen, un match déjà plié?
Avec un sens du contretemps parfait, Emmanuel Macron, dans sa causerie du 22 mars dernier, disait vouloir s’attaquer, après les retraites, à l’épineux dossier des contreparties à demander aux allocataires du RSA. Sans doute aurait-il été mieux inspiré de commencer par là. Mettre un frein à la folle générosité du modèle social français semble effectivement une condition nécessaire à l’acceptabilité d’un report de l’âge de la retraite.
Nécessaire, mais pas suffisante. Tant que Mélenchon ou Le Pen feront miroiter aux Français qu’aucune réforme des retraites n’est justifiée, les macronistes ont peu de chances de convaincre. Ces héritiers du chiraco-hollandisme, au pouvoir depuis quatre décennies, n’ont pas été élus pour réformer quoi que ce soit, mais pour arracher à la BCE, à Berlin, à l’Europe les moyens du statu quo. Notre peuple de pleurnichards a délégué à des gouvernants geignards le soin de porter ce message urbi et orbi : les réformes – ouin ouin –, c’est trop dur ; et si vous ne nous donnez pas les sous, ce sera Le Pen au pouvoir – ouin ouin.
Comme en 1981, après trente-trois ans de pouvoir ininterrompu de la droite, la France aurait en réalité bien besoin d’une alternance, afin de confier les manettes à ceux qui prétendent gouverner autrement. Mais la Macronie, dernier avatar de l’UMPS, a fait en sorte que cette alternance ne puisse théoriquement survenir. C’est sans doute là son erreur et son ultime trahison : dans une démocratie, il ne peut pas y avoir qu’un seul parti dit de gouvernement – plus exactement, un autre est appelé tôt ou tard à le devenir, ce fut le cas du PS à partir de 1983. À l’instar d’Alexis Tsipras en Grèce, arrivé au pouvoir avec un programme économique d’extrême gauche, si le futur locataire de l’Élysée était issu de LFI ou du RN, nul doute qu’entre la banqueroute et les réformes « ultralibérales », il choisirait ces dernières. Dans une France sociétalement de droite et économiquement de gauche, somme toute, la mieux placée pour porter l’âge de la retraite à 70 ans, même si elle ne le sait pas encore, s’appelle… Marine Le Pen.