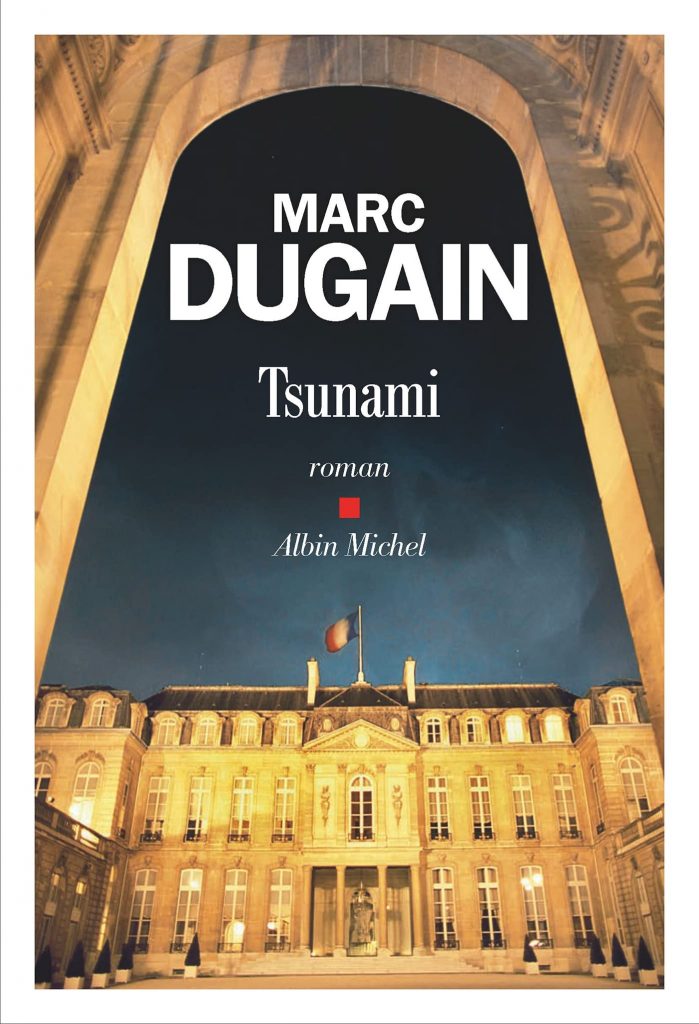Une tribune libre d’André Rougé, député européen du Rassemblement national, délégué national à l’Outre-mer dans le parti.
Le moins que l’on puisse dire, s’agissant de notre président de la République, est qu’il ne ménage pas sa peine pour faire entendre la voix de la France. L’an passé à Moscou, au début du mois d’avril à Pékin, et il vient d’annoncer qu’il retournera à Kiev prochainement, « s’il y a une approche utile ». À quoi ce charivari diplomatique peut-il rimer et comment Emmanuel Macron peut-il envisager de faire s’asseoir Poutine, Xi Jinping, Biden et Zelensky à une même table, dès lors que la France est incapable de faire entendre raison à un micro-État de 800 000 habitants dans l’Océan Indien ? Car tel est le premier bilan de l’opération Wuambushu commencée ce lundi 24 Avril. Une opération au principe des plus louables, celui de s’occuper enfin de nos compatriotes du département de Mayotte en leur apportant la sécurité des personnes et des biens, premier des devoirs régaliens de l’État.
L’objectif de cette opération est triple :
- Mettre fin à l’occupation illégale, en délogeant les squatteurs, de domaines privés et publics.
- Reconduire à la frontière des Comores 10 % des 100 000 migrants clandestins présents illégalement sur l’île.
- Interpeller et présenter à la justice les criminels, délinquants, marchands de sommeil, trafiquants de faux papiers et autres passeurs errant en toute liberté parmi les villages de bidonvilles.
Pour cette seule et dernière raison de rétablissement de l’autorité de l’État, l’opération doit se poursuivre. Les 1 800 policiers et gendarmes présents dans ce département français de l’Océan Indien doivent – en interpellant le maximum de ces individus que les Mahorais n’hésitent pas à appeler terroristes – faire changer la peur de camp.
Hélas, j’ai eu l’occasion de dénoncer, publiquement et avant son démarrage, l’impréparation de cette opération pourtant réclamée depuis 2018 par nos compatriotes mahorais, mais c’était prévisible, avec trois ministres – et non des moindres s’agissant des ministres régaliens – de l’Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères qui se sont fourvoyés, la transformant en un retentissant et cuisant nouvel échec du gouvernement !
Après les incartades locales du Syndicat de la magistrature, mon collègue Julien Odoul, avait interrogé, à ma demande, M. Dupond-Moretti. Il était en effet prévisible que certains feraient usage de l’article 55 de notre Constitution précisant que les juridictions françaises peuvent annuler ou suspendre un acte administratif ; même fondé sur une loi, si elles considèrent qu’elle méconnaît un traité (comme la CEDH ou le droit de l’UE). Or, la France s’était déjà fait épingler par la CEDH au titre de son article 8, en 2003, lors d’opérations analogues à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint Martin.
Cette jurisprudence très laxiste que le garde des Sceaux connaissait, aurait très bien pu être anticipée mais ça n’a pas été le cas. Personne ne parviendra à nous faire croire et accepter qu’aucun moyen propre n’existe ou n’est connu, pour défendre les intérêts supérieurs de l’État et les intérêts supérieurs des Français !
Quant à l’attitude du gouvernement de l’Union des Comores, qui a refusé l’accostage d’un bâtiment français dans le port de l’île d’Anjouan, s’il était un fait aisément prévisible ; c’était bien celui-là !
A relire: Mayotte: Darmanin peut-il faire plier les Comores?
Mayotte est française depuis 1841, bien avant Nice et la Savoie, par trois fois et par voie référendaire, les Mahorais ont confirmé leur souhait d’appartenir à la France, ce qui est, d’ailleurs, gravé dans le marbre de l’article 72-3 de notre Constitution. Jamais les Comores, animés par une volonté irrédentiste, ne l’ont accepté.
Ce refus se traduit par des provocations à répétitions à l’égard de la France. En août 2019, le président Azali déclare sur les ondes de RFI qu’il ne reconnaît pas l’autorité du Préfet de Mayotte sur le territoire comorien. Une réaction digne de ce nom eût consisté en une action diplomatique forte sous forme du rappel de notre ambassadeur pour consultation, comme ce fût le cas pour notre ambassadeur à Rome après qu’un membre du gouvernement italien ait eu l’« outrecuidance » de rencontrer un comité de « gilets jaunes ». Et, il eût été normal de convoquer l’ambassadeur des Comores à Paris, au Quai d’Orsay, afin de lui signifier le mécontentement de la France.
Réaction de la France… Aucune !
En revanche, le président Azali a été reçu, en grande pompe, à l’Élysée par Emmanuel Macron. Il en est ressorti avec un chèque d’aide au développement de 150 millions d’euros (dont nos compatriotes mahorais auraient bien besoin) en contrepartie desquels il s’engageait à recueillir tous les ressortissants comoriens expulsés.
Cette largesse de la France ne l’a, en aucun cas, empêché de réitérer quelques temps plus tard. Lors de la dernière assemblée générale de l’ONU, le même président Azali a revendiqué la propriété de Mayotte à la tribune de l’institution internationale.
Réaction de la France… Nulle !
J’interrogeais alors notre ministre des affaires étrangères quant à cette absence de réaction qui m’a répondu en ces termes « La coopération étroite que nous entretenons avec les Comores, fruit d’un engagement de long terme, nous permet de réduire fortement la pression migratoire sur notre territoire mahorais […] en luttant ensemble, contre l’immigration clandestine grâce […] à une coopération exemplaire en matière de reconduites » [sic].
Pour compléter, chacun aura pu noter la volonté d’ingérence de cet archipel d’îlots dans les affaires intérieures de la France en réclamant l’annulation de Wuambushu. Il est aisé d’imaginer quelle serait la réaction de notre pays si Mme Meloni, M. Scholz ou M. Sunak se mêlait de ce qui se passe à Nice, en Alsace ou à Calais.
Mais là…rien !
Pour conclure ce florilège de défis et bravades, rappelons-nous les récentes déclarations de l’ambassadeur des Comores à Paris expliquant que les Comoriens sont chez eux à Mayotte.
A tout cela, il convient d’ajouter que cette opération ne peut être viable qu’à court terme car les 70km du bras de mer séparant Anjouan de Mayotte n’empêcheront en rien les expulsés de revenir sur le territoire français d’ici six mois. Cette opération met surtout en évidence, au travers des manquements de nos trois ministres régaliens, l’amateurisme et l’incompétence du personnel politique en charge de l’exécutif de notre pays et la méthode d’Emmanuel Macron. Gouverner c’est prévoir ! L’impréparation de cette opération aura douché les espoirs de nos compatriotes mahorais et il faut souhaiter que celle-ci se poursuive pour les raisons indiquées plus haut, même si elle ne suffira pas. Il faudra, pour Mayotte comme pour la Guyane, une autre opération de ce type, mais avec les préalables indispensables à la lutte pour une maîtrise souveraine de l’immigration et pour la protection de la nationalité française, comme le propose Marine Le Pen.
Une révision de la Constitution par référendum pour refonder le cadre constitutionnel du statut des étrangers, de notre nationalité et mettre fin aux dérives d’une jurisprudence devenue folle. Ainsi, les juges ne pourraient plus écarter une loi au motif d’un traité ou du droit de l’UE. Il sera posé, comme principe que l’expulsion est possible, dès lors qu’un étranger viole nos lois et ce, quelle que soit sa situation personnelle ou celle de sa famille. Cette réforme interdira toute forme de régularisation des clandestins. Le droit d’asile ne sera plus accordé sur le territoire national, mais dans les consulats et ambassades de façon préalable à l’arrivée en France. La suppression définitive du droit du sol sera, enfin, constitutionnalisée. Ces mesures s’adapteront, bien sûr, à la France d’Outre-mer au regard des normes prévues par les articles 73 et 74. Quant au droit international, que les Comores vont tenter d’instrumentaliser, doit-il autoriser un État à refuser de protéger ses ressortissants en les accueillant sur leur propre sol, mais aussi à organiser une émigration anarchique, sinon conquérante et violente sur le territoire d’un État voisin ? La France est, de ce point de vue, agressée par les Comores. Nous avons, légitimement le droit de réagir par la plus grande fermeté. En cela, l’opération Wuambushu est une excellente répétition de l’action que devra mener un gouvernement : appliquer les lois de la République conséquentes à un référendum sur l’immigration voulu par Marine Le Pen. À Mayotte, en Guyane, comme ailleurs, nombreux sont les Français qui attendent l’élection de Marine Le Pen pour retrouver ce respect, cette protection et cette espérance.