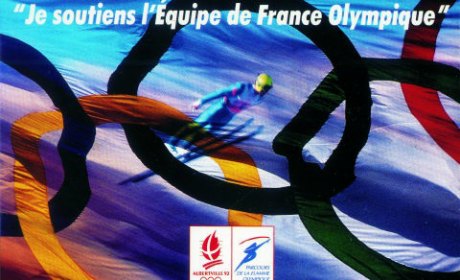Faber, le destructeur livre une description réaliste et glacée des métamorphoses de la société et des âmes françaises au cours des deux dernières décennies. Tristan Garcia en réalise hélas un portrait fidèle – et par là même très éprouvant. Si ses vertus proprement stylistiques sont moins affirmées, la virtuosité de son art narratif et architectural surprend beaucoup. A trente-deux à peine, il atteint une pleine maturité esthétique. Faber est une œuvre dense, dépouillée de tout lyrisme et de toutes fioritures, qui nous donne à ronger l’os âpre de la réalité.
Dans le sang de Tristan Garcia, il y a beaucoup de solitude et de nuit. Alors, un souffle passe, nous entendons des voix. Elles susurrent, elles nous appellent. Faber est un ruban de Mœbius à trois faces. Trois amis se sont connus à l’école primaire. Le roman trace son sillage entre les trois îles de leur existence : leur enfance, leur jeunesse et leur âge adulte.
Le roman se tisse dans l’entrelacement de ces trois voix dissymétriques, singulières, chacune porteuse d’une vérité ambigüe et partielle. Trois voix aimantées par un trou noir : l’inépuisable mystère de la personne de Mehdi Faber. Mystère si abyssal que Tristan Garcia se plaît à lui donner par instants un tour presque comique.
Comme tout le monde à Mornay, ville imaginaire, Madeleine et Basile vivaient dans le néant des périphéries du capitalisme démocratique. Morts-nés à Mornay, comme tout le monde. Et puis Faber vint. Et ils éprouvèrent cet étrange sentiment d’être en vie, de naître enfin. Cet orphelin avare en confidences, mais à la culture et au savoir inépuisable, les fascina par son courage, sa souveraineté et sa beauté. Un peu plus tard, Faber les initie aussi aux joies de l’anarchie, de la négativité révolutionnaire. Et puis les choses tournent très mal. Après quoi, durant dix ans, Basile et Madeleine perdent sa trace. Et rentrent gentiment au bercail de l’âge adulte.
Durant ces dix ans, ils tentent – avec un succès mitigé – d’oublier Faber, de cesser de l’aimer et de le haïr comme le point le plus incandescent de leur existence. Le roman s’ouvre sur les retrouvailles avec Faber. Le demi-dieu de leur jeunesse est devenu une loque misérable, au corps délabré. Il n’a visiblement pas suivi les conseils avisés du vieux Deleuze invitant à se détourner coûte que coûte du devenir-loque.
Faber est le diable, le diable incarné dans une personne humaine. Réellement le diable. L’esprit d’auto-anéantissement et de destruction. La fissure d’irrationnel qui lézarde le tableau froid et réaliste de la société française. Qui doit mettre en déroute, peut-être, les docteurs de l’intelligence sociologique.
Le roman, dans son épaisseur, autorise de multiples lectures de l’émergence de cet élément diabolique. Le crime n’est peut-être le fait que de Madeleine et Basile. L’horreur et la difformité diaboliques ne naissent peut-être que de leur admiration démesurée, de leur idolâtrie, de leur ardent désir de croire qu’il y en aurait un qui échapperait à la finitude humaine.
Ce n’est pas sans raisons que j’ai évoqué un ruban de Mœbius à trois faces. La narration est tissée par trois voix distinctes : et cependant, ces trois voix n’en forment peut-être qu’une seule. Dans ce cas, c’est le trio entier, parodie grimaçante de la trinité, qui est le lieu véritable du diabolique. Leur union est si fusionnelle que la singularité de chacun est abrasée. Les trois personnages atteignent dans leur être un point de fission qui métamorphose l’amour en haine pure.
La figure diabolique s’éclaire aussi par une autre hypothèse, venant compléter les précédentes : Faber n’est pas le diable mais le devient, en refusant la finitude, l’incarnation, son inscription dans le temps. Le diable nomme alors son refus forcené de l’âge adulte, de se séparer de son enfance, métamorphosée ainsi en bête féroce. Son enfance transformée en haine ardente et tentant désespérément de brûler, d’insensibiliser son corps adulte, espérant effacer à même ce corps la mémoire de son existence réelle. Cette perte de mémoire « diabolique », cette flambée de déni autodestructeur est l’une des plus grandes découvertes du roman.
L’enfer de Faber peut enfin s’entendre comme un écho de sa terreur devant la sexualité – qui affleure seulement entre les lignes – et singulièrement de l’effroi que lui inspire le sens du toucher, le fait d’être touché – tactilement et dans son âme – par un autre, par un être irréductiblement tiers. Peut-être n’est-ce rien d’autre que l’émoi trop intime qui prend pour Faber figure de diable.
Mais revenons un instant à la texture réaliste de Faber. Le réalisme de Tristan Garcia, qui représente un important effort romanesque, peine cependant à transmuer la laideur et le monstrueux des paysages concrets du présent en beauté habitable – comme l’hilarant et génial Olivier Cadiot en accomplit le miracle dans Retour définitif et durable de l’être aimé. Le réel ayant ces derniers temps une gueule d’asphyxie, on peut regretter aussi que Garcia n’ouvre pas de temps à autre, comme un Maulin, des brèches vers un ailleurs respirable.
Garcia et Cadiot convergent cependant sur un point décisif, qui réjouira tous ceux qui apprécient la sortie du nihilisme et l’alpinisme : la constitution d’une ligne de crête échappant simultanément à la bêtise moderne, post-moderne et réactionnaire. Il n’y a plus lieu de jouer ces trois bêtises les unes contre les autres, ni de séjourner en elles éternellement – fût-ce pour les combattre. Nous savons qu’elles sont simplement trois manières différentes de disposer son corps adoptées par le langage au moment où il s’apprête à mourir. Et, comme nous, il a mieux à faire que mourir, le langage. Il faisait seulement semblant d’aller si mal.
Il ne me reste plus qu’à vous révéler la fin de Faber : elle est d’une virtuosité résolument scandaleuse. Je n’ai jamais lu fin de roman plus tortueuse et plus étrange. L’humour, peu présent avant, surgit alors avec force. Garcia n’hésite pas à y violer les règles déontologiques de l’art du roman dans des proportions qui font proprement frémir. C’est une fin qui n’en finit plus de ne pas finir. Attention, quand même.
Tristan Garcia, Faber le destructeur, Gallimard, 2013.
*Photo : POL EMILE/SIPA. 00567155_000041.