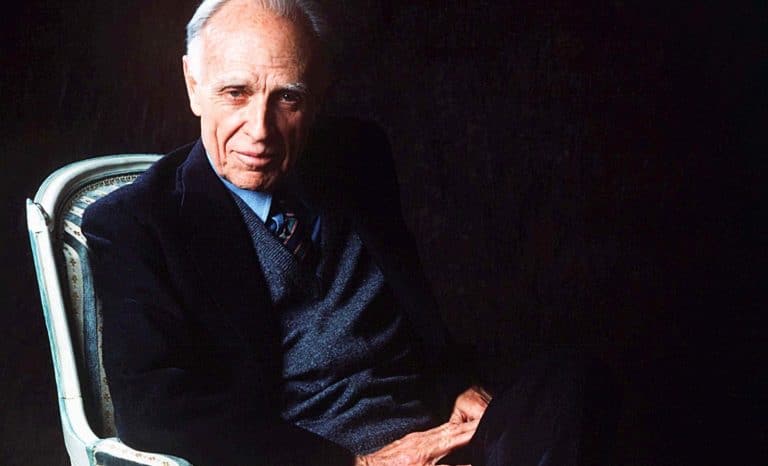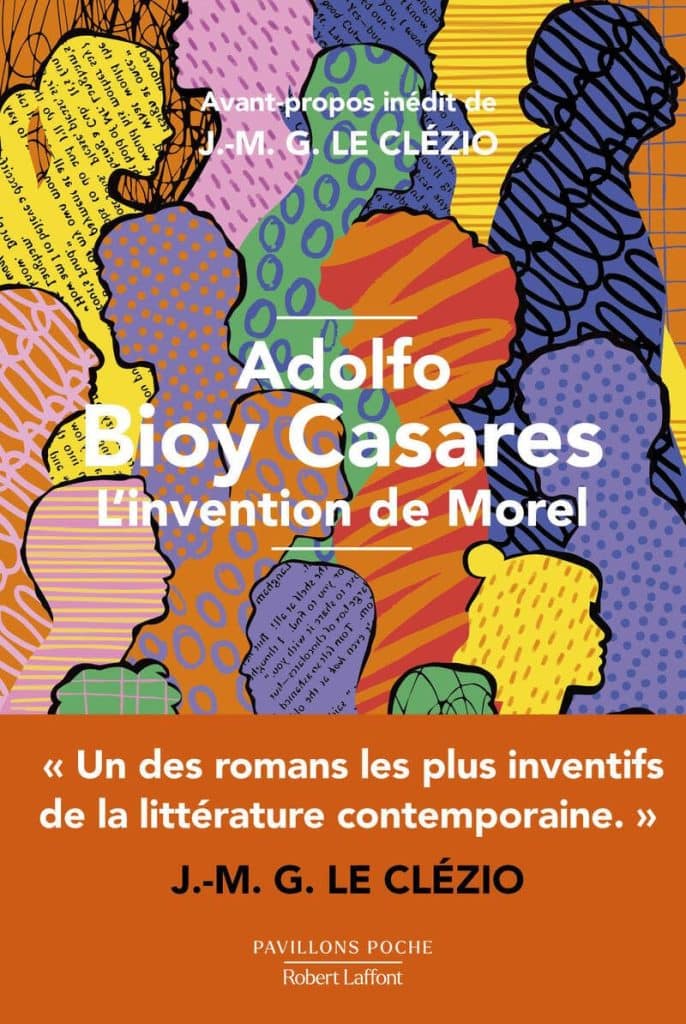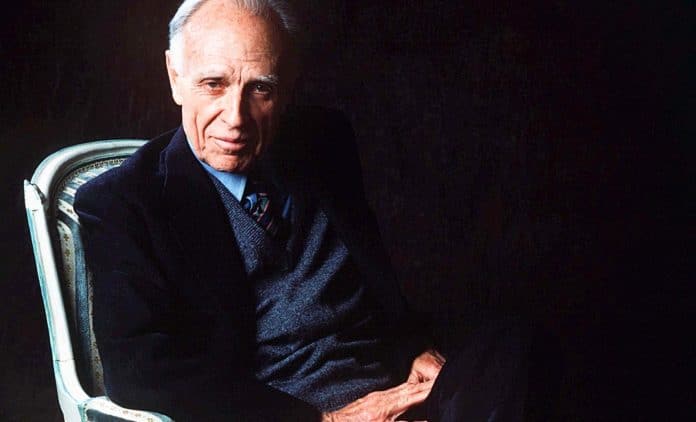Les militants de la gauche radicale sont sont le produit, non de l’exclusion sociale, mais d’une société hédoniste. Ils sont rarement suivis par les vrais prolétaires dont la vie quotidienne est aux antipodes de la leur. Ce sont les enfants gâtés de notre civilisation, civilisation qu’ils dénigrent sans avoir de vrai modèle à proposer à sa place. La chronique de Charles Rojzman.
En mai 2025, le livre-enquête La Meute a révélé les structures autoritaires au cœur de La France insoumise, dressant le portrait d’un mouvement soumis « à une culture viriliste d’intimidation » et frappé de dérives sectaires au nom de l’unité .Cette mise en cause est survenue alors même que la coalition de la gauche radicale — la Nupes, ou plutôt le Nouveau Front populaire — vacillait, minée par des dissensions internes entre socialistes, Verts, communistes et insoumis.
Au centre de ces tensions : une gauche radicale plus préoccupée par la loyauté idéologique, le moral de groupe et la pureté émotionnelle que par l’union populaire. À travers ces luttes intestines — autour de la ligne sur Israël et Palestine, de la discipline interne, de la stratégie vis-à-vis de la Nupes — surgit une réalité : ce n’est pas le peuple qui nourrit ces contemporains de l’hédonisme, mais des militants urbains, médias et ONG, pour qui la radicalité est un marqueur d’identité .
Ces jeunes « croisés du progrès » — sensibles aux injonctions morales, formés à dénoncer et exclure — structurent leur engagement sur le modèle d’une pureté à toute épreuve. Ce ne sont plus des projets collectifs basés sur le conflit social réel, mais des morales performatives, où contester devient suspect, douter devient complice. L’heure est à la reconnaissance émotionnelle, au signal militant. La frontière entre compassion et censure, entre empathie et exclusion, se brouille dangereusement.
Cette mutation idéologique interroge profondément notre époque : face à une civilisation dont ils sont les enfants — non les héritiers —, ces militants entendent liquider l’ordre hérité, non pour construire, mais pour se sentir justes dans la ruine. Il s’agit, ces dernières semaines, de prendre la mesure de ce danger, non comme simple rivalité, mais comme une crise morale au sein de la gauche même.
Il est une maladie de l’âme propre aux sociétés en paix : celle d’enfanter des rêves contre elle-même. Nous vivons dans ces latitudes où le confort matériel a sapé le goût du réel, où les villes – surtout celles qu’enfante la mondialisation comme on enfante des monstres stériles – offrent, dans leurs rues bardées de slogans inclusifs, les signes visibles d’un ordre nouveau, non pas né du peuple, mais éclos dans les serres tièdes des classes bourgeoises culpabilisées. C’est là que s’installent, avec une assurance doctrinale digne des commissaires soviétiques, les nouvelles religions séculières que sont le genre fluide, la cancel culture, le privilège blanc, l’écologie puritaine ou encore l’antisionisme militant.
Quel lien les unit, sinon une commune défiance à l’égard du réel et une haine déclarée de l’Occident ? Non pas l’Occident mythifié de la droite conservatrice, mais l’Occident charnel, issu d’une histoire tragique, traversée de violences et de beautés, de conquêtes et d’échecs, de liberté conquise au prix du sang. Cet Occident que ces idéologies veulent dissoudre, non pour le guérir, mais pour s’en laver, comme on se purifie d’un crime dont on a hérité malgré soi. Le mal serait héréditaire : il faut donc le conjurer dans la langue, les statues, la mémoire, et jusqu’aux pronoms.
Or, ces nouvelles gauches radicales ne viennent pas du peuple. Elles ne s’enracinent pas dans la glaise des provinces ni dans les marges silencieuses où survit encore une forme de bon sens populaire. Elles poussent dans les campus, les rédactions, les ONG et les services de communication des grandes entreprises – ironie des temps postmodernes. Ce sont les enfants tristes de l’hédonisme, nourris de Netflix et de culpabilité postcoloniale, qui les promeuvent. Des enfants souvent uniques, éduqués dans des maisons sans conflits mais saturées d’injonctions morales, où l’amour parental fut une récompense donnée à ceux qui « font bien » : obéir, compatir, pleurer sur commande, dénoncer les mauvaises pensées.
A lire aussi: Le droit d’asile automatique: la France s’ouvre à Gaza
Il ne s’agit pas ici de nier les injustices réelles. Mais de voir combien ces idéologies en ont fait des mythes régénérateurs, au sens archaïque : elles transforment la victime en idole et l’oppresseur en figure maudite. Ce manichéisme affectif, cette morale de cour de récréation élevée au rang d’éthique universelle, rend tout débat impossible. Qui questionne devient suspect. Qui doute devient complice. Le soupçon, vieux poison totalitaire, revient sous des traits enfantins, en baskets militantes, en slogans naïfs.
Sous couvert de compassion, c’est une haine pure qui s’installe : haine de soi, haine des pères, haine de la civilisation dont on est pourtant le produit. Ces jeunes croisés du progrès veulent abattre l’ordre ancien non pas pour en bâtir un autre – ils n’en ont ni le goût, ni le génie – mais pour jouir de sa ruine, pour se sentir justes dans l’anéantissement. Ils ne réforment pas : ils annulent. Ils ne construisent pas : ils dénigrent. Ils ne pensent pas : ils ressentent – et leurs ressentis font loi.
C’est là leur danger. Car sous leur gauchisme bon teint se cache une violence qui ne dit pas son nom. Une violence morale d’abord, puis symbolique, et bientôt physique – comme l’Histoire l’a toujours montré lorsque les utopies s’incarnent. Les mots sont déjà des armes. La censure, déjà une méthode. L’exclusion, une norme. Tout cela au nom du bien. Le fascisme, disait Pasolini, reviendra sous l’apparence du progrès. Il avait vu juste.
Et pourtant, ce n’est pas la foule qui les suit. Les prolétaires – ces figures qu’on invoque sans les entendre – votent désormais pour ceux que ces nouveaux curés excommunient. Ils sentent, confusément, que ces discours de surplomb ne parlent pas d’eux, ni pour eux. L’ouvrier, le paysan, l’artisan, tous savent – eux – que la vie est tragique, et que l’Histoire n’est pas un procès moral, mais un champ de forces. Ils préfèrent les vieilles certitudes aux abstractions vertueuses.
Ce n’est pas un hasard si ces idéologies régressives s’enracinent dans une gauche orpheline d’elle-même, privée d’ouvriers, de syndicats, de partis populaires. Elle s’est réfugiée dans l’universalisme abstrait, dans les minorités, dans les corps, dans les affects, comme on se réfugie dans un sanctuaire après une défaite. Elle croit encore parler au nom du peuple, mais elle ne parle qu’à elle-même, dans un miroir sans tain.
Richard Millet disait qu’il faut écrire contre le monde moderne comme on écrit contre un mal incurable. Il faut aujourd’hui penser contre ces nouvelles gauches comme on pense contre un délire. Car ce qu’elles proposent n’est pas un avenir, mais une stérilité. Elles veulent déconstruire, sans comprendre que la déconstruction n’est pas un projet politique, mais un nihilisme. Ce qui est en jeu, ce n’est pas le progrès, mais la survie de la civilisation.
La Meute: Enquête sur la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon
Price: 22,00 €
25 used & new available from 7,67 €
Price: 23,90 €
12 used & new available from 17,94 €