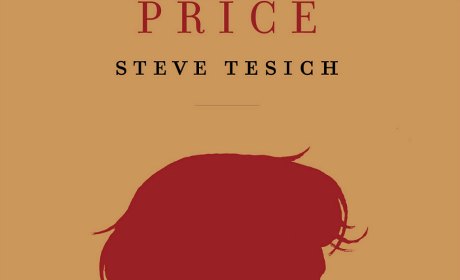La rencontre impromptue du samedi 6 décembre entre les Présidents Hollande et Poutine, lors d’une escale du premier à son retour du Kazakhstan marque peut-être un tournant dans les relations avec la Russie. Ces dernières étaient devenues franchement détestables avec la crise ukrainienne, mais leur détérioration était en réalité bien antérieure à cette crise.
Même s’il ne faut pas trop attendre d’une réunion d’une heure, même si – et l’Elysée a bien tenu à le préciser – il y a eu concertation préalable avec la Chancelière Angela Merkel, il est clair que cette rencontre, organisée à la demande du Président français, constitue une étape importante dans l’amélioration de ces relations. Il faut donc s’en réjouir.
Cette rencontre, pour inattendue qu’elle ait été, n’en était pas moins prévisible. En France, tout d’abord, de nombreuses voix commençaient à se faire entendre pour souligner l’extrême fragilité de notre position, qu’on la considère sur le plan moral, en raison de la révélation progressive tant des crimes de guerre commis par certaines des troupes du gouvernement de Kiev que des conditions réelle de son arrivée au pouvoir, ou politique, avec le risque réel de déboucher sur une nouvelle « guerre froide », ou enfin économique. La France, tout comme l’Italie et l’Allemagne, a beaucoup à perdre avec le maintien des « sanctions ». Le risque de voir la Russie se détourner de l’Europe pour de longues années était bien réel. Bref, il fallait mettre un coup d’arrêt à cette logique profondément destructrice. Un tel point de vue était apparu depuis ces dernières semaines dans les milieux proches du Quai d’Orsay. Dans la conférence de presse commune qu’il avait faite avec le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazerbaev, François Hollande avait largement ménagé, dans ses propos, son homologue russe. Par ailleurs, il ne pouvait pas ne pas mesurer l’incohérence d’une position qui amène la France à avoir des bonnes relations avec des pays avec lesquels les causes de conflits, qu’elles soient latentes ou explicites, sont bien plus importantes qu’avec la Russie. Ceci a été dit et répété. Tout ceci rendait nécessaire une initiative forte de la diplomatie française sur ce dossier. La visite du président François Hollande au Kazakhstan fournissait l’occasion. Elle fut donc saisie. Mais, il convient ici de rappeler que François Hollande était demandeur.
Il n’en reste pas moins qu’il ne faut pas trop en attendre. Assurément, toutes les conditions pour la « désescalade » sont réunies. On a déjà noté la déclaration du Commandant en Chef des forces de l’OTAN, le général Breedlove, qui déclarait le 26 novembre dernier à Kiev qu’il n’y avait pas de troupes de combat russes dans le Donbass. Par ailleurs, un nouvel accord de cessez-le-feu entrera en vigueur le 9 décembre entre les troupes de Kiev et celles des insurgés. De plus, avec l’arrivée de l’hiver, un certain sens des réalités va s’imposer à Kiev. Des accords économiques ont d’ailleurs été signés, tant avec la Russie qu’avec les insurgés du Donbass. C’est dans ce contexte qu’il faut replacer la décision de Kiev de suspendre tous les salaires et tous les versements sociaux à la population du Donbass. Pour scandaleuse que puisse paraître cette mesure, il faut aussi comprendre qu’elle signifie une reconnaissance de fait que la partie insurgée n’est plus l’Ukraine. En un sens, c’est aussi une décision qui va vers une stabilisation de la situation.
On peut donc s’attendre à ce que tant l’OTAN que les Russes, comprenant que cette crise les entrainait dans une spirale dont ils pouvaient à tout instant perdre le contrôle, trouvent un intérêt commun à faire descendre la tension. Il est tout aussi certain que tel est bien l’intérêt de la France, et ceci est compris par François Hollande. Outre la pression des industriels, qui va bien au-delà de la question de la livraison des deux BPC de classe « Mistral », il conçoit que cette tension est délétère pour l’ensemble du continent.
Il n’en reste pas moins que la position de la France n’est plus aujourd’hui celle qu’elle avait dans les années 1960 et 1970. D’une part, la France a réintégré le commandement intégré des forces de l’OTAN. Cet acte nous lie bien plus étroitement que par le passé à la politique des États-Unis. D’autre part, l’existence de l’Union européenne, mais aussi le parti-pris très européiste de François Hollande, viennent limiter l’autonomie de la politique étrangère française. On sait qu’au sein de l’UE, un groupe de pays donne dans une véritable hystérie anti-russe, comme la Pologne, la Suède et les Pays Baltes. Cette hystérie est largement partagée au Parlement européen. D’autres pays, tels la Hongrie, la Slovaquie ou la Bulgarie, ont des positions bien plus compréhensives quant il s’agit de la Russie. Enfin, de ce point de vue, l’Allemagne, la France et l’Italie ont toujours adopté une attitude médiane, qui s’explique tant par leur histoire que par l’étendue de leurs relations économiques avec la Russie. Il faut comprendre que les tensions internes à l’UE étaient en train d’atteindre un point de rupture. La décision de la Russie d’annuler le projet « South Stream », prise ces derniers jours, constituait un avertissement très clair. La Russie signifiait par ce geste une préférence pour des livraisons de gaz à l’Asie (Chine, mais aussi Corée du Sud et Japon). Il est clair que, dans les motivations qui ont poussé François Hollande à demander cette rencontre à Vladimir Poutine, il y a aussi la volonté d’éviter que cette crise, si elle continuait à monter en agressivité, ne provoque des déchirements irrémédiables dans l’UE. Aussi, rien ne serait plus faux que de voir en François Hollande un « continuateur » de la politique du Général de Gaulle. Sa démarche s’inscrit dans la ligne européiste et atlantiste qui est la sienne.
Il faut maintenant considérer quels pourraient être les débouchés de cette rencontre. La situation au Donbass peut se stabiliser, si Kiev est décidé à jouer le jeu du cessez-le-feu. Mais la solution de la « fédéralisation » de l’Ukraine, telle qu’elle est officiellement défendue par la Russie, n’apparaît pas réellement applicable. Cette solution eût été possible en juin 2014, avant les combats de la fin juin au début du mois de septembre. D’ailleurs, dans certaines vidéos, on sent bien qu’au-delà de leurs divergences il y a bien le sentiment tant des militaires ukrainiens que des insurgés d’appartenir à la même Nation. Mais, aujourd’hui, il est à craindre qu’il n’y ait trop de haines inexpiables. Au mieux, la « fédéralisation » pourrait prendre la forme d’une région autonome de l’Ukraine, sur le modèle du Kurdistan comme région autonome (et de fait quasi-indépendante) de l’Irak. L’autre solution est celle d’une indépendance non-reconnue, comme c’est le cas en Abkhazie ou en Ossétie du Sud. Un point important est ici celui de la monnaie. Si Kiev maintient son blocus monétaire, les responsables de Donetsk et Lougansk n’auront le choix qu’entre imprimer leur propre monnaie ou adopter le rouble russe. Dans tous les cas, ceci rendra encore plus difficile la perspective d’une future réunification de l’Ukraine.
Dans le reste de l’Ukraine, une fois l’émotion nationaliste passée, il faudra se rendre à l’évidence : le pays n’intègrera pas l’UE avant au moins vingt ans, et peut-être plus, et ne sera pas membre de l’OTAN. Les dirigeants ukrainiens ne veulent pas l’admettre alors que c’est une évidence, répétée par l’ensemble de leurs interlocuteurs officiels. Que se passera-t-il quand la population comprendra que le rêve d’une adhésion rapide à l’UE, si tant est que ce soit un « rêve », ne se réalisera pas ? Qu’à la place, elle aura affaire aux sbires de la Troïka et du FMI, et à une austérité meurtrière ainsi qu’à une destruction de toutes ses conquêtes sociales ? Dans ce contexte, tout devient possible, du retour vers la Russie à des demandes locales de rejoindre des pays de l’UE (la Galicie vers la Pologne, et la Ruthénie vers la Hongrie), qui signifieraient l’éclatement pur et simple du pays.
La rencontre entre les Présidents Hollande et Poutine a été un pas en direction d’une meilleure compréhension réciproque. Mais, le chemin pour désamorcer la défiance qui s’est accumulée des deux côtés sera long tant sont importants et durables les griefs. Il faut comprendre que la crise ukrainienne a cristallisé plus qu’elle n’a créé ces griefs qui se sont accumulés, surtout du côté russe, depuis 1998. Que l’on se souvienne de l’affaire du Kosovo, de l’intervention des parachutistes russes à Pristina, ou de la décision américaine d’envahir l’Irak en 2003. Si l’on veut rétablir la confiance il faudra mettre toutes ces questions sur la table. Pour cela une conférence, sur le modèle de celle qui se tint à Helsinki en 1975, s’impose. La conférence historique CSCE (ou Conference on Security and Cooperation in Europe) fut en effet une étape majeure dans le rétablissement d’un véritable dialogue entre les pays du Pacte de Varsovie et l’OTAN. Mais, cette fois, le dialogue devra être limité aux seuls pays européens, ce qui revient à en exclure les États-Unis et le Canada. J’ai déjà présenté l’idée de cette conférence dans une table ronde organisée par la Douma à Moscou, le 25 novembre. J’en rappelle ici les thèmes qui me semblent importants. Il y en a trois :
- Définir les règles qui permettent de gérer la contradiction existant entre les principes westphaliens et ceux nés des Lumières et de la Révolution française de 1789. La souveraineté de l’État demeure la pierre de touche de toutes les relations internationales, mais aussi de la démocratie à l’intérieur de chaque État. Mais, certains principes comme le droit de décider de son propre futur et la nécessité de protéger les populations ont acquis une importance grandissante. La question est de savoir comment ces principes contradictoires peuvent se réconcilier avec le moins d’ambiguïté possible. Il n’est plus possible de voir les règles internationales subverties comme on le vit au Kosovo pour ensuite entendre les pays de l’UE proclamer leur attachement indéfectible à ces mêmes règles.
- Définir les règles de la sécurité collective, mais aussi du possible emploi de la force militaire, en Europe et dans sa périphérie. Le traité CFE est mort mais il nous faut un autre traité. Il doit inclure des règles sur l’utilisation légitime de la force militaire, là encore avec le moins d’ambiguïté possible. L’idée d’un monde où nulle force militaire ne serait nécessaire n’est pas aujourd’hui réaliste. Ce traité permettrait de résoudre des situations comme celles de la Libye en 2011 ou celle qui est en train de se développer à la frontière entre la Syrie et l’Irak, ou encore celle qui se développe en Afrique sub-sahélienne où la France intervient militairement depuis janvier 2013.
- Définir les règles de la coopération économique, scientifique et culturelle. La coopération est nécessaire non seulement entre les États mais aussi entre des régions constituées de différents États. Nous devons trouver des règles communes gouvernant cette coopération sans mettre en danger le principe de souveraineté tel qu’il est définit dans le premier point. Le problème principal est ici d’atteindre la coopération et non de désigner d’en-haut quelque nouvel État “supranational” sous un quelconque travesti économique ou social.
Ce programme est ambitieux, mais il est le seul qui puisse permettre de reconstruire une véritable confiance qui est nécessaire si nous voulons réellement dépasser la situation actuelle. Cependant, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que meurent certains comportements et certains discours. Le premier est la prétention des pays de l’Union Européenne de vouloir représenter l’Europe et en même temps d’être les porteurs des plus hautes valeurs morales. C’est ce que l’on peut appeler « l’exceptionnalisme » européen, tout aussi nocif que l’exceptionnalisme américain. Il faut se souvenir que l’Europe n’est pas l’UE. Ceci est vrai au sens géographique, au sens culturel et aussi dans un sens politique. Les discours au sujet des “valeurs européennes” que l’on entend dans différentes capitales ne servent en fait qu’à établir une nouvelle barrière idéologique à la coopération. Non que le développement des institutions de l’UE n’ait donné lieu à des débats vigoureux et importants. Mais revendiquer une position dominante en ce qui concerne les “valeurs morales” est ici sans fondement et est en fait autodestructeur. Les pays de l’UE ont à plusieurs reprises manqué à leurs prétendus “principes,” que ce soit dans les affaires internationales comme avec le Kosovo et plus tard avec la participation de certains pays de l’UE (comme la Pologne) dans la guerre d’agression des États-Unis contre l’Iraq en 2003, ainsi que dans leurs affaires intérieures.
Il faudra donc que l’Union européenne fasse preuve d’humilité et de raison si elle veut aboutir à une véritable confiance avec la Russie.
*Photo : Alexei Druzhinin/AP/SIPA. AP21663523_000024.