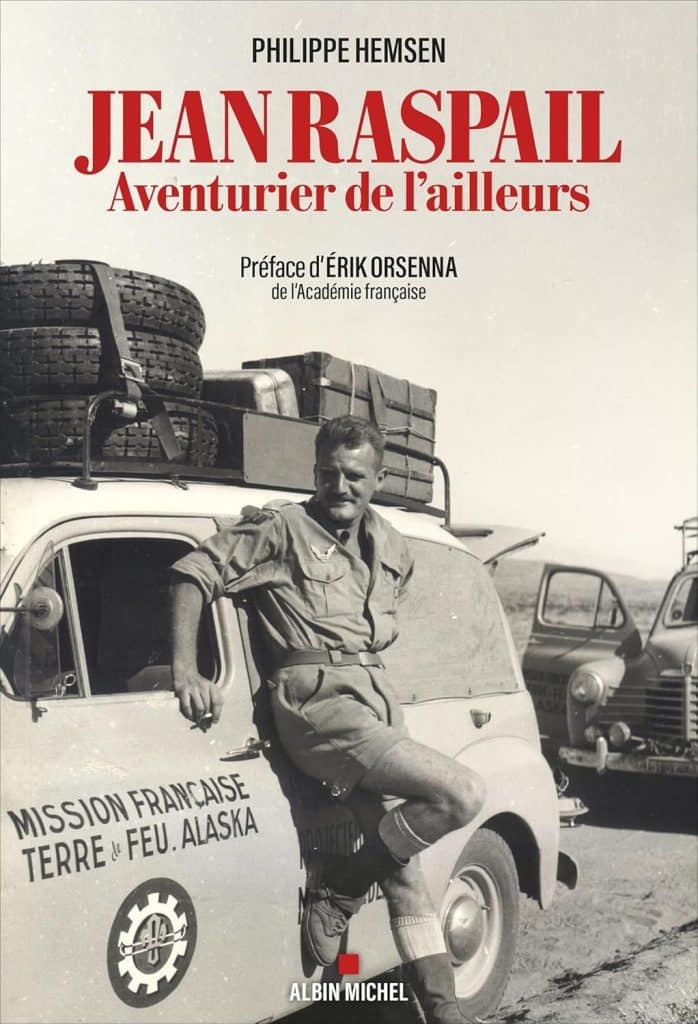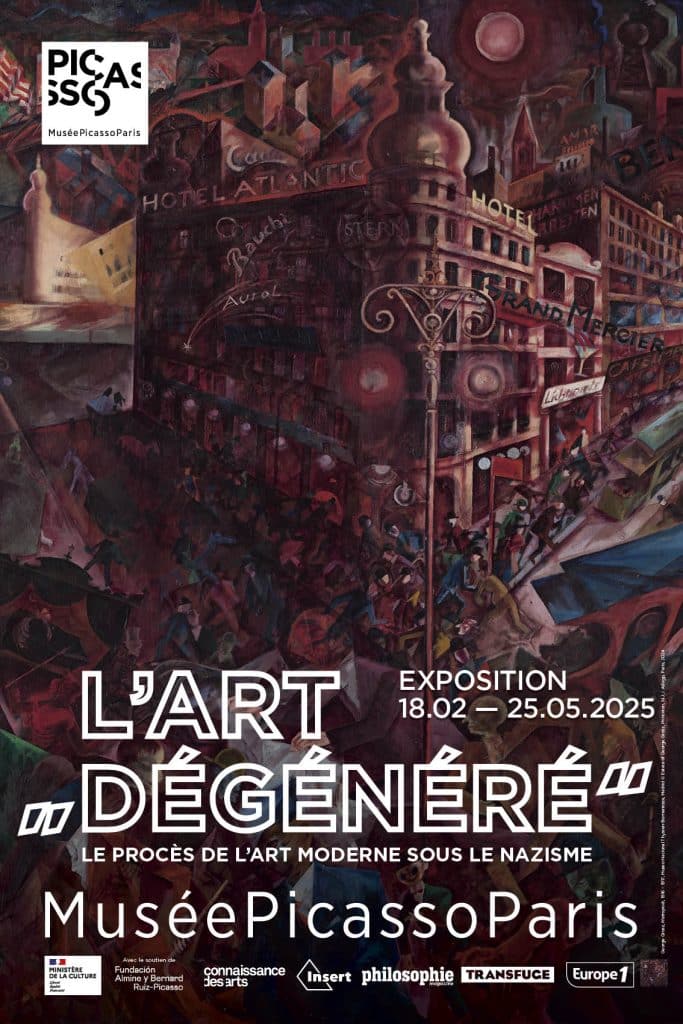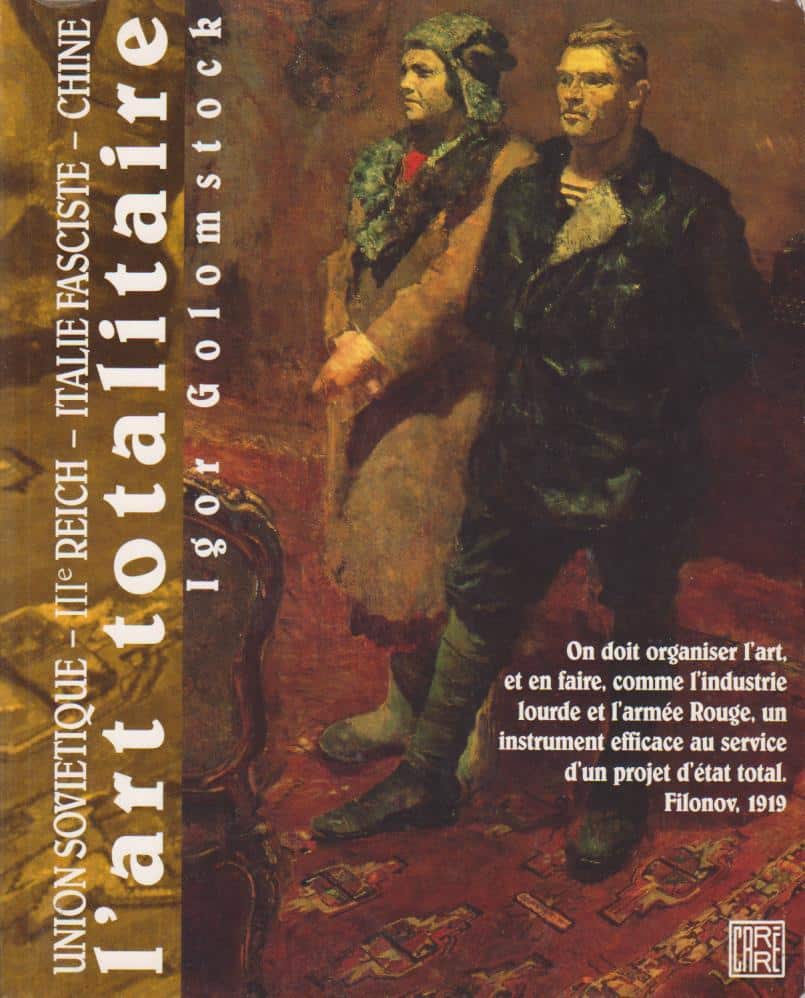Un film politique décapant, deux Cocteau réussis et une comédie française: en mai aussi, le cinéma fait ce qui lui plaît !
Au fond de la piscine
Libertate, de Tudor Giurgiu
Sortie le 21 mai
Décembre 1989. La révolution roumaine a débuté et la ville de Sibiu, en Transylvanie, est le théâtre de terribles affrontements. Les policiers et miliciens fidèles à Ceausescu sont arrêtés et rassemblés dans le bassin vide d’une piscine communale désaffectée. Mais comment savoir qui est qui dans un tel chaos ? Tel est le point de départ du film du cinéaste roumain Tudor Giurgiu, explicitement titré Libertate. S’il s’agit bel et bien d’une œuvre de fiction au casting d’ailleurs impeccable, elle s’inspire ouvertement de faits réels durant lesquels 552 hommes ont été pris au piège d’une situation politique en pleine ébullition. Nicu, le propre fils de Ceausescu, occupe alors les fonctions de premier secrétaire du parti du dictateur au pouvoir. C’est lui qui demande que les unités militaires se mobilisent et se préparent au combat. C’est lui encore qui commande à la milice locale d’intervenir et de disperser les manifestants massés sur la place de la République de la ville de Sibiu. Le bilan de cet épisode tragique est de 99 morts et 272 blessés.
Réalisé avec un budget plus que limité, le film a été écrit en étroite collaboration avec des historiens et des sociologues pour garantir la vraisemblance du propos. Les acteurs ont quant à eux pu rencontrer certains protagonistes de cette incroyable histoire. Le cinéaste ne cache pas son implication profonde, lui qui avait 18 ans au moment des faits : « La vérité a été volontairement déguisée, explique-t-il, et le blanchiment des faits a été cultivé pour devenir un art en soi. » Et d’ajouter à ce tableau : « Ma génération a grandi avec cette psychose des terroristes : c’étaient supposément des Arabes, puis des espions russes, puis des officiers de la Securitate, et ainsi de suite. » Comme le montre le film, la radio et la télévision ont joué un rôle central dans cette désinformation attribuant à de prétendus « terroristes » de nombreux morts innocents. Inventée de toutes pièces, cette cinquième colonne a justifié le recours à l’armée et la répression des manifestations. La grande force du film est de s’emparer de cette matière historique désormais incontestable pour en montrer les arcanes et les rebondissements successifs. Chaque protagoniste incarne une facette de cette diversité de situations : on passe de l’ombre à la lumière en un instant, la victime devient bourreau, l’innocent coupable et inversement. À l’instar du personnage de Viorel, un officier de la Militia (les forces de police de la Roumanie communiste) qui n’est en rien impliqué dans la répression violente des manifestations de rue, mais qui se trouve pris dans ce maelström. En proie au doute, il découvre finalement n’être qu’un pion manipulé.
Pour rendre cette atmosphère si particulière, Tudor Giurgiu a fait le choix intelligent de la caméra à l’épaule et du style direct. Il filme presque un « vrai-faux » documentaire et ses images prennent la couleur de l’immédiateté et du réalisme. On se sent au plus près de ces hommes parqués au fond du bassin, coincés comme des rats de laboratoire. À cette approche documentaire revendiquée, le cinéaste ajoute fort brillamment une part de romanesque. Dans cette piscine en forme de prison à ciel ouvert, chacun joue son destin et parfois même sa vie. Ainsi suit-on les interrogations permanentes des uns et des autres, l’incertitude qui les ronge. Le film joue sur ce suspense qui apporte une incroyable efficacité narrative. Ce qui pourrait n’être que le récit d’un fait historique devient une histoire policière à tous les sens du terme.
Au fond du miroir
Le Sang d’un poète et L’Aigle à deux têtes, de Jean Cocteau
Sortie le 21 mai

On se réjouit de la ressortie en salles et en copies (bien) restaurées de deux films réalisés par Jean Cocteau : Le Sang d’un poète (1932) et L’Aigle à deux têtes (1948). Certes, l’écrivain-cinéaste ne saurait rivaliser avec les grands auteurs de cet âge d’or du cinéma français, mais ces deux œuvres méritent d’être redécouvertes. Premier film de Cocteau, Le Sang d’un poète prend la forme d’un rêve que son auteur ne voulait pas « surréaliste », contrairement à son grand rival de l’époque, Buñuel et son Âge d’or. Des images restent cependant gravées à jamais, telle la plongée dans un miroir… et c’est bien l’objet de ce film. Quant à L’Aigle à deux têtes, il est l’adaptation par lui-même de sa propre pièce, d’après le destin de Louis II de Bavière, le « roi fou ». Cocteau explore les circonstances mystérieuses de la mort non élucidée du monarque. Pour Edwige Feuillère comme pour Jean Marais, il s’agit de deux rôles clés dans leurs carrières respectives.
Au fond du tiroir
Les Règles de l’art, de Dominique Baumard
Sortie le 30 avril
Quel dommage ! Voilà ce que l’on ne peut s’empêcher de s’écrier en sortant de la projection des Règles de l’art, cette comédie française de braquage et d’escroquerie platement écrite et réalisée par Dominique Baumard, avec Melvil Poupaud dans le rôle principal. Dommage vraiment d’avoir ainsi massacré l’histoire vraie d’un spectaculaire vol de tableaux de maître au musée d’Art moderne de la Ville de Paris. Il aurait fallu l’allant d’un Rappeneau, d’un Deville ou d’un Broca pour camper ce trio de pieds nickelés géniaux. Or, l’histoire ne décolle jamais, même au moment du vol en pleine nuit, alors que le système d’alarme est défaillant. L’art difficile de la comédie exige que tout soit crédible, même le plus roublard ou le plus imbécile des escrocs. Ce n’est qu’à cette condition qu’on se laisse embarquer avec le plus grand plaisir. Ici rien de tel, sinon un beau gâchis qui ne fait même pas rire ou sourire.