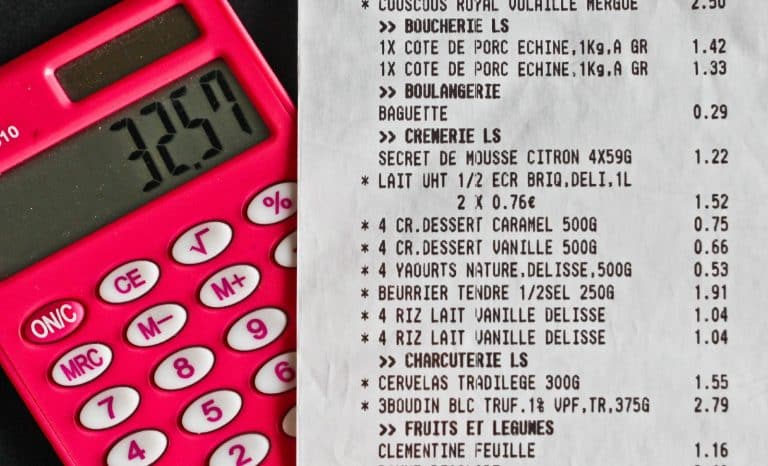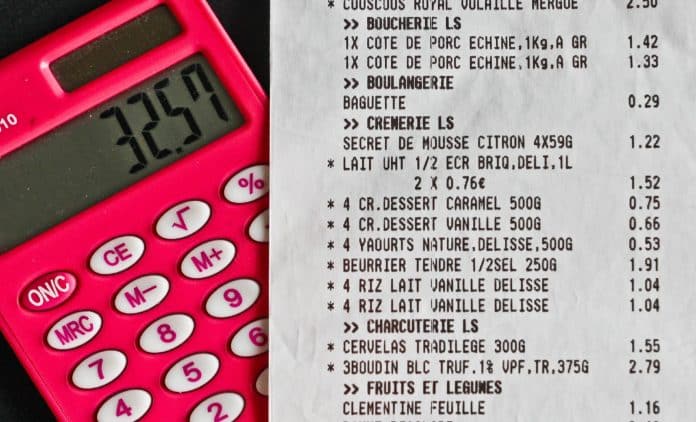Le ministre de l’Éducation nationale a annoncé, à la fin du mois de juin 2023, que l’éducation à la sexualité va désormais faire partie des programmes d’instruction dispensée au même titre que n’importe quelle matière scolaire[1]. Interview avec la psychologue Ariane Bilheran.
Cette annonce est l’occasion de s’attarder sur le fait que l’éducation sexuelle dispensée auprès des jeunes, tout en donnant les informations pour éviter les MST et les grossesses non désirées, promeut l’activité sexuelle [« tu as le droit de faire l’amour à l’âge que tu veux »[2]], du moment que « tous les protagonistes sont d’accord », autrement dit dès lors qu’ils sont « consentants ». Cette notion de consentement est aujourd’hui le prisme de référence de l’éducation à la sexualité dans la sphère scolaire[3].
En droit, l’incapacité d’un enfant de moins de 15 ans à donner quelque consentement que ce soit à un acte sexuel avec un adulte, a été reconnue par la loi[4]. En revanche, lorsqu’il s’agit d’actes commis par des mineurs entre eux, la qualification des actes dépend toujours du fait de savoir si l’acte a été « consenti » ou non.
Les parents, les éducateurs, les juristes sont bien embarrassés : l’enfant, puis l’adolescent, ont-ils vraiment l’aptitude à donner un consentement en connaissance de cause à des actes sexuels, y compris entre eux ? Les préjudices physiques et psychologiques résultant de tels actes, reconnus dans un cadre judiciaire chez les enfants ou adolescents, ne révèlent-ils pas la nécessité de tenir compte du fait que l’enfance n’est pas le temps de la sexualité, et de prendre les enfants pour ce qu’ils sont, des enfants, et non de petits adultes ?
Nous en parlons avec Ariane Bilheran, normalienne (Ulm), philosophe, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, auteur de nombreux ouvrages dont Psychopathologie de la pédophilie (Dunod, 2013, 2ème éd. 2019) et L’Imposture des droits sexuels paru en 2017, qui en est aujourd’hui à sa 5ème édition.
Causeur. Quelles sont les capacités requises pour pouvoir donner un consentement, en général, et en matière sexuelle en particulier ?
Ariane Bilheran. La notion de consentement ne peut être dissociée de différents critères : maturité intellectuelle (aptitudes à se représenter et à comprendre), maturité émotionnelle (aptitude à une sécurité intérieure suffisante, à l’altérité), maturité physique/biologique. Le consentement suppose la conscience des actes et de leurs conséquences, et cette conscience ne peut pas s’acquérir sur la simple délivrance d’une « information ». Il faut encore que le psychisme soit capable de traiter cette information. Par exemple, un enfant avant la puberté n’est pas du tout capable de comprendre des informations concernant la sexualité des adultes : ces informations sont même de nature à faire effraction dans sa vie psychique et dans la construction de son imaginaire (garantie du développement de la sécurité intérieure), en clair, de nature à le traumatiser psychiquement.
Ce n’est qu’à partir d’une conscience pleine et entière de ses actes, que l’on peut en assumer une responsabilité. La conscience et la responsabilité des actes relèvent d’un psychisme ayant acquis une maturité adulte, c’est-à-dire la capacité de faire des choix éclairés, à partir d’une liberté de pensée suffisante.
Le consentement suppose la possibilité de refuser sans conséquence, et exclut toute manipulation déguisée, sinon il est contraint (la contrainte peut être même dissimulée, par exemple : faire un acte pour plaire au groupe, ne pas en être exclu, etc.).
A lire aussi : Eloge du plaisir
De plus, le consentement ne peut être valide lorsqu’une autorité exerce un pouvoir (symbolique et/ou réel et/ou imaginaire, jusqu’à l’emprise) de nature à influencer ce consentement. Il ne peut pas non plus être valide dans des cas de vulnérabilité et d’absence d’autonomie : c’est bien là que l’enfant ne saurait jamais être consentant. Par définition, un enfant n’a pas de consentement, puisqu’il n’a pas terminé son développement psychique. Il n’a pas acquis les prérequis permettant d’exercer un discernement. Par sa nature propre d’enfant, il n’est pas autonome, et a besoin d’être protégé par des adultes. Le Droit pénal a toujours, dans le passé, distingué la nature d’enfant de celle de l’adulte : l’absence de conscience et donc d’autonomie chez l’enfant implique sa protection, et n’entraîne pas le même équilibre de droits et de devoirs qu’engendre le statut d’adulte, lequel a terminé son développement psycho-affectif et intellectuel.
Il n’existe pas non plus de consentement supposé sur des pratiques dont on sait qu’elles sont dommageables : le simple fait qu’elles soient dommageables annule le consentement. D’ailleurs, si l’on a acquis suffisamment de discernement, il est peu probable que l’individu choisisse des actes créant un dommage contre lui-même.
Enfin, j’ai envie de rappeler que pour émettre un consentement, il faut aussi des prérequis, comme des outils langagiers, la capacité de verbaliser, permettant d’accéder à des représentations mentales (capacité d’expression suffisante), une aptitude à raisonner.
En somme, la capacité juridique à consentir doit s’appuyer sur l’achèvement de la maturation du développement psychique. Ainsi, les enfants, les personnes déficientes mentales, les individus présentant de graves troubles psychiques, ou encore, sous l’influence de drogue, d’alcool et de psychotropes, ou en situation de vulnérabilité (traumatismes graves, manipulation, harcèlement, etc.) ne sont pas en situation de consentir à quoi que ce soit.
Cette capacité pour les adultes doit donc s’apprécier au cas par cas.
Pour les enfants, il n’y a pas de consentement.
En matière de sexualité, la question du discernement est encore plus cruciale, car la sexualité relève du domaine de l’intime, et par conséquent, est le lieu des traumatismes psychiques les plus lourds, en particulier sur des psychismes en développement et/ou vulnérables, surtout lorsqu’ils sont pris dans des situations d’abus d’autorité, de menaces, de pressions, d’extorsions, de promesses, de chantage, de prosélytisme, etc. La protection pénale de l’intégrité des individus n’est pas négociable.
Pour récapituler, trois critères sont conjointement indispensables à l’obtention d’un consentement : le consentement doit être libre (et ne doit donc subir aucune forme de contrainte même déguisée), éclairé (la personne doit avoir reçu l’information suffisante et être en capacité psychique de la traiter), et l’individu doit être un sujet apte sur le plan psychologique et juridique, donc avoir achevé son développement psychique.
On admet assez facilement que l’enfant ne puisse donner un consentement à un acte avec un adulte. Est-il en revanche possible de parler de consentement des enfants, ou des adolescents, entre eux ?
En vertu de ce que je viens d’expliquer, les enfants ne peuvent pas avoir de consentement en matière de sexualité. Pour les adolescents, il faut juger au cas par cas, selon le niveau de maturité psychique, émotionnelle et intellectuelle, qui détermine un niveau de conscience, et selon la situation (égalitaire ou non, possible détournement par situation d’emprise ou exercice d’une autorité symbolique et/ou réelle, etc.). Chez l’adolescent, le consentement ne peut donc être toujours que partiel.
On a fixé de principe un âge de majorité sexuelle, supposé permettre de délimiter un consentement plus majoritaire que minoritaire, mais il ne saurait jamais être total, et suppose une relation égalitaire, au même niveau de maturation psychique, pour être valable (écarter toute forme de pression, consciente ou non, de conflit de loyauté, d’emprise ou d’autorité exercée sur le sujet de manière par principe inégalitaire).
Vous dites que l’enfant n’a pas de sexualité. Que voulez-vous dire par là ?
La psychologie du développement indique bien que l’enfant n’a pas de sexualité, et encore moins, de sexualité à la manière des adultes. Il ne faut pas confondre la sensorialité, que cherche précisément à développer l’enfant pour s’inscrire dans la finitude de son propre corps, y trouver une sécurité émotionnelle, et pour assimiler le monde qui l’entoure, avec une sensualité, ou encore, une quelconque sexualité. Lorsque l’enfant explore son corps, il ne l’explore pas pour « se masturber » par exemple, mais il explore ses organes génitaux comme il explore ses oreilles, les parties chatouilleuses, etc. Il n’y a pas de connotation sexuelle. À tel point qu’un enfant qui présenterait des signes de sexualisation précoce est toujours l’indicateur, pour des expertises psychologiques en milieu judiciaire, d’un problème. Car un enfant transgressé devient sexualisé, et peut développer des traits que l’on retrouve chez des adultes pervers, puisqu’il ne fait que répondre à des demandes d’adultes pédophiles qui l’ont initié à cette sexualité. Nous avons développé ce point avec ma collègue Amandine Lafargue dans notre livre Psychopathologie de la pédophilie, paru en 2013 chez Dunod, et qui en est à sa deuxième édition. Le Dr Régis Brunod, pédiatre et pédopsychiatre, explique bien les confusions idéologiques actuelles dans son livre Préserver l’innocence des enfants, paru aux éditions Le Bien Commun.
A lire aussi : Une société addictogène
Le développement psychique de l’enfant est un long processus qui permet de construire des interdits fondamentaux, qui seront garants de son insertion dans une civilisation régie par des lois et des principes moraux. Ces principes moraux ne sont pas négociables, ils sont la jonction de toute société humaine comme nous l’a définie l’anthropologie de Claude Lévi-Strauss, de Maurice Godelier ou d’André Leroi-Gourhan : interdits du meurtre et de l’inceste, notamment. Tout le rôle de l’éducation est de conduire l’enfant à déployer un équilibre psychique entre le principe de plaisir (ses désirs, ses envies, etc.), et le principe de réalité (les conditions de faisabilité et de réalisation de ces désirs, voire d’interdit : si tu as envie de voler le jouet du copain, tu ne le feras pas).
Si l’enfant n’a pas de sexualité, qu’en est-il de l’adolescent ? On imagine que la puberté est un seuil clé en matière de sexualité, mais un enfant pubère est-il de ce fait capable de « consentir » ?
La pulsion sexuelle émerge avec les hormones et la puberté. Mais l’émergence de la puberté sur un plan biologique ne signifie pour autant pas que l’adolescent ait achevé sa maturité émotionnelle, intellectuelle et psychique, ni qu’il soit pleinement conscient de tous ses actes. Théoriquement, la conscience et le sens de la responsabilité des actes (et donc, le consentement) augmenteront à mesure que l’adolescent s’approchera de l’âge adulte ; cette maturation s’achève en moyenne entre 18 et 25 ans, selon les individus. Certains ne « grandissent » jamais suffisamment, comme des profils qui se structurent par exemple sur un mode pervers ou paranoïaque.
Les jeunes sont parfois blessés par des actes sexuels (avec d’autres jeunes) auxquels ils ont pourtant donné leur accord. Comment analysez-vous cela ?
Il faut examiner dans quelles conditions a été obtenu ce supposé « accord » à être blessé. On sait que les adolescents sont très sensibles à la socialisation, à l’acceptation au sein d’un groupe. Ils sont aussi très vulnérables au regard qu’autrui porte sur eux, et peuvent aisément être influencés pour ne pas être isolés du groupe, ou harcelés par lui. Ce sont des techniques d’influence dans des groupes que j’ai appelés « régressés », qui fonctionnent avec des pratiques harceleuses, et les adultes doivent avoir un regard très vigilant sur ce qui se passe entre adolescents dans des concours morbides ou mortifères parfois extrêmement dangereux et préjudiciables à leur santé psychique et physique.
L’éducation sexuelle dispensée auprès des jeunes promeut la liberté sexuelle, du moment que « tous les protagonistes sont d’accord ». Dès lors que cet « accord », autrement dit ce consentement, est illusoire chez les enfants, faut-il donc inverser le discours éducatif et recommander aux jeunes de ne pas avoir d’activité sexuelle ?
La sexualité n’est pas un acte banal. Elle engage la totalité de l’être, dans sa dimension la plus intime. C’est, précisément, parce que c’est le lieu de l’intime, de la plus grande libération intérieure comme de la plus grande souillure traumatique, qu’il convient de se respecter et de ne pas faire n’importe quoi. « Sexe sans conscience n’est que ruine de l’âme » pourrais-je dire, en paraphrasant Rabelais.
La sexualité est traumatique en deçà de la puberté, comme j’ai pu l’expliquer du point de vue du développement psychique de l’enfant, puisque ce dernier n’a pas les aptitudes d’y faire face. Ceci n’est pas nouveau, nous avons de nombreux travaux en psychologie classique, et notamment en psychologie du développement, sur le sujet.
A lire aussi : Marie Laforêt, la douceur tragique
Pour avoir une sexualité épanouie à l’âge adulte, il faut ne pas avoir brûlé les étapes du développement sensoriel dans l’enfance, avoir construit un imaginaire, une sécurité affective, des représentations, une tendresse suffisants pour devenir apte à cette sexualité complète, amoureuse, érotique et épanouie, loin de la sexualité mécanique, marchande et pornographique que nous vendent certains « programmes » de cette « éducation à la sexualité », où la sexualité est réduite à quelques positions et des bouchages de trous.
Concernant cette incitation à une sexualité sans conscience, tous azimuts, il est important de ne pas confondre une liberté de choisir une relation épanouissante et amoureuse, qui donnera accès à une sexualité heureuse, profonde et érotique, avec coucher sans conscience avec le premier/la première venue, ce qui engendrera des traumatismes qui grèveront parfois définitivement l’accès à une sexualité heureuse.
Quelles pistes pourriez-vous suggérer aux éducateurs, ou aux juristes, pour préserver les enfants comme les adolescents des violences sexuelles qu’ils s’infligent entre eux ?
En quelques mots : apprentissage de la pudeur, de l’intégrité, de l’intimité, des interdits (ex. : on n’a pas le droit de te toucher ni de te montrer des photographies/des vidéos, sans l’accord de tes parents), prodiguer des conseils de bon sens (ex. : si tu sens quelque chose de bizarre, tu sors de la situation, tu cries, tu viens chercher tel adulte de référence, etc.). Je recommande aussi aux parents d’avoir une observation fine et d’exercer une surveillance appropriée des enfants et des adolescents. Enfin, il faut l’interdiction de l’accès aux écrans seuls pour les enfants, et être très vigilants concernant le temps et l’accès aux écrans pour les adolescents.
[1] https://www.education.gouv.fr/education-la-sexualite-le-ministre-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-pap-ndiaye-annonce-l-378596
[2] https://www.onsexprime.fr/vos-questions/les-premieres-fois#1231
[3] Voir par exemple la page « consentement » sur le site https://www.onsexprime.fr/la-sexualite/ok-ou-pas-ok/ok-pas-ok-le-consentement-c-est-obligatoire