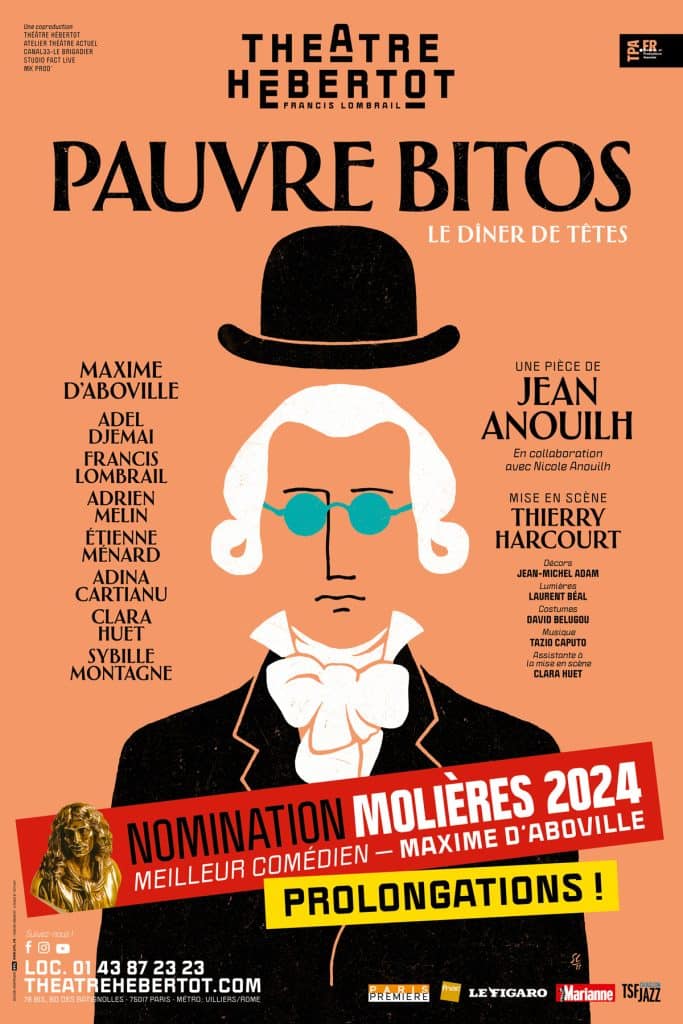L’équipe du député LFI François Ruffin a commandé un sondage dans lequel il apparait nettement mieux placé que Mélenchon si la gauche s’unit à la prochaine présidentielle. Il ferait même jeu égal face à Marine Le Pen au second tour, alors que le vieux chef se fait bananer. Mais de la à y voir la fin de Mélenchon, actuellement en campagne pour les européennes sur le thème unique de Gaza…
Cette fois, l’étincelle qui pourrait bien mettre le feu aux poudres prend la forme d’un sondage. En l’occurrence celui effectué du 2 au 5 avril par l’institut Cluster 17 pour le compte de Picardie Debout, le mouvement du député de la Somme François Ruffin, enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1700 personnes représentatif, selon la formule consacrée, de l’ensemble du corps électoral. Il s’agissait d’évaluer les intentions de vote pour les élections présidentielles de 2027 dans le cadre d’une candidature unique de la gauche (hors NPA). Bien entendu, ce sondage, dont on peut penser qu’il aurait dû demeurer confidentiel, a « fuité ». Il faut dire que ses résultats sont tellement favorables au chef de file du mouvement en question qu’on voit mal comment ses commanditaires auraient pu résister à la tentation de leur donner un maximum de publicité.
Mélenchon largement distancé
Qu’on en juge ! Dans le cadre donc d’une candidature unique de la gauche aux prochaines présidentielles, François Ruffin ferait grandement mieux que le leader historique des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon. Plus encore, il le renverrait à ses chères études. Premier tour : Ruffin candidat de cette gauche unie (le rêve n’étant jamais interdit, même en matière de sondage) rassemblerait sur son nom 29% des suffrages, juste un point de moins que Marine Le Pen et quatre de plus qu’Edouard Philippe, tous deux retenus comme hypothèse de candidature dans la présente étude. Cela alors même que Mélenchon candidat ne glanerait que 18% des votes. Donc, largement derrière Marine Le Pen (32%) et Edouard Philippe (31%). Exclu sans appel du second tour, le sieur Mélenchon. (Et quand bien même parviendrait-il à s’y hisser, il s’y vautrerait lamentablement avec un petit 35%.) Une apocalyptique Bérézina qui, humiliation cauchemardesque pour lui-même et son camp, supposerait une Marine Le Pen élue présidente de la République avec quelque 65% des suffrages.
Un commentaire plus que tout autre donne la mesure du camouflet infligé par ce sondage au chef de la France Insoumise. « Il n’est plus l’évidence ».
A lire aussi: Jordan Bardella: «Je suis l’enfant de la génération 2005-2015»
On imagine sans difficulté la colère – tonitruante ou sourde, qu’importe – de l’intéressé recevant cette claque en pleine face. « Moi, Mélenchon 1er, je ne serais plus l’évidence ! Comment cela se peut-il ! Il y aurait une alternative à ma personne ? Ruffin le rufian de Picardie, ce journaleux de rencontre, serait en mesure de me tailler des croupières. À moi à qui il doit tout. Tous, d’ailleurs, me doivent tout ! Aux armes citoyens ! Sauvons la Patrie et mes miches en grand danger! » Certes, on se représente la scène, le coup de grisou force 10.
Cela dit, on s’imagine tout aussi bien la suite.
Mélenchon veut la 6e République, mais pour la démocratie interne on peut attendre
Pour un mouvement politique tel que celui de M. Mélenchon, relevant de la tradition de la gauche radicale et révolutionnaire, cet épisode, qui serait à considérer comme fort dommageable chez tout autre parti, s’inscrit au contraire dans la norme et relève d’une logique spécifique de fonctionnement. En fait, avec cette émergence de crise, LFI n’entre pas dans la tourmente, mais au contraire dans une zone de confort. Il se voit offrir l’exercice de ce qu’il sait faire de mieux et qui assure, renforce sa cohésion chaque fois que le besoin s’en fait sentir. Anathème, délation, procès en hérésie, etc. Bref, l’intégral du spectre de violence dont tout mouvement de cette nature fait son miel. Violence interne corollaire de la violence externe. Jean-Paul Sartre, qui s’y connaissait en la matière, analyse fort clairement ce phénomène dans Critique de la raison dialectique. Cette violence double face s’inscrit dans le principe même du groupe révolutionnaire, expose-t-il. Elle est son moteur. De plus, élément constitutif absolument indispensable, elle doit toujours pouvoir revendiquer le fait que sa propre violence ne serait qu’une réponse à la violence de l’autre. Il faut donc avant tout s’employer à la fabriquer, à l’inventer, cette « violence de l’autre ». Diaboliser systématiquement, fasciser celui qui n’est pas d’accord, nazifier Israël par exemple, extrême-droitiser toute pensée non assujettie, etc, etc. On connaît la chanson. Voilà schématiquement pour la violence externe.
En ce qui concerne la violence interne, c’est ce à quoi nous n’allons pas manquer d’assister sur la base de ce sondage.
A lire aussi: Glucksmann, le candidat des gnangnans de la mondialisation?
Puisqu’il rassemblerait en deçà de la gauche extrême et radicale, Ruffin se trouvera automatiquement affublé de l’étiquette social-traître, accusé de se « soc démiser », de frayer avec la sociale démocratie, de se « droitiser ». Puis viendra le procès en trahison proprement dit. Trahison, du parti, de son chef, du prolétariat, des minorités opprimées, bref toute la lyre des péchés inexpiables. Le moindre de ses propos sera analysé à l’aune de la pureté idéologique. Un mot de travers, une virgule mal placée, et ce sera la sentence de mort. Ruffin pactisant avec le diable, allié objectif de la peste brune. Là encore, air connu. Robespierre, Lénine, Staline et consorts tels qu’en eux-mêmes.
Maladresses
Qu’on ne se laisse pas abuser, c’est sur cette base-là que le groupement révolutionnaire se survit à lui-même, se régénère, recrée, retisse son unité, cette fameuse « unité qui s’incarne, au sommet dans la personne d’un chef charismatique qui la symbolise, la met en scène dans des manifestations de force et des explosions de violence verbale », écrit René Sitterlin, dans La violence. (Au demeurant, Hannah Arendt n’exprime pas autre chose lorsqu’elle écrit « le totalitarisme se nourrit de sa propre violence. » Sans celle-ci, il s’asphyxie, il se délite, il meurt).
Aussi, le sondage, par ses résultats, n’est peut-être pas une très bonne nouvelle pour M. Mélenchon sur le plan strictement électoral, mais, parce qu’il est annonciateur de rififi dans son pré carré, il lui rend l’insigne service de l’installer plus fermement que jamais dans son espace de performance, de lui conférer pour les deux années à venir le rôle qui lui convient le mieux, celui d’inquisiteur en chef, de gourou dépositaire exclusif de la vérité vraie, de grand prêtre du dogme. Là, nul doute que son ego s’en donnera à cœur joie. Et nous autres y trouverons probablement de quoi rigoler. Ruffin, moins peut-être…
À la parution du sondage, un député LFI commentait, lucide – amère mais lucide – : « Ça ne peut pas bien finir ». Pour qui ? Là est la question. François Ruffin avouait récemment qu’il voyait en Mélenchon « un génie de la politique ». Un « génie » qui lâchait voilà peu cet avis frappé au coin de l’expérience : « Ces maladroits qui partent trop tôt, les premiers morts ce seront eux. » À qui pensait-il disant cela ? Nous avons notre petite idée là-dessus. Affaire à suivre, donc.
Source : « Pour François Ruffin, un sondage qui montre le chemin », Charlotte Belaïch, Libération, 21 avril 2024.