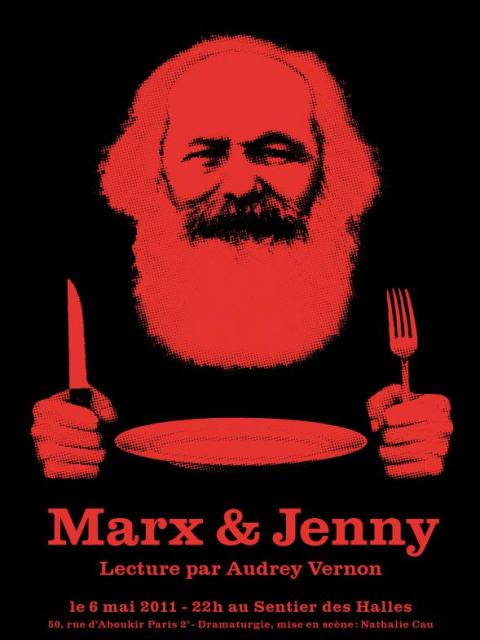C’est le casse-tête de tout meccano institutionnel : comment arbitrer entre représentativité et gouvernabilité, c’est-à-dire dans un jeu à somme nulle ? Plus les institutions sont représentatives des divergences au sein de la société, plus il est difficile de dégager un compromis, donc une majorité qui soutienne et accompagne le pouvoir exécutif. Le mode de scrutin n’est donc pas, loin s’en faut, un détail technique, mais un choix politique qui traduit l’importance relative que l’on accorde à la stabilité et à la justice. Avec le scrutin uninominal à deux tours – censé favoriser un bipartisme aussi confortable pour les gouvernants que rassurant pour l’esprit −, la France a clairement donné, en 1958, la priorité à la stabilité. Les Français voulaient être bien gouvernés.[access capability= »lire_inedits »]
Aujourd’hui, ceux-ci découvrent qu’au moins un quart d’entre eux ne sont pas représentés à l’Assemblée nationale et que la gouvernance du pays n’en est pas pour autant satisfaisante, pour le dire pudiquement. Autrement dit, qu’ils se font avoir doublement. Et on ne voit guère pointer à l’horizon un homme providentiel dont la légitimité charismatique compenserait la carence de légitimité démocratique.
En bref, la Ve République ressemble de plus en plus à un marché de dupes dans lequel le déficit démocratique va de pair avec l’immobilisme – parfois très agité – des gouvernants. La place du Front national dans la vie politique est le symptôme le plus criant du mal : alors que, depuis 2002, il séduit, au fil des consultations, 15% à 20 % des électeurs, il est tout simplement exclu du jeu politique, n’ayant aucun député et un seul conseiller général[1. S’il en va différemment pour les Conseils régionaux et le Parlement européen, c’est précisément parce que, dans les deux cas, les élections se font par liste et avec une forte dose de proportionnelle]. La raison de ce « scandale démocratique » est simple : alors que les autres « petits partis » peuvent monnayer leur désistement, leur entrée au gouvernement, leur abstention ou leur soutien, parfois dans le cadre de marchandages peu ragoûtants, et obtenir ainsi des élus ou des maroquins sans avoir à atteindre avec leurs petits bras la barre des 50 %, le parti de Marine Le Pen est seul. On ne saurait évidemment pas obliger un parti à s’allier à un autre. Tant que les règles du jeu ne changeront pas, le Front ne pourra donc compter que sur l’indiscipline des électeurs pour envoyer des élus à l’Assemblée. Ce n’est pas négligeable : la révolte à basse intensité qui monte dans le pays ne peut que favoriser un parti qui a beau jeu de se présenter comme le seul véritable adversaire du « système » quand, justement, les représentants du « système » répètent en boucle qu’il n’est pas « un parti comme les autres ». Après des décennies de gestion par la droite et la gauche raisonnables, avec les résultats que l’on sait, les Français pourraient précisément trouver que ce « pas comme les autres » est, en soi, assez tentant.
Certes, on n’en est pas là. En attendant, pour la grande alliance des gens convenables qui s’auto-décernent des brevets de républicanisme et s’autorisent à désigner le mouton noir – qui, lui, ne serait pas « républicain » − 20 % des électeurs n’existent pas ou, à l’extrême limite, comme des brebis égarées qu’il conviendrait de rééduquer. Au fait, cette prétention à trier, au sein du peuple souverain, entre le bon grain est l’ivraie, est-elle bien républicaine ?
On peut aussi se demander si le prix payé en termes de démocratie pour une stabilité dont les bénéfices ne sont pas si éclatants que cela n’est pas franchement exorbitant. En effet, ce merveilleux bipartisme qui semblait être le seul moyen de rendre vaguement gouvernable le pays aux milles fromages du Général (qui en recensait un peu moins, me semble-t-il) a eu comme résultat de convaincre nombre d’électeurs que deux écuries se succédaient au pouvoir pour mener peu ou prou la même politique : c’est le règne de « l’UMPS », expression dont on ne sait plus qui l’a inventée, mais que Marine Le Pen a eu l’intelligence de faire sienne. Et il faut bien dire que cette analyse, un peu caricaturale, n’est pas totalement dénuée de fondement.
On me dira qu’aux Etats-Unis, la vie politique est encore plus coulée dans l’acier du bipartisme. En réalité, non seulement il y a en fait 50 partis démocrates et 50 partis républicains dont les contours idéologiques varient d’un État à l’autre, mais on ne sait pas ce que sera l’avenir du mouvement Tea Party. Surtout, le duopole partisan est compensé par de vastes espaces de liberté (de parole et d’action) qui permettent l’expression des différences : fidèles à la devise de leur République, « E pluribus unum », les Américains revendiquent le pluralisme de leur société et de leur culture. Il est vrai que ces différences coexistent d’autant mieux qu’elles savent s’effacer au nom d’une croyance partagée dans le rêve américain et dans une commune allégeance au drapeau − que l’on aimerait parfois observer de notre côté de l’Atlantique.
Mais revenons à notre pays qui, au nom des droits de l’homme qu’il se targue d’avoir apportés au monde, condamne à l’inexistence politique une partie de ses citoyens. Ce rejet des opinions dissidentes hors de l’arc républicain révèle la peur que la France a d’elle-même, comme si laisser les points de vue s’exprimer dans leur diversité était une menace pour la paix sociale et la cohésion nationale. En somme, pour que la République soit « une et indivisible », il faudrait que la société le soit aussi. Or, c’est tout le contraire !
Plus de deux siècles après la Révolution, plus d’un siècle après la loi de 1905, la culture politique française est toujours surdéterminée par la peur d’une guerre civile, d’un éclatement de la société en communautés égoïstes qui aboutiraient au retour de deux Frances ennemies.
Machiavel a noté que la véritable force de la république romaine était l’intensité de ses querelles intérieures bien plus que son unité de façade. Selon le penseur florentin, « la pensée qui resplendit dans les périodes les plus glorieuses de la Rome républicaine, celle qui dans les douze tables consacre une des premières affirmations, quoiqu’imparfaite encore, des droits de l’homme, suscite la lutte entre patriciens et plébéiens […]. Ce fut une lutte qui ne dégénéra presque jamais en guerre civile, qui créa le tribunat, l’appel au peuple, la mise en accusation des magistrats abusant de leurs pouvoirs; lutte toujours dominée par un si grand amour de la patrie qu’elle suscita les plus grands prodiges d’héroïsme et de sacrifice, que le monde pourra peut-être égaler, mais jamais surpasser. » Ils étaient grands car ils assumaient leurs désaccords – ce qui ne les empêchait évidemment pas de les régler souvent à coups de poison ou d’épée. Machiavel n’était pas un droit-de-l’hommiste béat ni un démocrate radical. Peut-être devrions-nous nous approprier cet enseignement et chercher, plutôt qu’à étouffer le débat, à le contenir dans les limites de l’acceptable – c’est-à-dire celles que nous jugeons collectivement comme telles. Mais il est absurde d’autoriser un parti à briguer les suffrages des électeurs pour décréter qu’il est immoral de lui donner sa voix.
Ce mystère et ce don de la pluralité humaine qui les dépasse, au lieu de le redouter, nos gouvernants devraient donc feindre de l’organiser. Voilà pourquoi la France doit, à mon avis, revenir à un véritable régime parlementaire, c’est-à-dire à un mode de scrutin reposant largement sur la proportionnelle . On me dira que François Mitterrand, en faisant un pas dans cette direction en 1985, a suscité des protestations indignées dont on perçoit encore les échos : il serait en quelque sorte l’inventeur du FN, comme si un phénomène politique de cette ampleur pouvait être le fait du prince. Je ne suis pas naïf au point d’ignorer que le Moïse des socialistes n’était pas animé par de nobles sentiments démocratiques mais par l’ambition de semer la pagaille à droite et de refaire l’unité de son camp autour d’un consensus moral. Mais tant pis, je préfère avoir raison avec Mitterrand que tort avec Aubry, Fillon ou les autres.
Oui, je l’avoue, je souhaite un retour à la IVe République qui, malgré sa légende noire, n’a pas tant démérité. Certes, en douze ans, elle a connu 24 gouvernements dont aucun n’a duré plus de seize mois et s’est montrée incapable de maîtriser la crise algérienne – mais est-on si sûr qu’une Ve présidée par Mitterrand, Chirac, Sarkozy ou les autres aurait fait mieux ? N’oublions pas que c’est sous ce parlementarisme si décrié qu’ont commencé les Trente glorieuses, dont la monarchique Ve République a pu recueillir les fruits. Et n’exagérons pas les vertus d’institutions qui allaient si bien au Général mais sont peut-être un costard un peu grand pour ses successeurs. Sommes-nous si sûrs que nos présidents méritent qu’on se soucie de leur donner les moyens de gouverner au sacrifice de la justice la plus élémentaire ?
Cessons de chercher un Père quand nous ne savons plus très bien quel rêve national il incarnerait. Parvenues, pour le meilleur et pour le pire, à « l’égalité des conditions » annoncées par Tocqueville, nos démocraties ne produisent pas tant de candidats à une fonction qu’on puisse encore qualifier de « suprême ». Acceptons nos divisions sans chercher à les camoufler dans des usines à gaz politiques comme l’UMP et, dans une moindre mesure, le PS. Cessons de nous observer dans un miroir déformant. Si nous affrontions notre véritable image, nous découvririons que la France, si elle est moins flamboyante que nous le voudrions, reste une très belle fille.[/access]
La Quatrième République : La France de la libération à 1958
Price: 5,21 €
6 used & new available from