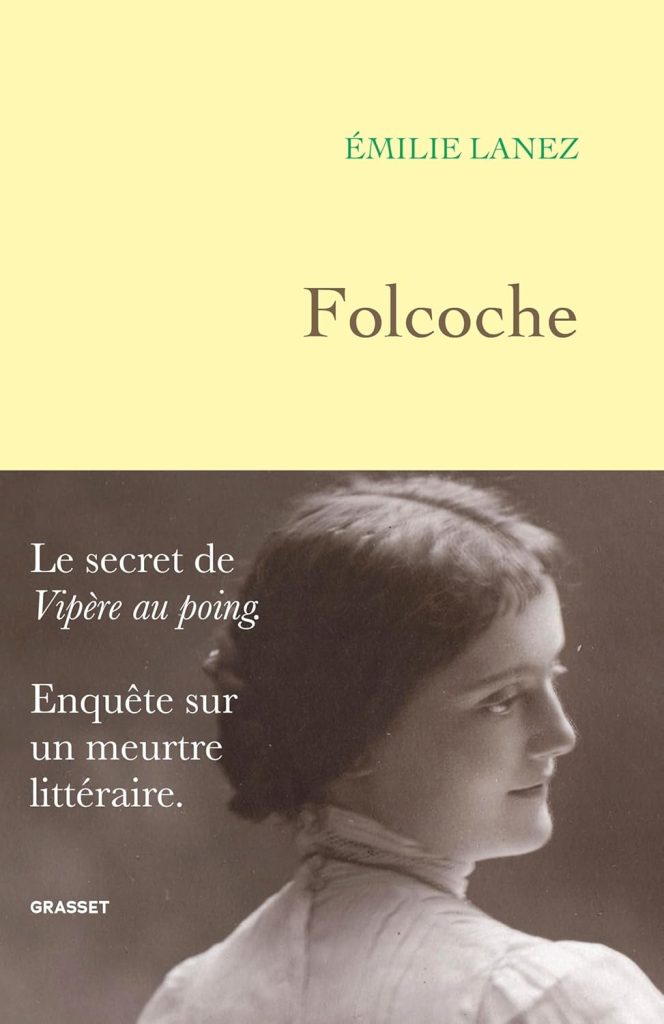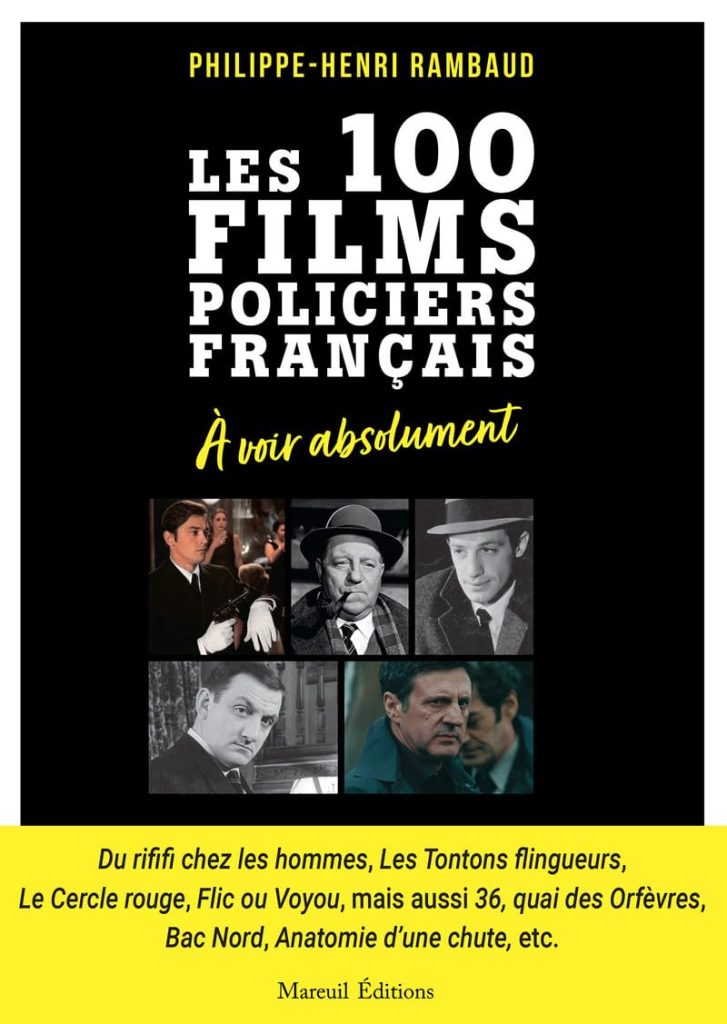Séparatisme. Quand la peur change de camp
L’idée que la France serait « islamisée » alimente à la fois les fantasmes les plus alarmistes et les dénégations les plus morales.
Pourtant, si l’on délaisse ces réactions réflexes pour adopter une perspective anthropopolitique — celle qui considère les formes profondes d’organisation du lien social —, une réalité moins spectaculaire mais plus décisive apparaît : notre société est déjà partiellement islamisée sur ses marges.
Cette islamisation procède d’un phénomène plus diffus : l’installation de schèmes culturels, hérités de l’histoire islamique, dans les zones où l’État s’est retiré, où le « nous » national se défait, et où se reconstituent, spontanément, des formes anciennes de hiérarchie et de domination.
Domination informelle
Dans cette perspective, la jizya — impôt traditionnel imposé aux non-musulmans dans l’islam pré-moderne — n’est pas seulement un vestige juridique appartenant au passé. Elle est la manifestation d’une structure anthropologique fondamentale: un groupe dominant exige des autres un tribut pour leur permettre d’exister sur son territoire.
Historiquement, la jizya n’était pas un simple impôt financier. C’était un rituel de subordination : un paiement qui signifiait la reconnaissance d’une supériorité politique et spirituelle. Ce qui importe ici n’est pas la théologie, mais la logique du pouvoir: l’idée que la présence des uns est conditionnée par la dette qu’ils doivent aux autres.
Or, dans certains territoires français, où l’État est devenu extérieur, où la police est vécue comme hostile, où le lien civique s’est dissous, ce schème ancien se réinstalle sous une forme inversée : non plus au bénéfice d’un pouvoir religieux, mais d’une contre-société juvénile ; non plus comme loi écrite, mais comme domination informelle ; non plus comme obligation spirituelle, mais comme tribut symbolique ou matériel que la société doit payer pour pouvoir circuler, travailler, vivre.
C’est cette réactivation silencieuse d’une logique pré-moderne — la jizya invisible — que le texte suivant analyse en profondeur.
La jizya invisible : domination inversée et crise du lien civique
Il est frappant de constater à quel point certaines réalités apparemment sans rapport — un impôt religieux médiéval et la délinquance urbaine contemporaine — peuvent, lorsqu’on en dégage la structure, révéler une parenté profonde. La jizya appartient certes au monde historique de l’islam pré-moderne. Mais elle appartient aussi, plus fondamentalement, à une anthropologie du pouvoir : elle exprime la manière dont une collectivité se représente sa supériorité, et la façon dont elle exige des autres un signe tangible de cette supériorité.
Ce qui nous intéresse ici n’est pas l’islam en tant que religion, mais la logique anthropopolitique qui s’attache à la jizya : celle d’une dette instituée, d’un monde divisé entre ceux qui sont chez eux — et qui font payer les autres pour entrer — et ceux qui doivent acquitter le prix de leur présence.
La jizya comme matrice symbolique : le monde structuré par la dette
Dans les sociétés pré-modernes, la dette n’est pas seulement économique : elle est politique, cosmique, moralement structurante. Elle ordonne le monde. La jizya, dans ce registre, institue une hiérarchie visible : un groupe central, légitime, une périphérie tolérée à condition de payer sa dette d’existence. Le paiement n’est pas une transaction : c’est un rituel de reconnaissance d’infériorité.
Ce schème anthropologique ne disparaît jamais totalement. Les croyances s’en vont, les structures demeurent. Il peut se vider de son contenu théologique, mais conserver son efficacité symbolique.
Or ce schème resurgit sous d’autres formes dans la France contemporaine.
Non parce que l’islam réactiverait mécaniquement ses formes anciennes, mais parce que la crise du monde moderne crée un vide où ces structures symboliques, disponibles dans les imaginaires culturels, peuvent se réinstaller.
Fracture d’appartenance : quand la société devient un extérieur
Pour comprendre les comportements délinquants actuels, il faut partir d’un fait massif : une partie de la jeunesse issue de l’immigration ne se pense pas comme appartenant à la communauté politique française. Elle est de fait française, mais ne se vit pas comme telle. Ce désajustement n’est pas seulement socio-économique ; il est anthropologico-politique. L’État n’est pas perçu comme “notre État”, mais comme une puissance lointaine, neutre ou hostile.
La police n’est pas une institution partagée, mais une force d’occupation. Les aides sociales ne sont pas un instrument de solidarité, mais une réparation minimaliste due pour des injustices anciennes. Dans cette configuration, le lien civique — qui suppose réciprocité, appartenance, responsabilité — s’effondre. Et dans cet effondrement, se glisse un rapport de dette inversée.
L’impensé de l’État social : l’aide comme tribut
L’État-providence repose sur une présupposition implicite : l’aidé appartient à la communauté, contribue à la mesure de ses moyens, et la solidarité reçue appelle une solidarité rendue. Or ce présupposé ne tient plus dans certains segments de la population.
L’aide sociale est vécue comme une jizya versée par une société coupable.
Coupable de la colonisation, coupable du racisme, coupable de l’échec scolaire, coupable des discriminations, coupable de l’état du monde — peu importe : l’essentiel n’est pas la factualité, mais la structure du ressentiment.
Cette aide cesse d’être un soutien : elle devient un dû. Et comme tout dû, elle n’appelle ni reconnaissance, ni gratitude, ni engagement. Cette logique explique un paradoxe majeur de l’État moderne : plus il donne, plus il nourrit le ressentiment, dès lors que l’appartenance symbolique n’est pas assurée.
La délinquance comme tribut informel
Dans certains territoires, la criminalité n’est plus seulement une transgression de la loi : elle devient un mode d’organisation du pouvoir. Elle instaure, à l’échelle locale, un système de prélèvement symbolique — parfois matériel — sur ceux qui sont perçus comme étrangers à l’espace social des jeunes dominants.
Le vol, l’intimidation, le racket, les agressions ne relèvent pas seulement du manque, mais de la reconnaissance inversée : c’est à la société de payer. Payer pour le respect. Payer pour avoir le droit de circuler. Payer pour exister dans un territoire qui vous est désormais disputé. C’est une jizya sans nom, sans texte, sans dogme — mais avec une évidence ressentie. C’est l’actualisation brute du schème ancien : « Nous sommes ici, vous êtes tolérés. » J’insiste sur ce point : la démocratie est fragile car elle suppose l’adhésion intérieure à une communauté de semblables.
Quand cette adhésion se défait, ce n’est pas seulement le respect de la loi qui vacille: c’est la possibilité même de faire société. Or nous assistons aujourd’hui à une démutualisation radicale:
• l’État n’est plus une institution commune,
• l’aide n’est plus un outil de solidarité,
• la loi n’est plus un horizon partagé,
• le territoire n’est plus un espace commun.
Dans cette brèche, se réintroduisent des formes anciennes de rapports sociaux, non démocratiques : la hiérarchie, le tribut, la domination symbolique. La modernité ne recule pas devant l’islam: elle recule devant la désappartenance.
La crise du “nous”
Le parallèle entre jizya, délinquance et assistance sociale révèle une vérité plus large : la France ne souffre pas d’un problème religieux, mais d’un problème de communauté politique. Là où l’appartenance se défait, la dette imaginaire renaît. Là où le “nous” disparaît, la société redevient une juxtaposition de groupes — certains exigeant des autres un tribut pour accepter leur présence.
Ce qui se joue aujourd’hui n’est pas un conflit de religions, mais une crise de l’intégration politique, où les formes archaïques du rapport de force trouvent un terrain pour s’actualiser. C’est cette crise que je nous invite à comprendre : l’effondrement du lien civique comme matrice de toutes les déviations présentes — y compris celles que nous croyions reléguées aux marges de l’histoire.