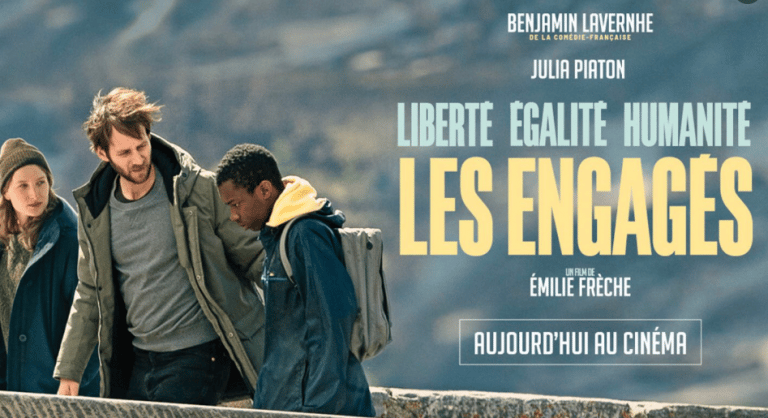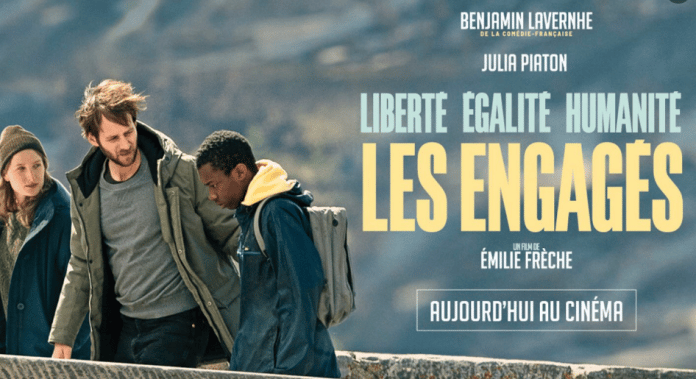Un film qui fait flop, Louis Boyard, wokisme sur France inter, Fdesouche… Avant la fin de cette année 2022, voici une rétrospective amusante de ce qu’il ne fallait pas manquer ces derniers jours dans les médias…
Je sais que c’est moche, mais je ne peux m’empêcher de me réjouir de la grosse claque que prend depuis cinq semaines « Les engagés », ce film militant et immigrationniste qui avait vu tout le ban et l’arrière ban de la presse progressiste lui tresser des kilomètres d’articles avec plein de guimauve et de moraline dedans. Après le catastrophique score de la première semaine (19 609 entrées), voici le résultat de la cinquième : 15 entrées ! Total au bout de cinq semaines : 33 433 entrées. La honte !
En revanche, « Reste un peu », la comédie intimiste de Gad Elmaleh (sur sa conversion au catholicisme), a attiré 425 395 spectateurs durant la même période. De son côté, « Nos frangins », le film de Rachid Bouchareb autour de l’affaire Malik Oussedine, connaît un démarrage plus que laborieux : seulement 58 258 entrées pour les deux premières semaines, malgré, là encore, un battage médiatique orchestré aux petits oignons par les médias dominants. Il semblerait que les spectateurs français en aient soupé des films à thèse tournant autour des supposées tares de la France, son racisme « systémique », sa police « raciste » ou son refus d’accueillir à bras ouverts les migrants qu’elle laisse mourir dans « ce cimetière qu’est devenue la Méditerranée ». Les mêmes spectateurs semblent plutôt apprécier les films qui interrogent et analysent un événement traumatique national sans baigner dans le voyeurisme ni la facilité et en offrant un véritable spectacle cinématographique. Apparemment, « Novembre », le dernier film de Cédric Jimenez relatant le travail des cellules anti-terroristes après les attentats du 13 novembre 2015, réussit ce pari difficile. La presse (hormis, bien sûr, Le Monde et les Inrocks) et les spectateurs sont cette fois unanimes : le film est une réussite scénaristique et cinématographique. Résultat : 2 362 920 entrées après un peu moins de trois mois d’exploitation.
A relire: Bataille judiciaire inattendue autour du film «Novembre»
Louis Boyard n’a pas le temps d’aller au cinéma. Le député de LFI s’est lancé dans une « tournée des facs ». Malheureusement, cette « tournée » n’est pas destinée à une meilleure connaissance de la géographie et de l’histoire de son pays ou à l’apprentissage de quelques notions philosophiques, littéraires ou politiques basiques – toutes choses qu’il ne serait pas superflu que notre jeune député tente d’appréhender, même petitement, histoire de vernir un peu ses discours répétitifs et de polir un esprit que l’on sent rétif à l’échange élégant et riche d’arguments. Cette « tournée », comme son nom l’indique, ressemble plutôt aux pérégrinations des vedettes du music-hall ou du cirque, le talent en moins ; car le spectacle artistico-politique de Boyard est composé de numéros assez fumeux – acrobaties démagogiques, prestidigitation idéologique et autres clowneries politiciennes. Après l’avoir rodé en France, Louis Boyard l’a exporté en Belgique, le temps d’une soirée à l’Université Libre de Bruxelles. Juste retour des choses : les Belges nous ont refilé leurs plus mauvais humoristes, nous leur refourguons ce qui se fait de pire en matière de responsable politique. Deux regrets toutefois : que les bouffons belges se soient incrustés en France et que Louis Boyard soit déjà revenu du plat pays.
Paul B. Preciado, mutant autoproclamé, a maintenant son rond de serviette à la radio publique. Le 20 décembre, la toujours très simple Sonia Devillers a interviewé ce philosophe de quatrième division, sous-derridien, sous-foucaldien, butlérien à la ramasse qui a pu dévider sa pelote dégenrée sans rencontrer la moindre résistance. Au contraire. Quand Preciado affirme : « J’ai transformé mon corps en laboratoire politique. Beaucoup de philosophes ont fait ça, même Freud faisait aussi de l’auto-analyse », Sonia Devillers, abrutie par cette affirmation stratosphérique, dit pour lui complaire : « On comprend mieux pourquoi vous faites peur ». Ces pitres parlent sérieusement, sans la moindre ironie. Ils croient en leurs délires – raison pour laquelle ils sont parfois si drôles. Entendre Sonia Devillers, hébétée, déblatérer pour dénoncer ses « privilèges de femme cisgenre, hétéro et je ne sais pas quoi (sic) » devant un Preciado agréant la bêtise de son hôtesse en imaginant « des corps vivants qui se réunissent en tant que corps dysphoriques du monde », quel gag ! Et surtout, quelle joie d’imaginer, dans cinquante ans, après que seront tombées dans les oubliettes les divagations bouffonnes de ces jobards professionnels, les gens sains d’esprit qui se tordront de rire en écoutant les podcasts de ces demeurés.
À lire aussi : Wakanda forever et la propagande anti-française
Après les violences communautaires de Montpellier, Gérard Miller, l’ancien garde rouge de la Gauche prolétarienne devenu chroniqueur d’émissions plus ou moins humoristiques, plus ou moins politiques, toujours pathétiques, Gérard Miller, le psychanalyste des effrois médiatiques, Gérard Miller, la buse mélenchoniste qui se prend pour un aigle révolutionnaire, Gérard Miller, donc, a cru survoler les débats en tweetant : « Oubliant les abominations qu’elle dit régulièrement sur les Gitans, l’extrême droite les défend ces jours-ci. Pourquoi ? Parce que les Gitans sont en conflit à Montpellier “avec les Arabes”. Décidément, comme les voies du Seigneur, les voies des racistes sont impénétrables. » Obligé de regarder la vérité en face, le volatile gauchiste s’écrase sur le tarmac de la réalité ; pour tenter de se relever, il lui faut écrire un triste et mensonger et convenu message contre « l’extrême droite ». Gérard Miller, la bêtise gauchiste à l’état pur, ne déçoit jamais et ne nous surprend plus. Décidément, comme les voies du Grand Timonier, les voies des anciens maoïstes sont totalement prévisibles.
Quant aux voies de certains députés, elles semblent mener tout droit vers l’abîme. Langue mystérieuse et mensonges éhontés s’enchevêtrent au milieu du chaos. Après que certains ont dénoncé le fonctionnement de LFI qui a vu le Seigneur Jean-Luc Mélenchon adouber l’écuyer Manuel Bompard sans demander leur avis aux vassaux historiques trépignant de rage, Daniele Obono a tweeté : « Les mêmes qui prétendent dénoncer le supposé verticalisme autoritaire de LFI sont celleux qui érigent les chefs (mâles blancs) dont nous serions les « fidèles », « courtisan·es », pantins, et autres écervelés. Leurs insultes et leur mépris en disent plus long sur elleux que sur nous. » Quelle bouillie ! Le sens de cette « phrase » s’obscurcit au fur et à mesure que nous la lisons et se perd dans les méandres d’une écriture inclusive absconse, et par ailleurs, pour peu que l’on veuille admettre certaines règles à ce baragouin, mal digérée (écervelés attend encore son « e » inclusif). Quelques jours auparavant, à un quart d’heure de la fin du match France-Maroc, Sandrine Rousseau, plus illuminée qu’un sapin de Noël, twittait : « Quoiqu’il [sic] se passe d’ici 15 min, mangez votre racisme. Et si il [sic] est gros et bouffi, buvez un grand verre d’eau pour l’avaler. Merci. » Là, je dois reconnaître que ça me la coupe. De leur côté, quelques heures à peine après la tuerie visant des Kurdes, les députés de LFI et du PS récupéraient à qui mieux mieux ce terrible événement. Clémentine Autain twittait : « Effroyable attentat. L’extrême droite semble avoir encore frappé. Mortellement. » Mathilde Panot surenchérissait : « L’extrême droite raciste doit être neutralisée ». Louis Boyard ne manquait pas d’apporter sa contribution à ce tombereau d’âneries : « Quand est-ce que le terrorisme d’extrême droite cessera de proliférer impunément dans notre pays ? » Les socialistes nupeséïsés, ne sachant plus où ils habitent, copièrent sur leurs voisins insoumis. Olivier Faure (tellement transparent qu’on est obligé de rappeler systématiquement qu’il est l’actuel Premier secrétaire du PS) rabâcha : « Ce qui s’est passé à #paris10 doit réveiller chacun d’entre nous sur le danger que représente l’extrême-droite » ; tandis que le perroquet Boris Vallaud (tellement diaphane qu’on est obligé de rappeler systématiquement qu’il est le président du groupe Socialistes et apparentés à l’Assemblée nationale) babillait : « Terrible attaque meurtrière à Paris, au centre culturel Ahmet-Kaya, par un militant d’extrême-droite. » « L’extrême droite », il ne reste plus que ça à la gauche socialiste et à l’extrême gauche pour espérer continuer de barboter encore quelque temps dans le marigot politicard. La ficelle devient si grosse qu’ils finiront bien par se pendre avec.
A lire aussi : Enfants transgenres – l’avis d’un psychothérapeute
Dans Libération, Thomas Legrand, l’infatigable exorciste médiatique des diableries fascistes, croit confondre les « déclinistes réacs et autres aboyeurs de la fachosphère » qui critiquent l’immigration, cette chance pour la France : « La France des immigrés, diverse, joyeuse et confiante a montré sa cohésion et sa puissance », écrit le journaliste en évoquant l’équipe de France de foot. Moi, je veux bien, mais Louis-Georges Tin, l’ex-président du CRAN (Conseil représentatif des Associations Noires de France), a l’air de penser au contraire que dans notre équipe de France « les Afro-descendants sont surreprésentés ». Cette triste réalité, explique M. Tin sur sa page Facebook, éclaire sur le racisme et la discrimination systémiques dont souffrent les jeunes Noirs dans le monde du travail, les obligeant à s’investir « dans le sport ou la musique ». Résumons-nous : quand les Noirs ne sont pas représentés dans certains domaines d’activité c’est parce qu’ils subissent le racisme structurel de la France et quand ils sont « surreprésentés » dans certains autres domaines d’activité comme, par exemple, le football professionnel (avec les rémunérations idoines), c’est à cause du racisme structurel en France. Bref, avec M. Tin, cet artisan du repli identitaire coûte que coûte, les jeunes Français noirs n’ont strictement aucun moyen d’échapper à la position victimaire. « Le parcours des Bleus claque le bec aux identitaires », écrit Thomas Legrand. Pas à tous, semble-t-il.
Fdesouche a failli disparaître. Ce site transmet obstinément toutes les informations concernant les phénomènes de société (immigration, insécurité, wokisme, islamisation, etc.) paraissant à bas bruit dans la presse régionale ou sur des sites d’information confidentiels et que la presse dominante ne tient pas à étaler sur la place publique. Damien Rieu a eu l’excellente idée de lancer un appel aux dons après que le fondateur de ce site, Pierre Sautarel, a dû subir un harcèlement judiciaire de la part d’indigénistes, d’antiracistes racialistes et autres décolonialistes – Rokhaya Diallo, Edwy Plenel, Éric Fassin, Taha Bouhafs, etc. – réunis en bande organisée pour cacher l’état réel de notre pays. L’excellente nouvelle est que le montant qui devait être atteint a été dépassé, que le site est sauvé, que Pierre Sautarel peut respirer un peu et que ses détracteurs enragent de n’avoir pas pu mettre à terre cet homme qui se sait maintenant soutenu par de nombreux Français. Voilà de quoi nous redonner le sourire en attendant la fin (de l’année).