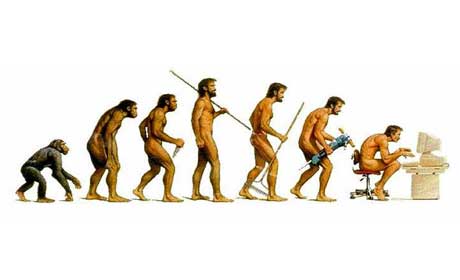Au bord du Nil tout comme sur les rives de Seine, les mêmes questions se posent. Au même moment où feue la candidature de Jean Sarkozy à la présidence de l’EPAD faisait débat ici, la presse égyptienne était fort préoccupée par l’avenir professionnel du « fils de » national, Gamal Moubarak. Ce dernier est lui aussi candidat à une présidence, mais, dans son cas, il s’agit de celle de la République arabe d’Egypte. Sinon, les deux débats se ressemblent à s’y méprendre. Ainsi Mohamed Heikal, ancien rédac’ chef de Al Ahram et proche de Nasser, a jugé la candidature de Moubarak Jr inadmissible. Grâce à Zvi Barel de Haaretz nous pouvons vous citer cet extrait aux airs de déjà vu d’un entretien donné par Heikal au quotidien Al-Masri al-Youm : « Même s’il est l’homme le plus qualifié en Egypte pour ce poste [..] être candidat n’est pas son droit parce que précisément il n’est pas un citoyen comme les autres, parce qu’ils lui donnent ce qui n’est pas donné aux autres. » Malgré toutes les médisances, force est de reconnaitre que, dans certains domaines, l’Union pour la Méditerranée avance à grands pas.
On n’est pas sérieux quand on a 76 ans
Après Roman Polanski, détenu dans la prison de Winterthur pour avoir eu des relations sexuelles il y a trente quatre ans avec une jeune fille mineure, il semblerait que la Nemesis judiciaire de l’Empire du Bien, qui règne désormais sans partage sur les consciences, fasse une fixette d’ordre névrotique et gérontophile sur les septuagénaires, dès qu’ils atteignent très précisément les 76 ans, âge de l’auteur du Bal des Vampires, mais aussi de Sonja Sonder. Cette Allemande vivant en France, aurait appartenu avec Christian Gauger, 68 ans, a une organisation terroriste allemande des années 1970, responsable notamment de l’attentat contre l’OPEP à Vienne en 1975. L’Allemagne, qui avait déjà demandé leur extradition, avait été déboutée en 2000. C’est au nom d’une hypothétique « convention de Dublin » jamais appliquée en France que François Fillon, qui serait Premier ministre, aurait signé un nouveau décret autorisant finalement cette extradition. Nous conseillons donc à toutes les personnes atteignant cet âge fatidique ces jours-ci de bien vérifier les zones d’ombres de leur passé (vols de sucettes, recel de bâtons, rédactions rendues en retard) s’ils veulent éviter une arrestation surprise.
Prix littéraires : tous pourris ?

Tous les ans, un petit vent d’octobre secoue le même marronnier. Tous les ans, c’est la saison, les gazettes résonnent des mêmes flonflons. Vas-y Mimile, les prix sont corrompus, chauffe Marcel, les renvois d’ascenseurs dans la presse, et allez donc, les copinages, et Galligrasseuil, etc. Ça chaloupe dur pendant quelques semaines, et puis ça se calme, ça reviendra l’année suivante, comme la trêve des confiseurs, les giboulées de mars, le bal du 14 juillet, tout ça. On ne s’en lasse pas. On s’y attache, au contraire. La corruption littéraire fait partie du sympathique folklore français, comme l’accordéon, le béret basque et le fromage qui pue. On y tient. Les Américains, ces puritains, n’en ont pas, eux. Et puis ça ne porte pas à conséquence.
Les Français adorent tourner en rond en répétant les mêmes figures. Mais pour ça, il convient d’endosser le déguisement qui convient. La bourrée de la corruption littéraire se danse en costumes typiques. Costume poujadiste : tous pareils, tous pourris. Costume cynique : corrompus, oui, et alors ? Ça n’empêche pas d’être un bon écrivain. Costume vertueux : il faut dénoncer les collusions, moraliser la vie littéraire. Costume nietzschéen : Et alors ? Les moralistes et les curés nous fatiguent. Costume fataliste : de toutes façons, c’est pareil partout, on n’y peut rien. Costume taquin : c’est çui qui le dit qui y’est. Costume renseigné : mais on le sait bien, tout ça. Chacun fait son petit tour sur scène, c’est joli à regarder.
Chaque année, il faut dire que l’orchestre y met du cœur. On change un peu les paroles, mais ce sont toujours plus ou moins les mêmes musiques. On rit, on s’amuse, on en redemande. Donnons quelques exemples de rengaines, histoire de savoir de quoi nous parlons. Une trouvaille récente : La Bibliothèque nationale de France vient de créer un nouveau prix littéraire, destiné à récompenser un écrivain majeur d’aujourd’hui. Il a été décerné au printemps dernier. Qui est l’heureux lauréat ? Philippe Sollers. Et qui figure dans le jury du prix ? Julia Kristeva, épouse de l’heureux lauréat. Très joli, bravo. Quelqu’un s’est-il ému qu’une institution d’état fonctionne tranquillement au népotisme ?
Il est vrai qu’on a là une figure récurrente du folklore. Pour ne donner que deux autres exemples, Yannick Haenel et François Meyronnis publient en 2005 Poker, un livre d’entretiens avec Sollers, précédé de quelques pages d’adoration lyrique (« Il y a en effet chez Sollers […] cette force d’acuité qui lui permet d’avoir accès aux expériences verbales les plus extrêmes » ; « l’étrange individu nommé Philippe Sollers est capable de jouir des tourbillons de la case vide ; il est donc le mieux placé pour entendre Yannick Haenel, me dis-je, avec une extravagante modestie »). Et qui publie ce livre d’adoration envers Sollers ? Mais Sollers, bien sûr, dans sa collection de « L’Infini ». Pas mal. Peu de temps après, le prix Décembre couronne Yannick Haenel, pour un roman publié dans la collection « L’Infini ». Et qui figure dans le jury du prix ? Philippe Sollers, éditeur de l’heureux lauréat. Car toute peine mérite salaire. C’est à ce prix qu’on arrive.
Mais on n’en finirait pas de faire la liste, BHL (du Point) nous fournirait mille exemples à lui seul. Dernier en date : il vient de faire l’éloge de Yann Moix (du Figaro), qu’il considère comme un grand cinéaste. S’il n’est pas certain que Yann Moix soit un aussi grand cinéaste que, mettons, BHL, il semble en revanche avéré que le sens du grotesque se perd dans nos élites intellectuelles.
Naguère, l’air des articles de complaisance était joué par de vieux ménétriers. La relève est assurée brillamment par les jeunes, notamment Yann Moix, le Howard Hawks du XXIe siècle, qui, dans Le Figaro, trouve que Philippe Labro, du Figaro, est un aigle, un phénix, un Faulkner, ou qui passe la rhubarbe à Beigbeder, lequel lui refile le séné. Sans parler de toute la partie invisible : Machin écrit un article élogieux sur le dernier livre de Truc publié par la maison Chose. On ne sait pas que la maison Chose a versé un copieux à-valoir à Machin pour un livre qu’il n’a jamais écrit. Machin rembourse en articles. Passons sur les jurys de prix littéraires qui volent au secours du succès, ou votent comme de bons godillots pour obéir au président ou aux pressions de leur éditeur.
Oui, mais qui peut se vanter d’être un pur ? Qui est assez impeccable pour donner des leçons ? Tout dénonciateur de pailles n’a-t-il pas une poutre dans l’œil ? Sans endosser le costume du cynique ou du poujadiste, on peut estimer que la compromission est inhérente à la vie sociale et professionnelle. Que vivre, c’est faire des compromis avec ses idées, dans presque toutes les situations, client, parent, amoureux, touriste, salarié, etc. Un écrivain a des amis, des éditeurs, connaît des journalistes, publie des papiers dans tel ou tel journal, reçoit des prix, figure dans des jurys. Peut-il jurer de ne s’être jamais trouvé dans une situation où il va favoriser un ami ? De ne s’être jamais fourvoyé dans des émissions télévisées bas de gamme ? On ne pourrait à la rigueur jouer les purs que si l’on dénonçait les travers du dehors. Mais en travaillant, en consommant, en vivant tout simplement, on est compromis, et on fait des compromis.
Il ne s’agit pas de tout justifier, ni de tomber dans un confortable relativisme mais d’éviter les deux ornières complémentaires du rigorisme moralisant et de l’indifférence cynique. Le puriste dénonce tout le monde indistinctement, ce qui revient à ne pas faire de différence entre les comportements, et les vrais corrompus en profitent pour mener leurs petites affaires tranquillement. Les voilà justifiés : ils ne sont pas pires que les autres, ils sont pareils. Le puriste, qui ne distingue pas, est le complice objectif de la corruption. De même, la rébellion est devenue un argument commercial et une pose de notables. On croule sous les rebelles, mais on manque de critiques.
Faudrait-il alors, pour éviter tout conflit d’intérêt, se retirer du monde ? Faudrait-il que les écrivains ne puissent pas être en même temps critiques littéraires ? Mais qui est vraiment retiré du monde ? L’austère Julien Gracq a pratiqué aussi la critique sur la littérature de son temps. Il s’est engagé. Le meilleur de notre critique, celle qui reste, c’est celle des écrivains : Barbey, Schwob, Bloy, Mérimée, Gourmont, Baudelaire, Sartre, Jacques Laurent, Vialatte, etc. Dans une conception rigoriste de la déontologie littéraire, ils n’auraient pas dû publier d’articles critiques. Et nous n’aurions plus, à ranger dans l’histoire de la critique littéraire, que Paul Souday, Duvergier de Hauranne ou André Chaumeix.
Il faut tenter de coller au plus près à un idéal d’honnêteté, savoir dire non, tout en sachant qu’on est dans le bain, et que dès lors on ne détient aucunement le privilège absolu de la vertu. L’important, c’est de distinguer. Les situations et les cas sont complexes, autant que la réalité humaine. C’est au prix de cette distinction qu’on pourra éventuellement se permettre de dénoncer.
Fashion police à Gaza
On a trop souvent prétendu, et parfois ici même, que les forces de sécurité gazaouites servaient de couverture légale à des activités terroristes. Ce n’est pas vrai, ou plutôt ce n’est qu’une partie de la vérité, puisque, comme vient de nous l’apprendre le Guardian, elles ont bien d’autres activités. Son envoyé spécial sur place a pu observer la multiplication des contrôles de police sur les plages locales. Des officiels en armes dispersent les couples non mariés, renvoient chez elles les jeunes filles non chaperonnées par un individu mâle de leur famille et, faut-il le dire, font passer un mauvais quart d’heure aux femmes de 0 à 99 ans en tenue jugée indécente. Mais n’allez surtout pas voir là un quelconque sexisme : d’après le reporter du Guardian les messieurs qui auraient le mauvais goût de bronzer vêtus de leur seul maillot de bain sont eux aussi rhabillés pour l’hiver…
Népotisme pour tous

Le fils du maire de K. était un garçon brillant. À l’âge de 5 ans, il avait déjà remporté trois fois le concours annuel de billes du village. À 6 ans, un premier poil apparaissait sur son menton, qui occupa, une année durant, l’académie de médecine du Land. Tout lui réussissait, rien ne semblait l’arrêter – pas même la cuiller en or qui encombrait sa bouche depuis sa naissance et qui lui aurait conféré une élocution drolatique s’il avait été un autre.
Or, il advint que l’enfant, qui avait déjà tout fait, parvint à ses 8 ans et s’estima en âge de tâter de la politique : le sport et le physique vous lassent vite un homme quand de plus hauts objets se présentent à lui. En septembre 1951, on le vit donc se présenter à l’élection de délégué de classe de 10e de l’école municipale de K. Il fit sa campagne comme pas un et promit à ses camarades monts et merveilles : il se battrait pour qu’on réaménage la cour et qu’enfin l’on nettoie le bac à sable de ses lichens et de ses fientes. On supprimerait les épinards servis le mardi à la cantine et les frites remplaceraient les pommes vapeur du vendredi. Lorsqu’il déclara que les brocolis et les salsifis n’auraient plus le droit de cité sur les tablées du réfectoire, ce fut, de toute part, une ovation. Le vote n’avait pas eu lieu qu’il était déjà élu.
Mais la vie n’est pas simple et l’épicier du village, qui avait fait le point sur le manque à gagner qu’une élection du fils de l’Oberbürgermeister provoquerait, envoya son propre fils se présenter contre lui. L’affaire aurait pu se régler à la récré : une partie de billes, un échange diplomatique de gnons et de mandales, un concours de zizi dans les toilettes pour garçons. Les choses s’étaient déjà envenimées : le fils du maire fut accusé de tous les maux et les pires rumeurs l’affectèrent. On n’hésita pas à prétendre qu’il faisait encore pipi au lit, qu’il mangeait ses crottes de nez et, pire que tout, qu’il n’était qu’un gros fayot. Ne l’avait-on pas vu plusieurs fois s’attarder auprès de Mlle W., l’institutrice de la petite classe, pour s’enquérir de sa santé ou lui porter son sac ? La petite crapule…
Le sommet fut atteint lorsque d’infâmes soupçons de pédophilie touchèrent le fils du maire : c’est qu’il avait le béguin pour une petite de 11e et le bisou qu’il lui avait donné sur la joue, deux ou trois jours après la rentrée, ne plaidait guère pour sa défense. Des attouchements sur une gamine, quand même ! S’il n’avait pas été le fils de l’Oberbürgermeister, je vous fiche mon billet que la police serait venue l’emporter manu militari pour lui couper les couilles.
C’est ce que pensa le pasteur S. lorsque l’histoire parvint à ses oreilles. Son sang ne fit qu’un tour. Révulsé par l’impunité du fils du maire, il alla trouver le directeur de l’école et le menaça de tout révéler sur les sordides histoires qui se tramaient dans son établissement : comment pouvait-on accepter qu’un garçon aussi déluré que le fils de l’Oberbürgermeister puisse devenir délégué de classe ? Une fois élu, il pourrait faire main basse sur la cagnotte du voyage de fin d’année et, pire encore, il aurait accès à la ronéo, celle qui permet d’imprimer une fois l’an le bulletin des éléves de la classe de 10e. Pouvait-on donner autant de pouvoir à un enfant ? Trop, c’était trop.
Le directeur se rangea aux arguments du pasteur. Et, cette année-là, l’épicier eut la grande satisfaction de voir son fils élu délégué des élèves de 10e. Ce fut un grand trouble pour le fils de l’Oberbürgermeister. Son père le retira de l’école et le plaça dans un institut spécialisé, où on soignerait sa mégalomanie et ses penchants pédophiles prononcés. Il y resta de longues années et je crois qu’il vient, la semaine dernière, de s’y éteindre.
Identité nationale, Joffrin accepte de débattre

On se souvient. On devait avoir vaguement 17 ans et, pour avoir le bac, il fallait être capable de faire un commentaire composé qui tienne vaguement la route. Manifestement, aujourd’hui, pour sembler être de gauche à propos de l’identité nationale, il faut être capable de ficeler un devoir sur table avec un certain nombre de mots-clés (mixité, mélange, métissage, etc.). À ce petit exercice, Laurent Joffrin excelle, comme il vient de nous le prouver dans son édito de Libération de ce mardi. Du coup, lecteur, au titre de la légitime défense, nous reprenons, nous aussi, nos talents de commentateurs composés pour te désosser la bête. Histoire que tu ne sois pas surpris si, demain, à table, tu te fais traiter de gauche scrogneugneu.
Principe : on prend l’édito tel quel et on fait les commentaires fielleux au fur et à mesure. On précise pour les mauvais coucheurs : rien n’a été rajouté dans la prose joffrinienne ; pas besoin, elle tient debout toute seule…
« Un débat sur l’identité nationale… Et pourquoi pas ? On comprend que l’opposition dénonce, dans la proposition d’Eric Besson, un calcul électoral destiné à siphonner les voix du FN, autant qu’une conception méfiante et essentiellement défensive de la nation, qui serait menacée par l’immigration, comme l’indique l’intitulé même de son ministère. Mais précisément : plutôt que de traiter la discussion par le sarcasme ou le rejet de principe, ne faut-il pas opposer à cette craintive attitude qui débouche, entre autres, sur le renvoi de trois réfugiés afghans dans leur pays en guerre, une autre conception, ouverte, évolutive et généreuse ?
On passera sur l’amorce de l’édito, le « et pourquoi pas » qui montre que Joffrin tout de gauche qu’il est, n’a pas froid aux yeux, lui, contrairement ces affreux socialo-communistes qui sont habités par une « craintive attitude ». La Nation, lui, il en fait son affaire.
« Il est passé le temps où un soixante-huitardisme mal compris faisait de la nation, vocable projeté sur la scène de l’histoire à Valmy, un mot plus ou moins obscène. Ce qui est national n’est pas nécessairement louche, intolérant ou vichyste. Cette «reductio ad petainum» paralyse la réflexion. Faut-il jeter aux orties Hoche, Lamartine, Jaurès ou Jean Moulin, coupables de défendre le drapeau, c’est-à-dire la République ? »
Miracle rue Béranger : à ce stade du texte, Laurent Joffrin est soudain devenu chevènementiste ! Et si ça se trouve, plus que Jean-Pierre lui-même, comme le prouve la suite.
« Ou encore la Commune, insurrection patriote autant que sociale, noyée dans le sang par une bourgeoisie empressée de se rendre pour massacrer à loisir la classe ouvrière, comme d’autres préféraient Hitler au Front populaire ? Après tout, il y a aussi du rouge dans le drapeau tricolore et s’il a couvert les crimes de la colonisation ou de la collaboration, heures sombres qu’il faut stigmatiser sans faiblesse, il reste celui de la Révolution française, qui fut, comme le disait Hegel, un lever de soleil. »
Ouf, fausse alerte ! La crise de boboïte aïgue au sens archéologique du terme bobo (bolchévique-bonapartiste) n’était qu’une éruption cutanée, on est revenu illico presto à l’acception libérale-libertaire courante de la boboïtude. Si ça se trouve, cette trop brève incursion joffrinienne dans le camp social-républicain n’était qu’un leurre, une bête argutie stylistique destinée à mangouster l’adversaire. La suite nous prouvera que oui.
« Les républicains et la gauche dénoncent justement le poison mortel du nationalisme, qui porte la guerre et l’intolérance comme la nuée l’orage. Ils ne sauraient laisser la nation au Front national ou à l’UMP, qui s’en serviront contre elle, alors que la gauche en est, autant ou plus qu’eux, partie intégrante. »
Ah, « la nuée et l’orage »… ça faisait longtemps. Mais ça aurait pu être pire, on était à deux doigts du « ventre encore fécond »… Mais, trêve de plaisanterie, on va passer aux choses sérieuses.
« Le débat est d’autant plus légitime que la définition de l’identité nationale doit évidemment changer. Il y a sur ce point urgence conceptuelle. Depuis deux siècles, la France est terre d’immigration. Or on sait que l’assimilation longtemps pratiquée et qui exhale aujourd’hui des relents coloniaux, ne saurait servir de viatique pour le siècle nouveau, quoi qu’en dise une certaine gauche républicaine et scrogneugneu qui s’accroche à ce modèle vétuste comme à un canot percé et laisse du coup la droite mener la discussion.
Donc, premier enseignement, Joffrin ne cible pas la droite, mais la gauche. Enfin, une certaine gauche. La nôtre. Celle pour qui l’assimilation n’est pas un gros mot, mais un impératif catégorique, une machine à gagner ensemble. Qui pendant vingt siècles a fait tourner la boutique en fabriquant de bons Français à la chaîne, sans distinction de pedigree. En privilégiant le droit à la ressemblance à celui à la différence. Justement ce que Lolo trouve dégoûtant.
« Plus de 4 millions de citoyens d’origine étrangère, qui ne sont pas moins français que les autres, demandent à garder une part de leur identité traditionnelle. Au nom de quoi le leur interdirait-on ? La France future sera tissée, en même temps que de christianisme ou de laïcisme, de culture musulmane, d’esprit africain ou de tradition ultra-marine. Ces apports sont un enrichissement et non une menace. Se contenter de dénoncer la burka, ce qui peut certes se comprendre, c’est refuser de voir cette réalité nouvelle et à bien des égards positive. La dénonciation du communautarisme – fondée en théorie – finit par couvrir une forme d’allergie à la différence. La France est d’ores et déjà plurielle. On ne saurait le nier, à l’heure de l’Europe et de la mondialisation, qui sont par nature mélange et métissage.
Roulement de tambours, on vient d’atteindre le climax de l’édito. En bon artisan, Joffrin vient de parachever le chef-d’œuvre de compagnon du Tour de néo-France. Tout y est. La mauvaise foi : « Au nom de quoi leur interdirait-on ? » L’amalgame : « Un enrichissement et non une menace ». La caricature : « L’allergie à la différence ». Et surtout Lolo fait massivement appel aux mots magiques de la France qui pense bien, ceux qui comptent triple au scrabble de l’éditorialiste : métissage, France plurielle, culture musulmane, Europe, bref tous les gadgets qui structurent l’arc idéologique de la modernitude, qui va d’Olivier Besancenot à Carla Bruni. Et comme nous sommes de très vilains enfants, nous voulions juste – en toute mauvaise foi, après tout pourquoi en laisserions-nous la jouissance à autrui – nous adresser à l’inconscient de Laurent qui, manifestement, a encore une fois débordé (remembre la « race juive »), cette fois, en accolant comme par malice le substantif « esprit » à l’adjectif « africain ». C’est bien connu, là-bas, au pays des esprits, c’est grigri, féticheurs et compagnie… Mais trêve de mauvaise psy, retournons à notre analyse.
« Encore faut-il rappeler les valeurs communes de la nation, au moment où une partie des citoyens voient leurs droits niés ou dépréciés par la relégation sociale. Elles ne sont ni ethniques, ni religieuses ni culturelles. Il n’y a pas d’essence nationale. Il y a une adhésion volontaire à des principes, qui sont ceux de la République et des droits de l’homme, comme le préconisait déjà Renan. C’est la volonté de vivre ensemble dans la coopération et la liberté qui définit la nation, et non un soi-disant fait de nature ou d’histoire, intangible et fermé. A condition, bien entendu, que ces principes deviennent réalité et que l’égalité des droits entre dans les faits pour les minorités victimes de discrimination. Renan disait aussi que la nation repose sur une histoire et une culture communes, établies par le temps. La chose est toujours vraie, à condition d’admettre que cet héritage puisse être enrichi, modifié, amendé par des apports nouveaux, et qu’il laisse leur place aux influences du grand large dans une nation à l’humeur résolument cosmopolite. Une nation nouvelle qu’une gauche tournée vers l’avenir devrait promouvoir sans complexes.
Evidemment, là, il faut remettre une couche de social, pour faire degauche. Pas de panique, on ne va pas tout de même pas embêter le lecteur en parlant de chômage, d’emplois précaires ou autres vieilleries conceptuelles. On va broder sur la nouvelle ligne de fracture, la discrimination. Chirac 1995 reloadé Sarkozy 2005, le tout remixé par DJ Derrida, bingo !
En conclusion, nous dirons que, si une fois de plus l’élève Joffrin est stylistiquement faiblichon (Lolo, nom de Dieu, vas-y mollo sur le dico des citaces !), il est politiquement efficace : il fait tout ce qu’il peut pour empêcher toute riposte organisée à Eric Besson. En ciblant uniquement ceux qui, à gauche, n’ont pas peur de s’écarter de la vulgate métisso-mondialisatrice, ceux pour qui ni la burqa ni même le voile ne sont solubles dans la République, ceux pour qui la sacro-sainte mixité ne s’arrête pas aux portes des piscines, bref ceux qui pouvaient rendre les coups à une UMP de plus en plus communautariste, il aura contribué au rétablissement d’une Sarkozie défaillante. Merci qui ?
Castrez-les tous !

Le débat sur le sort à réserver aux criminels sexuels, et plus particulièrement aux récidivistes de la chose, est récurrent dans notre société, et ressurgit à chaque fois qu’un fait divers particulièrement horrible met le public en émoi.
L’affrontement des « laxistes » et des « répressifs » constitue le rituel agonistique d’une querelle où l’on fait assaut de mauvaise foi et d’arguments péremptoires sur le mode yaka et faucon.
Dans une société régie par le principe de précaution et l’impératif du risque zéro, il est impossible aux gouvernants de tenir un discours qui prendrait acte de l’impossibilité de prévenir totalement ce genre de drame. C’est pourtant le seul qui tiendrait compte de tout l’acquis scientifique rassemblé à ce jour sur la dangerosité potentielle des criminels sexuels répertoriés.
Du côté des « laxistes », ceux qui s’opposent au durcissement continu des peines infligées aux pédophiles, violeurs et incestueux, on tire argument que le taux de récidive des criminels sexuels relâchés après avoir purgé leur peine n’est que « de 1 à 2% ». En conséquence, il serait inhumain de faire payer à l’écrasante majorité des non-récidivistes les crimes de quelques individus dangereux et pervers. Comme on peut faire dire aux chiffres n’importe quoi, on va pêcher dans un amas de statistiques ceux qui conviennent le mieux à votre démonstration, en laissant soigneusement de côté d’autres plus dérangeants pour la thèse que l’on défend.
Ce taux extrêmement réduit de récidive des criminels sexuels est établi à partir de données policières et judiciaires sur les actes relevant de cette criminalité répertoriés sur le territoire. Il signifie seulement que 1 à 2% des crimes élucidés sont le fait de personnes ayant déjà été condamnées pour des faits semblables, et ayant recouvré la liberté. Cela exclut de la statistique toutes les affaires non signalées et non élucidées.
Si l’on essaie de fouiner un peu dans la littérature psychiatrique et criminologique relative à la question, on découvre que le taux de récidive de ce type de criminel est nettement plus élevé. Les études les plus récentes (la plupart effectuées dans les pays anglo-saxons, Etats-Unis, Angleterre et Canada) établissent un taux moyen de récidive entre 15 et 20 % avec des variations significatives selon les catégories de criminels. Les parents ou beaux-parents incestueux réitèrent beaucoup moins fréquemment leurs forfaits que les prédateurs sexuels extra-familiaux. Pour l’anecdote, les plus incorrigibles sont les exhibitionnistes, qui sont plus de 40% à persister à ouvrir leur imperméable à la sortie des écoles après avoir subi les foudres de la justice.
Le problème des récidivistes n’est donc pas marginal ou seulement surgi de la boite à outils populiste de quelques politiciens de droite et d’extrême droite.
D’autres études essaient d’établir une corrélation entre le suivi médico-social des criminels libérés et la récidive. La comparaison du comportement d’un groupe d’individus laissés à eux-mêmes à leur sortie de prison et d’un groupe pris en charge dans le cadre de thérapies comportementales et cognitives est peu concluante : certaines d’entre elles montrent une nette diminution de la récidive chez les seconds, d’autres, au contraire révèlent qu’une thérapie imposée aux sortants n’a aucun effet sur leur comportement ultérieur.
L’argument des « laxistes » consistant à affirmer qu’en y mettant les moyens, une prise en charge thérapeutique sérieuse au cours de la détention et à la sortie préviendrait de nouveaux drames n’est donc pas corroboré, loin s’en faut, par l’état actuel de nos connaissances.
En revanche, il existe une méthode, paraît-il assez fiable, d’établir un pronostic sur la potentialité de récidive des criminels sexuels, la pléthysmographie. Cela consiste à enregistrer les variations de volume du pénis du sujet lorsqu’il est soumis à des stimuli sexuels interdits au sens du code pénal (pédophilie, scènes de viols etc…).
Cette technique, largement pratiquée aux Etats-Unis, ne semble pas avoir traversé l’Atlantique…
Mais, même si l’on arrivait à prévoir avec un degré de fiabilité suffisant le comportement des condamnés ayant purgé leur peine, il resterait à décider ce que l’on en fait. Bouclage à vie ? Castration chimique ? Castration physique ? Tout cela n’est pas compatible avec l’idée que notre civilisation se fait de la morale et des droits de l’homme, et ne garantit même pas que ces individus ne trouveront pas d’autres moyens que l’usage de leur sexe pour assouvir leurs pulsions.
Et si l’on décidait, tout simplement, de faire avec ?
Joyandet remet en selle le Tour du Faso
En ces temps de surenchère castratrice et de gadgetisation de l’identité nationale, c’est trop peu souvent que j’ai l’occasion de féliciter un membre du gouvernement. Et croyez-moi, je le regrette : après tout, moi aussi je paye des impots, et je serais bien content qu’il servent à autre chose qu’à gonfler, grâce à la TVA réduite, la marge brute de McDonald ou à faire prospérer la PME de sondages de Pierre Giacometti. Un grand bravo donc à Alain Joyandet, secrétaire d’Etat à la Coopération et à la Francophonie, qui est intervenu personnellement en fin de semaine dernière auprès de l’AFD, l’Agence Française de Développement, pour que le Tour du Faso, en proie au pires difficultés financières, puisse se tenir cette année, grâce à un chèque de 115 000 Euros, qui a permis de boucler le budget, ou plutôt de budgétiser la Boucle. Vous n’êtes pas obligé de me croire sur parole, mais ce Tour-là, qui se court cette semaine au Burkina, est une des plus belles épreuves cyclistes du monde. Un Tour à la dure, sans aucune concession au XXIème siècle où les cadors réparent eux-mêmes leurs vélos au bord des pistes et dorment chaque nuit à la belle étoile. Vous pouvez d’ailleurs vous faire une idée par vous-même en regardant le résumé quotidien tous les soirs sur TV5 Monde, qu’on félicitera donc aussi au passage.
Un charter, pour quoi faire ?

« Charter pour la guerre. » Ils ont dû être contents, à Libé, d’avoir trouvé ce titre. En quatre mots tout est dit. Leur fragilité et notre inhumanité. On les imagine, des centaines de malheureux jetés sans ménagement dans le pays embrasé auquel ils avaient réussi à échapper au péril de leur vie. On aimerait connaître les bureaucrates insensibles ou les juges au cœur dur qui ont pris cette décision. On veut être du côté de la générosité, avec Philippe Lioret, réalisateur de Welcome, promu expert es sans-papiers, ce qui serait rigolo si le sujet était un peu moins lourd. À ce compte-là, on fera bientôt témoigner Al Pacino aux procès de la mafia et Christian Clavier écrira une thèse sur le Moyen Âge.
On n’a guère envie d’ironiser, même si toute la presse évoque un « charter » pour trois hommes (il semble qu’il y avait pas mal de journalistes dans ce charter-là). Parce que trois hommes, c’est trois hommes et que leur « rapatriement forcé » – terme propre destiné à noyer le poisson de l’expulsion – décrit précisément le fossé tragique qui sépare la politique de l’humanitaire, la raison d’Etat des droits de l’individu et la gestion technocratique de la compassion humaine. Il n’y a pas, en politique, une main invisible qui réconcilie le bien commun et la vie des gens. Que l’immigration clandestine soit difficilement supportable pour les heureux habitants du monde développé ne change rien au fait qu’elle est pour un très grand nombre d’êtres humains une nécessité vitale. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle « l’infraction à la législation sur les étrangers » n’est pas un délit comme un autre : sur le plan moral, on admet parfaitement que le délinquant transgresse la loi. En conséquence, notre cerveau droit peut approuver une décision raisonnable et notre cerveau gauche saigner pour le sort de ceux qui jouent le rôle des œufs dans l’omelette indigeste qu’est la politique migratoire (c’est peut-être le contraire, j’oublie toujours). Encore faut-il accepter de mobiliser l’un et l’autre.
Si on adopte le seul point de vue des trois Afghans renvoyés chez eux, on ne peut que se désoler. Or, c’est celui que les médias, producteurs d’émotion à jets continus, font naturellement prévaloir. Une décision politique, ça ne fait pas une bonne histoire. Dans le village planétaire, la raison collective est priée de s’incliner devant le malheur individuel. Ces hommes, nous connaissons leurs visages, nous les avons vus pleurer. Nous avons lu dans leurs yeux le désespoir de ceux qui ne peuvent plus rêver d’un avenir meilleur. Leur souffrance est la nôtre. Nous avons entendu la gauche s’indigner en boucle et un responsable associatif nous expliquer qu’ils n’auraient d’autre choix que « de se faire mutiler ou enrôler par les Talibans ». Nous avons été un peu soulagés de savoir que l’ambassade de France les avait pris en charge. Reste que nous nous sentons coupables et comptables de l’injustice qui les a fait naître dans un pays qui a raté l’entrée dans la modernité sans parvenir à se faire oublier de l’Histoire.
Face à ces existences détruites, les arguments d’Eric Besson (qui sont, peu ou prou, ceux de tout ministre en charge, de droite ou de gauche, sur l’immigration clandestine) sont glacés, à côté de la plaque. Le ministre de l’Immigration et du Reste est inaudible quand il affirme que les trois expulsés avaient épuisé toutes les voies de recours (ce qui signifie notamment qu’ils n’avaient pas demandé l’asile en France ou que ce statut leur a été régulièrement refusé). On ne l’écoute pas plus quand il explique que le fait de venir d’un pays en guerre ne vaut pas titre de séjour. D’accord, c’est triste. On a le droit de récuser cette proposition et de refuser les expulsions mais alors, il faut être cohérent et décréter que la France est un droit pour tous les ressortissants de tous les pays en guerre. Oui, nous serions fiers si notre pays accueillait toute la misère du monde tout en intégrant au roman républicain tous ceux qui se trouvent régulièrement sur son sol. Pour autant, sommes-nous prêts à manifester pour une augmentation massive des impôts ? Il convient aussi de demander à tous les Français de se porter volontaires pour que leur ville ou leur quartier abrite les prochaines « jungles » – il est à craindre que les habitants de Calais et ceux du Xe arrondissement de Paris ne soient guère enthousiastes mais sans doute sont-ils lepénistes. (Du reste, à en croire l’inévitable sondage CSA-Le Parisien, l’opinion est plutôt partagée sur le sujet, 44 % des sondés se déclarant opposés au renvoi tandis que 36 % s’y disent favorables.)
On dit, pour le dénoncer avec force, que cette expulsion est un « coup » politique. Certes, mais est-il condamnable en soi de faire de la politique ? Oui, il s’agit bien d’adresser un message à tous les candidats potentiels à l’immigration, de leur faire savoir que s’ils décident quand même de tenter l’aventure ils courent le risque de perdre beaucoup de temps, d’argent, d’énergie et d’espoir pour se retrouver à la case départ. En vrai, c’est un tout petit signal et il est possible que beaucoup d’Afghans tirent de la mésaventure de leurs compatriotes l’idée qu’ils pourront passer à travers les mailles du filet – trois expulsés pour combien qui ont réussi ? Seulement, ce n’est pas l’efficacité de la politique migratoire du gouvernement qui est contestée mais, comme toujours, son existence même. Il est tout de même curieux que toute la presse pousse des cris d’orfraie parce qu’un ministre propose un débat sur le thème « Qu’est-ce qu’être français ? ». Comme si la question était dénuée d’intérêt voire moralement indigne. Peut-être que pour nos belles âmes, poser la question, c’est déjà y répondre. En clair, Eric Besson a forcément derrière la tête l’idée qu’être français, c’est être blanc (si c’était aussi simple, on n’aurait sans doute pas besoin de se poser la question).
Un débat, et puis quoi encore ? Les mecs de droite, ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît. Pour ma part, je trouve que dans la confusion ambiante, la question vaut d’être posée mais c’est sans doute la preuve que, moi aussi, je suis de droite.
La politique consiste à concilier le bien commun et celui de chacun, parfois à sacrifier celui-ci à celui-là. En matière d’immigration, c’est le prix à payer pour ne pas mettre un peu plus en danger la cohésion nationale. Pour autant, on a le droit de s’attrister. Et l’indifférence britannique aux expulsions (qui ne concernent pas, là-bas, trois personnes mais plusieurs dizaines et plusieurs fois par an) n’est pas plus sympathique que le sentimentalisme qui, chez nous, tient lieu de toute réflexion. On apprend en effet dans un excellent sujet diffusé au « 20 heures » de France 2 le 21 octobre que la presse anglaise n’a pas consacré une ligne à la question.
François Fillon estime que la France n’a pas à se sentir coupable. Il me semble qu’il a un peu tort. La culpabilité qu’on éprouve quand on fait du mal, même si on n’a pas d’autre choix, fait partie de notre humanité. Avoir des états d’âme peut être inutile, parfois dangereux, mais c’est la preuve qu’on a une âme.
Autocritique
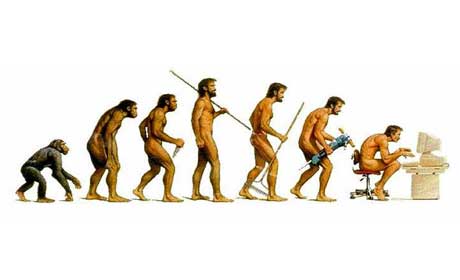
Le pire, quand on a écrit un bouquin, c’est les questions débiles auxquelles il faut répondre, genre : « Pourquoi avez-vous écrit ce livre ? » ou, pire encore : « Pourquoi ce livre ? Et pourquoi vous ? »
La première réponse qui me vienne à l’esprit tient tout entière dans ce mot d’Oscar Wilde : « Tout ce qui vous arrive vous ressemble ! ». Et avec tout ce qui m’est arrivé sans me vanter, je pourrais en remontrer à n’importe qui question inculture générale.
Lorsque j’étais étudiant, il me fallait bien gagner un peu d’argent ; et comme à l’époque l’EPAD n’existait pas encore, eh bien je donnais des cours particuliers.
Mais mes besoins financiers ne cessaient d’augmenter, à tel point que j’ai finalement été contraint d’enseigner aussi des matières que je n’avais jamais apprises, comme par exemple l’allemand.
Bien sûr, je m’étais fixé quelques règles déontologiques de base. Je n’acceptais comme élèves que des débutants de 6ème, et jamais plus intelligents que moi.
Dans ces conditions, ça ne pouvait que marcher ; même les parents s’extasiaient sur cette pédagogie subtile : se mettre au niveau de l’élève, pour mieux l’accompagner dans sa découverte de la langue de Goethe et de Tokio Hotel.
Un peu plus tard, j’ai décroché mon premier vrai boulot : professeur d’histoire-géographie dans une école d’électronique.
L’histoire était pourtant la seule matière où je n’avais pas eu la moyenne au bac, et pour cause : j’avais fait l’impasse sur la Révolution française !
Mais il y a des grâces d’Etat : dans cette école d’électronique, l’histoire-géo ne comptait pas pour passer dans la classe supérieure, et mes élèves n’ont pas tardé à me le faire savoir par tous moyens. Bref, ils s’en foutaient, mais pas autant que moi – et sur ces bases on n’a pas eu trop de mal à s’entendre.
Et puis j’ai fait mes premières armes en tant que nègre d’hommes politiques avec le regretté Raymond Barre. En ce temps-là, Raymond était Premier ministre, et il devait prendre la parole dans, je cite, « un grand meeting des Jeunes Centristes ». J’ai tout de suite senti qu’il y avait un loup.
En fait, ces gens-là ne se faisaient guère d’illusion sur leurs capacités de mobilisation : dans toute la France, ils avaient affrété des cars pour faire monter des jeunes à Paris, en leur promettant un bon repas chaud et un concert gratuit de Chuck Berry !
Mais là encore, problème d’inculture : Raymond n’avait jamais entendu parler de Chuck ! On a eu beau essayer de le raisonner, rien à faire… Pas question pour lui de se produire en première partie : Raymond voulait la vedette !
Alors, ce qui devait arriver arriva. Après le set de Chuck Berry, les gradins se sont vidés en moins de temps qu’il ne faut pour chanter « Johnny B. Goode ». Et c’est devant une salle aux trois quarts vide que Barre a lancé son Appel à la jeunesse de France.
Puisque j’en suis aux révélations, allons-y ! Au fil de ma carrière, peu de gens le savent, j’ai aussi été amené à travailler, entre autres, pour un certain Charles P… au ministère de l’I…
Là-bas, il arrivait parfois qu’on me cherche – notamment le matin. Ma secrétaire avait alors pour consigne de répondre que j’étais à la bibliothèque de l’Assemblée nationale, en train de ciseler un discours pour le ministre. En fait bien sûr je dormais profondément, après une dure nuit de sociologie du nightclubbing.
C’est de cette riche expérience en matière d’inculture générale que j’ai souhaité faire profiter aujourd’hui mes contemporains. Une démarche humaniste au sens plein du terme, puisqu’elle n’a d’autre but que l’élévation de l’homme.
Elévation spirituelle bien sûr, comme l’ensemble de mon œuvre. Mais élévation sociale aussi : grâce à ce petit livre vert, plus jamais vous n’aurez l’air ridicule en société. « La culture, c’est ce qui reste quand on a tout oublié », disait Édouard Herriot. Eh bien, avec moi, vous pourrez faire mine d’avoir oublié tout ce qu’en fait vous n’avez jamais su !
Fils à baba
Au bord du Nil tout comme sur les rives de Seine, les mêmes questions se posent. Au même moment où feue la candidature de Jean Sarkozy à la présidence de l’EPAD faisait débat ici, la presse égyptienne était fort préoccupée par l’avenir professionnel du « fils de » national, Gamal Moubarak. Ce dernier est lui aussi candidat à une présidence, mais, dans son cas, il s’agit de celle de la République arabe d’Egypte. Sinon, les deux débats se ressemblent à s’y méprendre. Ainsi Mohamed Heikal, ancien rédac’ chef de Al Ahram et proche de Nasser, a jugé la candidature de Moubarak Jr inadmissible. Grâce à Zvi Barel de Haaretz nous pouvons vous citer cet extrait aux airs de déjà vu d’un entretien donné par Heikal au quotidien Al-Masri al-Youm : « Même s’il est l’homme le plus qualifié en Egypte pour ce poste [..] être candidat n’est pas son droit parce que précisément il n’est pas un citoyen comme les autres, parce qu’ils lui donnent ce qui n’est pas donné aux autres. » Malgré toutes les médisances, force est de reconnaitre que, dans certains domaines, l’Union pour la Méditerranée avance à grands pas.
On n’est pas sérieux quand on a 76 ans
Après Roman Polanski, détenu dans la prison de Winterthur pour avoir eu des relations sexuelles il y a trente quatre ans avec une jeune fille mineure, il semblerait que la Nemesis judiciaire de l’Empire du Bien, qui règne désormais sans partage sur les consciences, fasse une fixette d’ordre névrotique et gérontophile sur les septuagénaires, dès qu’ils atteignent très précisément les 76 ans, âge de l’auteur du Bal des Vampires, mais aussi de Sonja Sonder. Cette Allemande vivant en France, aurait appartenu avec Christian Gauger, 68 ans, a une organisation terroriste allemande des années 1970, responsable notamment de l’attentat contre l’OPEP à Vienne en 1975. L’Allemagne, qui avait déjà demandé leur extradition, avait été déboutée en 2000. C’est au nom d’une hypothétique « convention de Dublin » jamais appliquée en France que François Fillon, qui serait Premier ministre, aurait signé un nouveau décret autorisant finalement cette extradition. Nous conseillons donc à toutes les personnes atteignant cet âge fatidique ces jours-ci de bien vérifier les zones d’ombres de leur passé (vols de sucettes, recel de bâtons, rédactions rendues en retard) s’ils veulent éviter une arrestation surprise.
Prix littéraires : tous pourris ?

Tous les ans, un petit vent d’octobre secoue le même marronnier. Tous les ans, c’est la saison, les gazettes résonnent des mêmes flonflons. Vas-y Mimile, les prix sont corrompus, chauffe Marcel, les renvois d’ascenseurs dans la presse, et allez donc, les copinages, et Galligrasseuil, etc. Ça chaloupe dur pendant quelques semaines, et puis ça se calme, ça reviendra l’année suivante, comme la trêve des confiseurs, les giboulées de mars, le bal du 14 juillet, tout ça. On ne s’en lasse pas. On s’y attache, au contraire. La corruption littéraire fait partie du sympathique folklore français, comme l’accordéon, le béret basque et le fromage qui pue. On y tient. Les Américains, ces puritains, n’en ont pas, eux. Et puis ça ne porte pas à conséquence.
Les Français adorent tourner en rond en répétant les mêmes figures. Mais pour ça, il convient d’endosser le déguisement qui convient. La bourrée de la corruption littéraire se danse en costumes typiques. Costume poujadiste : tous pareils, tous pourris. Costume cynique : corrompus, oui, et alors ? Ça n’empêche pas d’être un bon écrivain. Costume vertueux : il faut dénoncer les collusions, moraliser la vie littéraire. Costume nietzschéen : Et alors ? Les moralistes et les curés nous fatiguent. Costume fataliste : de toutes façons, c’est pareil partout, on n’y peut rien. Costume taquin : c’est çui qui le dit qui y’est. Costume renseigné : mais on le sait bien, tout ça. Chacun fait son petit tour sur scène, c’est joli à regarder.
Chaque année, il faut dire que l’orchestre y met du cœur. On change un peu les paroles, mais ce sont toujours plus ou moins les mêmes musiques. On rit, on s’amuse, on en redemande. Donnons quelques exemples de rengaines, histoire de savoir de quoi nous parlons. Une trouvaille récente : La Bibliothèque nationale de France vient de créer un nouveau prix littéraire, destiné à récompenser un écrivain majeur d’aujourd’hui. Il a été décerné au printemps dernier. Qui est l’heureux lauréat ? Philippe Sollers. Et qui figure dans le jury du prix ? Julia Kristeva, épouse de l’heureux lauréat. Très joli, bravo. Quelqu’un s’est-il ému qu’une institution d’état fonctionne tranquillement au népotisme ?
Il est vrai qu’on a là une figure récurrente du folklore. Pour ne donner que deux autres exemples, Yannick Haenel et François Meyronnis publient en 2005 Poker, un livre d’entretiens avec Sollers, précédé de quelques pages d’adoration lyrique (« Il y a en effet chez Sollers […] cette force d’acuité qui lui permet d’avoir accès aux expériences verbales les plus extrêmes » ; « l’étrange individu nommé Philippe Sollers est capable de jouir des tourbillons de la case vide ; il est donc le mieux placé pour entendre Yannick Haenel, me dis-je, avec une extravagante modestie »). Et qui publie ce livre d’adoration envers Sollers ? Mais Sollers, bien sûr, dans sa collection de « L’Infini ». Pas mal. Peu de temps après, le prix Décembre couronne Yannick Haenel, pour un roman publié dans la collection « L’Infini ». Et qui figure dans le jury du prix ? Philippe Sollers, éditeur de l’heureux lauréat. Car toute peine mérite salaire. C’est à ce prix qu’on arrive.
Mais on n’en finirait pas de faire la liste, BHL (du Point) nous fournirait mille exemples à lui seul. Dernier en date : il vient de faire l’éloge de Yann Moix (du Figaro), qu’il considère comme un grand cinéaste. S’il n’est pas certain que Yann Moix soit un aussi grand cinéaste que, mettons, BHL, il semble en revanche avéré que le sens du grotesque se perd dans nos élites intellectuelles.
Naguère, l’air des articles de complaisance était joué par de vieux ménétriers. La relève est assurée brillamment par les jeunes, notamment Yann Moix, le Howard Hawks du XXIe siècle, qui, dans Le Figaro, trouve que Philippe Labro, du Figaro, est un aigle, un phénix, un Faulkner, ou qui passe la rhubarbe à Beigbeder, lequel lui refile le séné. Sans parler de toute la partie invisible : Machin écrit un article élogieux sur le dernier livre de Truc publié par la maison Chose. On ne sait pas que la maison Chose a versé un copieux à-valoir à Machin pour un livre qu’il n’a jamais écrit. Machin rembourse en articles. Passons sur les jurys de prix littéraires qui volent au secours du succès, ou votent comme de bons godillots pour obéir au président ou aux pressions de leur éditeur.
Oui, mais qui peut se vanter d’être un pur ? Qui est assez impeccable pour donner des leçons ? Tout dénonciateur de pailles n’a-t-il pas une poutre dans l’œil ? Sans endosser le costume du cynique ou du poujadiste, on peut estimer que la compromission est inhérente à la vie sociale et professionnelle. Que vivre, c’est faire des compromis avec ses idées, dans presque toutes les situations, client, parent, amoureux, touriste, salarié, etc. Un écrivain a des amis, des éditeurs, connaît des journalistes, publie des papiers dans tel ou tel journal, reçoit des prix, figure dans des jurys. Peut-il jurer de ne s’être jamais trouvé dans une situation où il va favoriser un ami ? De ne s’être jamais fourvoyé dans des émissions télévisées bas de gamme ? On ne pourrait à la rigueur jouer les purs que si l’on dénonçait les travers du dehors. Mais en travaillant, en consommant, en vivant tout simplement, on est compromis, et on fait des compromis.
Il ne s’agit pas de tout justifier, ni de tomber dans un confortable relativisme mais d’éviter les deux ornières complémentaires du rigorisme moralisant et de l’indifférence cynique. Le puriste dénonce tout le monde indistinctement, ce qui revient à ne pas faire de différence entre les comportements, et les vrais corrompus en profitent pour mener leurs petites affaires tranquillement. Les voilà justifiés : ils ne sont pas pires que les autres, ils sont pareils. Le puriste, qui ne distingue pas, est le complice objectif de la corruption. De même, la rébellion est devenue un argument commercial et une pose de notables. On croule sous les rebelles, mais on manque de critiques.
Faudrait-il alors, pour éviter tout conflit d’intérêt, se retirer du monde ? Faudrait-il que les écrivains ne puissent pas être en même temps critiques littéraires ? Mais qui est vraiment retiré du monde ? L’austère Julien Gracq a pratiqué aussi la critique sur la littérature de son temps. Il s’est engagé. Le meilleur de notre critique, celle qui reste, c’est celle des écrivains : Barbey, Schwob, Bloy, Mérimée, Gourmont, Baudelaire, Sartre, Jacques Laurent, Vialatte, etc. Dans une conception rigoriste de la déontologie littéraire, ils n’auraient pas dû publier d’articles critiques. Et nous n’aurions plus, à ranger dans l’histoire de la critique littéraire, que Paul Souday, Duvergier de Hauranne ou André Chaumeix.
Il faut tenter de coller au plus près à un idéal d’honnêteté, savoir dire non, tout en sachant qu’on est dans le bain, et que dès lors on ne détient aucunement le privilège absolu de la vertu. L’important, c’est de distinguer. Les situations et les cas sont complexes, autant que la réalité humaine. C’est au prix de cette distinction qu’on pourra éventuellement se permettre de dénoncer.
Fashion police à Gaza
On a trop souvent prétendu, et parfois ici même, que les forces de sécurité gazaouites servaient de couverture légale à des activités terroristes. Ce n’est pas vrai, ou plutôt ce n’est qu’une partie de la vérité, puisque, comme vient de nous l’apprendre le Guardian, elles ont bien d’autres activités. Son envoyé spécial sur place a pu observer la multiplication des contrôles de police sur les plages locales. Des officiels en armes dispersent les couples non mariés, renvoient chez elles les jeunes filles non chaperonnées par un individu mâle de leur famille et, faut-il le dire, font passer un mauvais quart d’heure aux femmes de 0 à 99 ans en tenue jugée indécente. Mais n’allez surtout pas voir là un quelconque sexisme : d’après le reporter du Guardian les messieurs qui auraient le mauvais goût de bronzer vêtus de leur seul maillot de bain sont eux aussi rhabillés pour l’hiver…
Népotisme pour tous

Le fils du maire de K. était un garçon brillant. À l’âge de 5 ans, il avait déjà remporté trois fois le concours annuel de billes du village. À 6 ans, un premier poil apparaissait sur son menton, qui occupa, une année durant, l’académie de médecine du Land. Tout lui réussissait, rien ne semblait l’arrêter – pas même la cuiller en or qui encombrait sa bouche depuis sa naissance et qui lui aurait conféré une élocution drolatique s’il avait été un autre.
Or, il advint que l’enfant, qui avait déjà tout fait, parvint à ses 8 ans et s’estima en âge de tâter de la politique : le sport et le physique vous lassent vite un homme quand de plus hauts objets se présentent à lui. En septembre 1951, on le vit donc se présenter à l’élection de délégué de classe de 10e de l’école municipale de K. Il fit sa campagne comme pas un et promit à ses camarades monts et merveilles : il se battrait pour qu’on réaménage la cour et qu’enfin l’on nettoie le bac à sable de ses lichens et de ses fientes. On supprimerait les épinards servis le mardi à la cantine et les frites remplaceraient les pommes vapeur du vendredi. Lorsqu’il déclara que les brocolis et les salsifis n’auraient plus le droit de cité sur les tablées du réfectoire, ce fut, de toute part, une ovation. Le vote n’avait pas eu lieu qu’il était déjà élu.
Mais la vie n’est pas simple et l’épicier du village, qui avait fait le point sur le manque à gagner qu’une élection du fils de l’Oberbürgermeister provoquerait, envoya son propre fils se présenter contre lui. L’affaire aurait pu se régler à la récré : une partie de billes, un échange diplomatique de gnons et de mandales, un concours de zizi dans les toilettes pour garçons. Les choses s’étaient déjà envenimées : le fils du maire fut accusé de tous les maux et les pires rumeurs l’affectèrent. On n’hésita pas à prétendre qu’il faisait encore pipi au lit, qu’il mangeait ses crottes de nez et, pire que tout, qu’il n’était qu’un gros fayot. Ne l’avait-on pas vu plusieurs fois s’attarder auprès de Mlle W., l’institutrice de la petite classe, pour s’enquérir de sa santé ou lui porter son sac ? La petite crapule…
Le sommet fut atteint lorsque d’infâmes soupçons de pédophilie touchèrent le fils du maire : c’est qu’il avait le béguin pour une petite de 11e et le bisou qu’il lui avait donné sur la joue, deux ou trois jours après la rentrée, ne plaidait guère pour sa défense. Des attouchements sur une gamine, quand même ! S’il n’avait pas été le fils de l’Oberbürgermeister, je vous fiche mon billet que la police serait venue l’emporter manu militari pour lui couper les couilles.
C’est ce que pensa le pasteur S. lorsque l’histoire parvint à ses oreilles. Son sang ne fit qu’un tour. Révulsé par l’impunité du fils du maire, il alla trouver le directeur de l’école et le menaça de tout révéler sur les sordides histoires qui se tramaient dans son établissement : comment pouvait-on accepter qu’un garçon aussi déluré que le fils de l’Oberbürgermeister puisse devenir délégué de classe ? Une fois élu, il pourrait faire main basse sur la cagnotte du voyage de fin d’année et, pire encore, il aurait accès à la ronéo, celle qui permet d’imprimer une fois l’an le bulletin des éléves de la classe de 10e. Pouvait-on donner autant de pouvoir à un enfant ? Trop, c’était trop.
Le directeur se rangea aux arguments du pasteur. Et, cette année-là, l’épicier eut la grande satisfaction de voir son fils élu délégué des élèves de 10e. Ce fut un grand trouble pour le fils de l’Oberbürgermeister. Son père le retira de l’école et le plaça dans un institut spécialisé, où on soignerait sa mégalomanie et ses penchants pédophiles prononcés. Il y resta de longues années et je crois qu’il vient, la semaine dernière, de s’y éteindre.
Identité nationale, Joffrin accepte de débattre

On se souvient. On devait avoir vaguement 17 ans et, pour avoir le bac, il fallait être capable de faire un commentaire composé qui tienne vaguement la route. Manifestement, aujourd’hui, pour sembler être de gauche à propos de l’identité nationale, il faut être capable de ficeler un devoir sur table avec un certain nombre de mots-clés (mixité, mélange, métissage, etc.). À ce petit exercice, Laurent Joffrin excelle, comme il vient de nous le prouver dans son édito de Libération de ce mardi. Du coup, lecteur, au titre de la légitime défense, nous reprenons, nous aussi, nos talents de commentateurs composés pour te désosser la bête. Histoire que tu ne sois pas surpris si, demain, à table, tu te fais traiter de gauche scrogneugneu.
Principe : on prend l’édito tel quel et on fait les commentaires fielleux au fur et à mesure. On précise pour les mauvais coucheurs : rien n’a été rajouté dans la prose joffrinienne ; pas besoin, elle tient debout toute seule…
« Un débat sur l’identité nationale… Et pourquoi pas ? On comprend que l’opposition dénonce, dans la proposition d’Eric Besson, un calcul électoral destiné à siphonner les voix du FN, autant qu’une conception méfiante et essentiellement défensive de la nation, qui serait menacée par l’immigration, comme l’indique l’intitulé même de son ministère. Mais précisément : plutôt que de traiter la discussion par le sarcasme ou le rejet de principe, ne faut-il pas opposer à cette craintive attitude qui débouche, entre autres, sur le renvoi de trois réfugiés afghans dans leur pays en guerre, une autre conception, ouverte, évolutive et généreuse ?
On passera sur l’amorce de l’édito, le « et pourquoi pas » qui montre que Joffrin tout de gauche qu’il est, n’a pas froid aux yeux, lui, contrairement ces affreux socialo-communistes qui sont habités par une « craintive attitude ». La Nation, lui, il en fait son affaire.
« Il est passé le temps où un soixante-huitardisme mal compris faisait de la nation, vocable projeté sur la scène de l’histoire à Valmy, un mot plus ou moins obscène. Ce qui est national n’est pas nécessairement louche, intolérant ou vichyste. Cette «reductio ad petainum» paralyse la réflexion. Faut-il jeter aux orties Hoche, Lamartine, Jaurès ou Jean Moulin, coupables de défendre le drapeau, c’est-à-dire la République ? »
Miracle rue Béranger : à ce stade du texte, Laurent Joffrin est soudain devenu chevènementiste ! Et si ça se trouve, plus que Jean-Pierre lui-même, comme le prouve la suite.
« Ou encore la Commune, insurrection patriote autant que sociale, noyée dans le sang par une bourgeoisie empressée de se rendre pour massacrer à loisir la classe ouvrière, comme d’autres préféraient Hitler au Front populaire ? Après tout, il y a aussi du rouge dans le drapeau tricolore et s’il a couvert les crimes de la colonisation ou de la collaboration, heures sombres qu’il faut stigmatiser sans faiblesse, il reste celui de la Révolution française, qui fut, comme le disait Hegel, un lever de soleil. »
Ouf, fausse alerte ! La crise de boboïte aïgue au sens archéologique du terme bobo (bolchévique-bonapartiste) n’était qu’une éruption cutanée, on est revenu illico presto à l’acception libérale-libertaire courante de la boboïtude. Si ça se trouve, cette trop brève incursion joffrinienne dans le camp social-républicain n’était qu’un leurre, une bête argutie stylistique destinée à mangouster l’adversaire. La suite nous prouvera que oui.
« Les républicains et la gauche dénoncent justement le poison mortel du nationalisme, qui porte la guerre et l’intolérance comme la nuée l’orage. Ils ne sauraient laisser la nation au Front national ou à l’UMP, qui s’en serviront contre elle, alors que la gauche en est, autant ou plus qu’eux, partie intégrante. »
Ah, « la nuée et l’orage »… ça faisait longtemps. Mais ça aurait pu être pire, on était à deux doigts du « ventre encore fécond »… Mais, trêve de plaisanterie, on va passer aux choses sérieuses.
« Le débat est d’autant plus légitime que la définition de l’identité nationale doit évidemment changer. Il y a sur ce point urgence conceptuelle. Depuis deux siècles, la France est terre d’immigration. Or on sait que l’assimilation longtemps pratiquée et qui exhale aujourd’hui des relents coloniaux, ne saurait servir de viatique pour le siècle nouveau, quoi qu’en dise une certaine gauche républicaine et scrogneugneu qui s’accroche à ce modèle vétuste comme à un canot percé et laisse du coup la droite mener la discussion.
Donc, premier enseignement, Joffrin ne cible pas la droite, mais la gauche. Enfin, une certaine gauche. La nôtre. Celle pour qui l’assimilation n’est pas un gros mot, mais un impératif catégorique, une machine à gagner ensemble. Qui pendant vingt siècles a fait tourner la boutique en fabriquant de bons Français à la chaîne, sans distinction de pedigree. En privilégiant le droit à la ressemblance à celui à la différence. Justement ce que Lolo trouve dégoûtant.
« Plus de 4 millions de citoyens d’origine étrangère, qui ne sont pas moins français que les autres, demandent à garder une part de leur identité traditionnelle. Au nom de quoi le leur interdirait-on ? La France future sera tissée, en même temps que de christianisme ou de laïcisme, de culture musulmane, d’esprit africain ou de tradition ultra-marine. Ces apports sont un enrichissement et non une menace. Se contenter de dénoncer la burka, ce qui peut certes se comprendre, c’est refuser de voir cette réalité nouvelle et à bien des égards positive. La dénonciation du communautarisme – fondée en théorie – finit par couvrir une forme d’allergie à la différence. La France est d’ores et déjà plurielle. On ne saurait le nier, à l’heure de l’Europe et de la mondialisation, qui sont par nature mélange et métissage.
Roulement de tambours, on vient d’atteindre le climax de l’édito. En bon artisan, Joffrin vient de parachever le chef-d’œuvre de compagnon du Tour de néo-France. Tout y est. La mauvaise foi : « Au nom de quoi leur interdirait-on ? » L’amalgame : « Un enrichissement et non une menace ». La caricature : « L’allergie à la différence ». Et surtout Lolo fait massivement appel aux mots magiques de la France qui pense bien, ceux qui comptent triple au scrabble de l’éditorialiste : métissage, France plurielle, culture musulmane, Europe, bref tous les gadgets qui structurent l’arc idéologique de la modernitude, qui va d’Olivier Besancenot à Carla Bruni. Et comme nous sommes de très vilains enfants, nous voulions juste – en toute mauvaise foi, après tout pourquoi en laisserions-nous la jouissance à autrui – nous adresser à l’inconscient de Laurent qui, manifestement, a encore une fois débordé (remembre la « race juive »), cette fois, en accolant comme par malice le substantif « esprit » à l’adjectif « africain ». C’est bien connu, là-bas, au pays des esprits, c’est grigri, féticheurs et compagnie… Mais trêve de mauvaise psy, retournons à notre analyse.
« Encore faut-il rappeler les valeurs communes de la nation, au moment où une partie des citoyens voient leurs droits niés ou dépréciés par la relégation sociale. Elles ne sont ni ethniques, ni religieuses ni culturelles. Il n’y a pas d’essence nationale. Il y a une adhésion volontaire à des principes, qui sont ceux de la République et des droits de l’homme, comme le préconisait déjà Renan. C’est la volonté de vivre ensemble dans la coopération et la liberté qui définit la nation, et non un soi-disant fait de nature ou d’histoire, intangible et fermé. A condition, bien entendu, que ces principes deviennent réalité et que l’égalité des droits entre dans les faits pour les minorités victimes de discrimination. Renan disait aussi que la nation repose sur une histoire et une culture communes, établies par le temps. La chose est toujours vraie, à condition d’admettre que cet héritage puisse être enrichi, modifié, amendé par des apports nouveaux, et qu’il laisse leur place aux influences du grand large dans une nation à l’humeur résolument cosmopolite. Une nation nouvelle qu’une gauche tournée vers l’avenir devrait promouvoir sans complexes.
Evidemment, là, il faut remettre une couche de social, pour faire degauche. Pas de panique, on ne va pas tout de même pas embêter le lecteur en parlant de chômage, d’emplois précaires ou autres vieilleries conceptuelles. On va broder sur la nouvelle ligne de fracture, la discrimination. Chirac 1995 reloadé Sarkozy 2005, le tout remixé par DJ Derrida, bingo !
En conclusion, nous dirons que, si une fois de plus l’élève Joffrin est stylistiquement faiblichon (Lolo, nom de Dieu, vas-y mollo sur le dico des citaces !), il est politiquement efficace : il fait tout ce qu’il peut pour empêcher toute riposte organisée à Eric Besson. En ciblant uniquement ceux qui, à gauche, n’ont pas peur de s’écarter de la vulgate métisso-mondialisatrice, ceux pour qui ni la burqa ni même le voile ne sont solubles dans la République, ceux pour qui la sacro-sainte mixité ne s’arrête pas aux portes des piscines, bref ceux qui pouvaient rendre les coups à une UMP de plus en plus communautariste, il aura contribué au rétablissement d’une Sarkozie défaillante. Merci qui ?
Castrez-les tous !

Le débat sur le sort à réserver aux criminels sexuels, et plus particulièrement aux récidivistes de la chose, est récurrent dans notre société, et ressurgit à chaque fois qu’un fait divers particulièrement horrible met le public en émoi.
L’affrontement des « laxistes » et des « répressifs » constitue le rituel agonistique d’une querelle où l’on fait assaut de mauvaise foi et d’arguments péremptoires sur le mode yaka et faucon.
Dans une société régie par le principe de précaution et l’impératif du risque zéro, il est impossible aux gouvernants de tenir un discours qui prendrait acte de l’impossibilité de prévenir totalement ce genre de drame. C’est pourtant le seul qui tiendrait compte de tout l’acquis scientifique rassemblé à ce jour sur la dangerosité potentielle des criminels sexuels répertoriés.
Du côté des « laxistes », ceux qui s’opposent au durcissement continu des peines infligées aux pédophiles, violeurs et incestueux, on tire argument que le taux de récidive des criminels sexuels relâchés après avoir purgé leur peine n’est que « de 1 à 2% ». En conséquence, il serait inhumain de faire payer à l’écrasante majorité des non-récidivistes les crimes de quelques individus dangereux et pervers. Comme on peut faire dire aux chiffres n’importe quoi, on va pêcher dans un amas de statistiques ceux qui conviennent le mieux à votre démonstration, en laissant soigneusement de côté d’autres plus dérangeants pour la thèse que l’on défend.
Ce taux extrêmement réduit de récidive des criminels sexuels est établi à partir de données policières et judiciaires sur les actes relevant de cette criminalité répertoriés sur le territoire. Il signifie seulement que 1 à 2% des crimes élucidés sont le fait de personnes ayant déjà été condamnées pour des faits semblables, et ayant recouvré la liberté. Cela exclut de la statistique toutes les affaires non signalées et non élucidées.
Si l’on essaie de fouiner un peu dans la littérature psychiatrique et criminologique relative à la question, on découvre que le taux de récidive de ce type de criminel est nettement plus élevé. Les études les plus récentes (la plupart effectuées dans les pays anglo-saxons, Etats-Unis, Angleterre et Canada) établissent un taux moyen de récidive entre 15 et 20 % avec des variations significatives selon les catégories de criminels. Les parents ou beaux-parents incestueux réitèrent beaucoup moins fréquemment leurs forfaits que les prédateurs sexuels extra-familiaux. Pour l’anecdote, les plus incorrigibles sont les exhibitionnistes, qui sont plus de 40% à persister à ouvrir leur imperméable à la sortie des écoles après avoir subi les foudres de la justice.
Le problème des récidivistes n’est donc pas marginal ou seulement surgi de la boite à outils populiste de quelques politiciens de droite et d’extrême droite.
D’autres études essaient d’établir une corrélation entre le suivi médico-social des criminels libérés et la récidive. La comparaison du comportement d’un groupe d’individus laissés à eux-mêmes à leur sortie de prison et d’un groupe pris en charge dans le cadre de thérapies comportementales et cognitives est peu concluante : certaines d’entre elles montrent une nette diminution de la récidive chez les seconds, d’autres, au contraire révèlent qu’une thérapie imposée aux sortants n’a aucun effet sur leur comportement ultérieur.
L’argument des « laxistes » consistant à affirmer qu’en y mettant les moyens, une prise en charge thérapeutique sérieuse au cours de la détention et à la sortie préviendrait de nouveaux drames n’est donc pas corroboré, loin s’en faut, par l’état actuel de nos connaissances.
En revanche, il existe une méthode, paraît-il assez fiable, d’établir un pronostic sur la potentialité de récidive des criminels sexuels, la pléthysmographie. Cela consiste à enregistrer les variations de volume du pénis du sujet lorsqu’il est soumis à des stimuli sexuels interdits au sens du code pénal (pédophilie, scènes de viols etc…).
Cette technique, largement pratiquée aux Etats-Unis, ne semble pas avoir traversé l’Atlantique…
Mais, même si l’on arrivait à prévoir avec un degré de fiabilité suffisant le comportement des condamnés ayant purgé leur peine, il resterait à décider ce que l’on en fait. Bouclage à vie ? Castration chimique ? Castration physique ? Tout cela n’est pas compatible avec l’idée que notre civilisation se fait de la morale et des droits de l’homme, et ne garantit même pas que ces individus ne trouveront pas d’autres moyens que l’usage de leur sexe pour assouvir leurs pulsions.
Et si l’on décidait, tout simplement, de faire avec ?
Joyandet remet en selle le Tour du Faso
En ces temps de surenchère castratrice et de gadgetisation de l’identité nationale, c’est trop peu souvent que j’ai l’occasion de féliciter un membre du gouvernement. Et croyez-moi, je le regrette : après tout, moi aussi je paye des impots, et je serais bien content qu’il servent à autre chose qu’à gonfler, grâce à la TVA réduite, la marge brute de McDonald ou à faire prospérer la PME de sondages de Pierre Giacometti. Un grand bravo donc à Alain Joyandet, secrétaire d’Etat à la Coopération et à la Francophonie, qui est intervenu personnellement en fin de semaine dernière auprès de l’AFD, l’Agence Française de Développement, pour que le Tour du Faso, en proie au pires difficultés financières, puisse se tenir cette année, grâce à un chèque de 115 000 Euros, qui a permis de boucler le budget, ou plutôt de budgétiser la Boucle. Vous n’êtes pas obligé de me croire sur parole, mais ce Tour-là, qui se court cette semaine au Burkina, est une des plus belles épreuves cyclistes du monde. Un Tour à la dure, sans aucune concession au XXIème siècle où les cadors réparent eux-mêmes leurs vélos au bord des pistes et dorment chaque nuit à la belle étoile. Vous pouvez d’ailleurs vous faire une idée par vous-même en regardant le résumé quotidien tous les soirs sur TV5 Monde, qu’on félicitera donc aussi au passage.
Un charter, pour quoi faire ?

« Charter pour la guerre. » Ils ont dû être contents, à Libé, d’avoir trouvé ce titre. En quatre mots tout est dit. Leur fragilité et notre inhumanité. On les imagine, des centaines de malheureux jetés sans ménagement dans le pays embrasé auquel ils avaient réussi à échapper au péril de leur vie. On aimerait connaître les bureaucrates insensibles ou les juges au cœur dur qui ont pris cette décision. On veut être du côté de la générosité, avec Philippe Lioret, réalisateur de Welcome, promu expert es sans-papiers, ce qui serait rigolo si le sujet était un peu moins lourd. À ce compte-là, on fera bientôt témoigner Al Pacino aux procès de la mafia et Christian Clavier écrira une thèse sur le Moyen Âge.
On n’a guère envie d’ironiser, même si toute la presse évoque un « charter » pour trois hommes (il semble qu’il y avait pas mal de journalistes dans ce charter-là). Parce que trois hommes, c’est trois hommes et que leur « rapatriement forcé » – terme propre destiné à noyer le poisson de l’expulsion – décrit précisément le fossé tragique qui sépare la politique de l’humanitaire, la raison d’Etat des droits de l’individu et la gestion technocratique de la compassion humaine. Il n’y a pas, en politique, une main invisible qui réconcilie le bien commun et la vie des gens. Que l’immigration clandestine soit difficilement supportable pour les heureux habitants du monde développé ne change rien au fait qu’elle est pour un très grand nombre d’êtres humains une nécessité vitale. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle « l’infraction à la législation sur les étrangers » n’est pas un délit comme un autre : sur le plan moral, on admet parfaitement que le délinquant transgresse la loi. En conséquence, notre cerveau droit peut approuver une décision raisonnable et notre cerveau gauche saigner pour le sort de ceux qui jouent le rôle des œufs dans l’omelette indigeste qu’est la politique migratoire (c’est peut-être le contraire, j’oublie toujours). Encore faut-il accepter de mobiliser l’un et l’autre.
Si on adopte le seul point de vue des trois Afghans renvoyés chez eux, on ne peut que se désoler. Or, c’est celui que les médias, producteurs d’émotion à jets continus, font naturellement prévaloir. Une décision politique, ça ne fait pas une bonne histoire. Dans le village planétaire, la raison collective est priée de s’incliner devant le malheur individuel. Ces hommes, nous connaissons leurs visages, nous les avons vus pleurer. Nous avons lu dans leurs yeux le désespoir de ceux qui ne peuvent plus rêver d’un avenir meilleur. Leur souffrance est la nôtre. Nous avons entendu la gauche s’indigner en boucle et un responsable associatif nous expliquer qu’ils n’auraient d’autre choix que « de se faire mutiler ou enrôler par les Talibans ». Nous avons été un peu soulagés de savoir que l’ambassade de France les avait pris en charge. Reste que nous nous sentons coupables et comptables de l’injustice qui les a fait naître dans un pays qui a raté l’entrée dans la modernité sans parvenir à se faire oublier de l’Histoire.
Face à ces existences détruites, les arguments d’Eric Besson (qui sont, peu ou prou, ceux de tout ministre en charge, de droite ou de gauche, sur l’immigration clandestine) sont glacés, à côté de la plaque. Le ministre de l’Immigration et du Reste est inaudible quand il affirme que les trois expulsés avaient épuisé toutes les voies de recours (ce qui signifie notamment qu’ils n’avaient pas demandé l’asile en France ou que ce statut leur a été régulièrement refusé). On ne l’écoute pas plus quand il explique que le fait de venir d’un pays en guerre ne vaut pas titre de séjour. D’accord, c’est triste. On a le droit de récuser cette proposition et de refuser les expulsions mais alors, il faut être cohérent et décréter que la France est un droit pour tous les ressortissants de tous les pays en guerre. Oui, nous serions fiers si notre pays accueillait toute la misère du monde tout en intégrant au roman républicain tous ceux qui se trouvent régulièrement sur son sol. Pour autant, sommes-nous prêts à manifester pour une augmentation massive des impôts ? Il convient aussi de demander à tous les Français de se porter volontaires pour que leur ville ou leur quartier abrite les prochaines « jungles » – il est à craindre que les habitants de Calais et ceux du Xe arrondissement de Paris ne soient guère enthousiastes mais sans doute sont-ils lepénistes. (Du reste, à en croire l’inévitable sondage CSA-Le Parisien, l’opinion est plutôt partagée sur le sujet, 44 % des sondés se déclarant opposés au renvoi tandis que 36 % s’y disent favorables.)
On dit, pour le dénoncer avec force, que cette expulsion est un « coup » politique. Certes, mais est-il condamnable en soi de faire de la politique ? Oui, il s’agit bien d’adresser un message à tous les candidats potentiels à l’immigration, de leur faire savoir que s’ils décident quand même de tenter l’aventure ils courent le risque de perdre beaucoup de temps, d’argent, d’énergie et d’espoir pour se retrouver à la case départ. En vrai, c’est un tout petit signal et il est possible que beaucoup d’Afghans tirent de la mésaventure de leurs compatriotes l’idée qu’ils pourront passer à travers les mailles du filet – trois expulsés pour combien qui ont réussi ? Seulement, ce n’est pas l’efficacité de la politique migratoire du gouvernement qui est contestée mais, comme toujours, son existence même. Il est tout de même curieux que toute la presse pousse des cris d’orfraie parce qu’un ministre propose un débat sur le thème « Qu’est-ce qu’être français ? ». Comme si la question était dénuée d’intérêt voire moralement indigne. Peut-être que pour nos belles âmes, poser la question, c’est déjà y répondre. En clair, Eric Besson a forcément derrière la tête l’idée qu’être français, c’est être blanc (si c’était aussi simple, on n’aurait sans doute pas besoin de se poser la question).
Un débat, et puis quoi encore ? Les mecs de droite, ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît. Pour ma part, je trouve que dans la confusion ambiante, la question vaut d’être posée mais c’est sans doute la preuve que, moi aussi, je suis de droite.
La politique consiste à concilier le bien commun et celui de chacun, parfois à sacrifier celui-ci à celui-là. En matière d’immigration, c’est le prix à payer pour ne pas mettre un peu plus en danger la cohésion nationale. Pour autant, on a le droit de s’attrister. Et l’indifférence britannique aux expulsions (qui ne concernent pas, là-bas, trois personnes mais plusieurs dizaines et plusieurs fois par an) n’est pas plus sympathique que le sentimentalisme qui, chez nous, tient lieu de toute réflexion. On apprend en effet dans un excellent sujet diffusé au « 20 heures » de France 2 le 21 octobre que la presse anglaise n’a pas consacré une ligne à la question.
François Fillon estime que la France n’a pas à se sentir coupable. Il me semble qu’il a un peu tort. La culpabilité qu’on éprouve quand on fait du mal, même si on n’a pas d’autre choix, fait partie de notre humanité. Avoir des états d’âme peut être inutile, parfois dangereux, mais c’est la preuve qu’on a une âme.
Autocritique
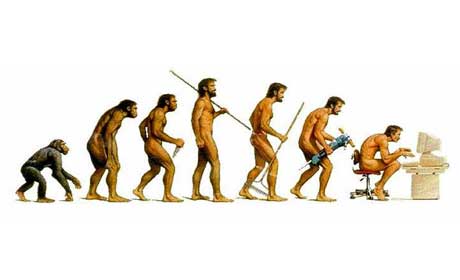
Le pire, quand on a écrit un bouquin, c’est les questions débiles auxquelles il faut répondre, genre : « Pourquoi avez-vous écrit ce livre ? » ou, pire encore : « Pourquoi ce livre ? Et pourquoi vous ? »
La première réponse qui me vienne à l’esprit tient tout entière dans ce mot d’Oscar Wilde : « Tout ce qui vous arrive vous ressemble ! ». Et avec tout ce qui m’est arrivé sans me vanter, je pourrais en remontrer à n’importe qui question inculture générale.
Lorsque j’étais étudiant, il me fallait bien gagner un peu d’argent ; et comme à l’époque l’EPAD n’existait pas encore, eh bien je donnais des cours particuliers.
Mais mes besoins financiers ne cessaient d’augmenter, à tel point que j’ai finalement été contraint d’enseigner aussi des matières que je n’avais jamais apprises, comme par exemple l’allemand.
Bien sûr, je m’étais fixé quelques règles déontologiques de base. Je n’acceptais comme élèves que des débutants de 6ème, et jamais plus intelligents que moi.
Dans ces conditions, ça ne pouvait que marcher ; même les parents s’extasiaient sur cette pédagogie subtile : se mettre au niveau de l’élève, pour mieux l’accompagner dans sa découverte de la langue de Goethe et de Tokio Hotel.
Un peu plus tard, j’ai décroché mon premier vrai boulot : professeur d’histoire-géographie dans une école d’électronique.
L’histoire était pourtant la seule matière où je n’avais pas eu la moyenne au bac, et pour cause : j’avais fait l’impasse sur la Révolution française !
Mais il y a des grâces d’Etat : dans cette école d’électronique, l’histoire-géo ne comptait pas pour passer dans la classe supérieure, et mes élèves n’ont pas tardé à me le faire savoir par tous moyens. Bref, ils s’en foutaient, mais pas autant que moi – et sur ces bases on n’a pas eu trop de mal à s’entendre.
Et puis j’ai fait mes premières armes en tant que nègre d’hommes politiques avec le regretté Raymond Barre. En ce temps-là, Raymond était Premier ministre, et il devait prendre la parole dans, je cite, « un grand meeting des Jeunes Centristes ». J’ai tout de suite senti qu’il y avait un loup.
En fait, ces gens-là ne se faisaient guère d’illusion sur leurs capacités de mobilisation : dans toute la France, ils avaient affrété des cars pour faire monter des jeunes à Paris, en leur promettant un bon repas chaud et un concert gratuit de Chuck Berry !
Mais là encore, problème d’inculture : Raymond n’avait jamais entendu parler de Chuck ! On a eu beau essayer de le raisonner, rien à faire… Pas question pour lui de se produire en première partie : Raymond voulait la vedette !
Alors, ce qui devait arriver arriva. Après le set de Chuck Berry, les gradins se sont vidés en moins de temps qu’il ne faut pour chanter « Johnny B. Goode ». Et c’est devant une salle aux trois quarts vide que Barre a lancé son Appel à la jeunesse de France.
Puisque j’en suis aux révélations, allons-y ! Au fil de ma carrière, peu de gens le savent, j’ai aussi été amené à travailler, entre autres, pour un certain Charles P… au ministère de l’I…
Là-bas, il arrivait parfois qu’on me cherche – notamment le matin. Ma secrétaire avait alors pour consigne de répondre que j’étais à la bibliothèque de l’Assemblée nationale, en train de ciseler un discours pour le ministre. En fait bien sûr je dormais profondément, après une dure nuit de sociologie du nightclubbing.
C’est de cette riche expérience en matière d’inculture générale que j’ai souhaité faire profiter aujourd’hui mes contemporains. Une démarche humaniste au sens plein du terme, puisqu’elle n’a d’autre but que l’élévation de l’homme.
Elévation spirituelle bien sûr, comme l’ensemble de mon œuvre. Mais élévation sociale aussi : grâce à ce petit livre vert, plus jamais vous n’aurez l’air ridicule en société. « La culture, c’est ce qui reste quand on a tout oublié », disait Édouard Herriot. Eh bien, avec moi, vous pourrez faire mine d’avoir oublié tout ce qu’en fait vous n’avez jamais su !