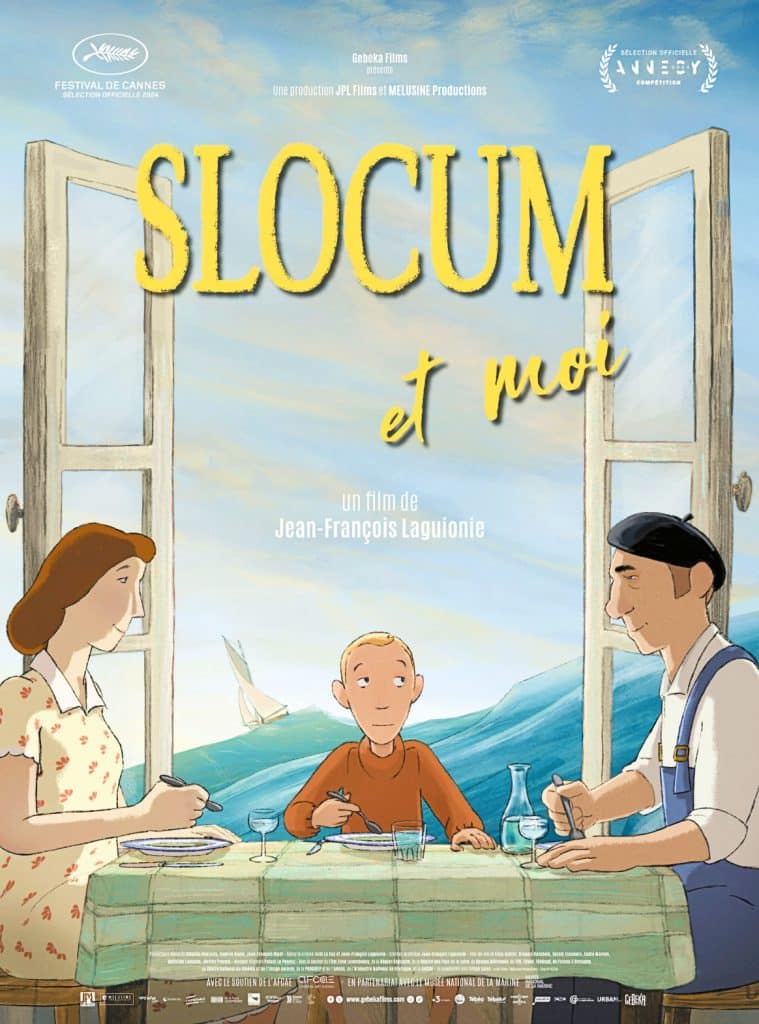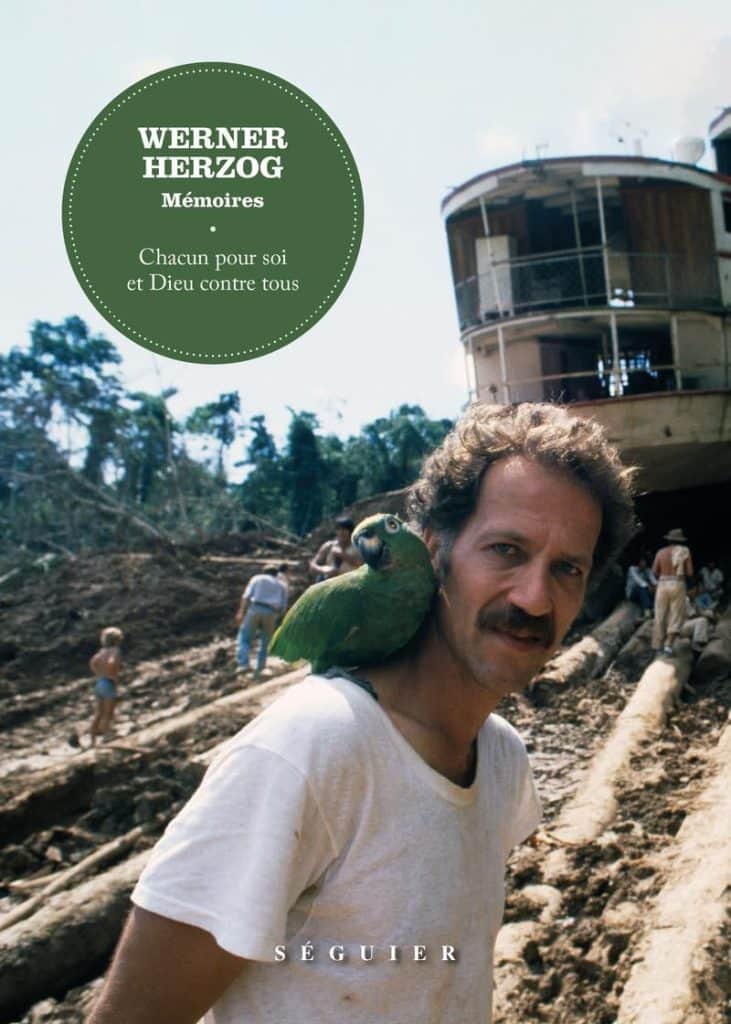Avant que de nouveaux pavés en mémoire de l’Holocauste soient inaugurés à Anderlecht vendredi dernier, une polémique a été évitée de justesse. Le témoignage de Fadila Maaroufi.
Il y a deux jours, nous avons appris que deux écoles communales d’Anderlecht, Carrefour et Marius Renard, avaient refusé de participer à la pose de Pavés de la Mémoire honorant les victimes de la Shoah, invoquant des sensibilités liées au conflit israélo-palestinien. Selon le journal La Dernière Heure, les directions des écoles craignaient des débordements et des réactions de la part des parents. Cependant, le 10 janvier 2025, décision a finalement été prise de faire participer ces écoles à cet événement, ce qui est une avancée positive.
Néanmoins, il est légitime de se demander comment aller de l’avant.
Tentera-t-on encore longtemps de dissimuler les problèmes sous le tapis ?
Pour mieux comprendre le contexte, il est essentiel de revenir sur l’histoire du quartier de Cureghem, anciennement un quartier juif où une synagogue a été construite le 6 avril 1933. Ce quartier a connu de profonds changements, notamment avec le départ des grossistes juifs situés dans le triangle près de la gare du Midi. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution, notamment l’augmentation des actes d’antisémitisme, souvent passés sous silence.
Antisémitisme minimisé depuis des années
Des événements marquants témoignent de cette montée de l’intolérance. En 1997, un acte de vandalisme a failli coûter cher à la synagogue, quand de l’essence avait été répandue, mais les flammes évitées. Des pavés ont été lancés sur les vitres, et des cocktails Molotov ont été utilisés. Le dimanche 31 mars 2002, des jeunes ont jeté plusieurs cocktails Molotov sur le lieu de culte, causant des dégâts considérables. Les journalistes de l’époque ont recueilli quelques témoignages qui minimisent l’antisémitisme voire le justifient.
Brahim, un jeune musulman de 25 ans, a qualifié cet acte de « gratuit et inutile« , soulignant que seuls des individus irresponsables pouvaient agir ainsi. Il est crucial d’interroger les racines de l’antisémitisme, notamment parmi les jeunes musulmans, et de réfléchir à l’idéologie des Frères musulmans qui se propage en Europe. Rachid, 24 ans, s’est également exprimé sur ces attaques : « C’est triste à dire, mais ce sont des choses qui arrivent en Europe, nous recevons juste les informations intéressantes la communauté juive. Quand on confronte les télés arabes aux télés juives, allez savoir qui a raison… Cela ne justifie rien, mais il faut trouver la part des choses. Le plus important ici est qu’un lieu de culte a été attaqué. Qu’il soit musulman, juif ou catholique, peu importe, car c’est de toute manière inadmissible qu’un quelconque lieu de culte soit attaqué. »
Cette justification et cette façon de minimiser la situation ne sont pas nouvelles et sont largement partagées et diffusées depuis le 7 octobre 2023, après les attaques des terroristes du Hamas contre Israël auprès des jeunes et dans le monde médiatique.
Analysons le témoignage de Rachid : il suggérait que de tels actes sont courants et presque inévitables, ce qui minimise la gravité de l’antisémitisme, et semblait même normaliser la violence quand il dit : « Ce sont des choses qui arrivent en Europe« .
La phrase « nous recevons juste les informations intéressantes la communauté juive » et la comparaison entre « les télés arabes » et « les télés juives » impliquent une méfiance envers les médias et insinuent un biais, ce qui nourrit des théories du complot ou des préjugés.
A lire aussi: Molenbeek, capitale européenne de la culture en 2030?
Quand il dit « il faut trouver la part des choses« , cela peut être interprété comme une tentative de chercher des excuses ou des explications qui atténuent la responsabilité des auteurs des actes antisémites. C’est un appel à la relativiser l’acte.
Bien que son propos reconnaisse l’inadmissibilité des attaques contre les lieux de culte, il minimise l’antisémitisme, son propos semble diluer l’importance de l’antisémitisme en le plaçant sur le même plan que toute attaque contre un lieu de culte, sans reconnaître la spécificité et l’histoire des violences antisémites.
On peut constater la contradiction dans la phrase « Cela ne justifie rien… », qui est suivie par des propos qui semblent justement chercher à relativiser ou expliquer le contexte, ce qui affaiblit la condamnation initiale. Dans l’ensemble, la phrase oscille entre la reconnaissance de la gravité d’une attaque contre un lieu de culte et une tentative de relativisation qui nous pouvons percevoir comme une banalisation de l’antisémitisme.
Une jeunesse ciblée par l’idéologie
En 2010, un cocktail Molotov a de nouveau été lancé contre la porte d’entrée de la synagogue. En 2014, celle-ci a été victime d’un incendie volontaire, quelques mois après l’attentat tragique du musée juif de Bruxelles. En 2017, des actes de vandalisme ont visé les caméras de surveillance de la synagogue à plusieurs reprises.
Ce quartier est aussi le témoin de mon enfance. Je me souviens des cocktails Molotov lancés sur la synagogue et du départ progressif des Juifs du triangle, remplacés par des commerces pakistanais. Cette évolution marque une page qui se tourne, laissant des souvenirs empreints de stigmates et un antisémitisme qui continue de se manifester dans les murs du quartier. Il est essentiel de se souvenir et de réfléchir à ces événements, non seulement pour honorer la mémoire des victimes, mais aussi pour construire un avenir sécurisé pour nos compatriotes juifs et pour l’ensemble de la société. Nous ne pouvons pas ignorer ces faits ni tourner la page. Tous les actes d’antisémitisme, qu’ils soient verbaux ou physiques, soulignent la nécessité d’une prise de conscience collective sur ce problème, d’oser le nommer et de reconnaître qu’il nous concerne tous. Cet antisémitisme est en partie le résultat de la pénétration de l’islamisme dans divers secteurs de notre société, et l’école a été l’une des premières cibles de l’idéologie des Frères musulmans.